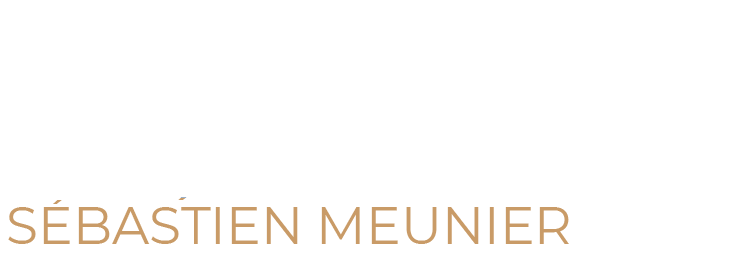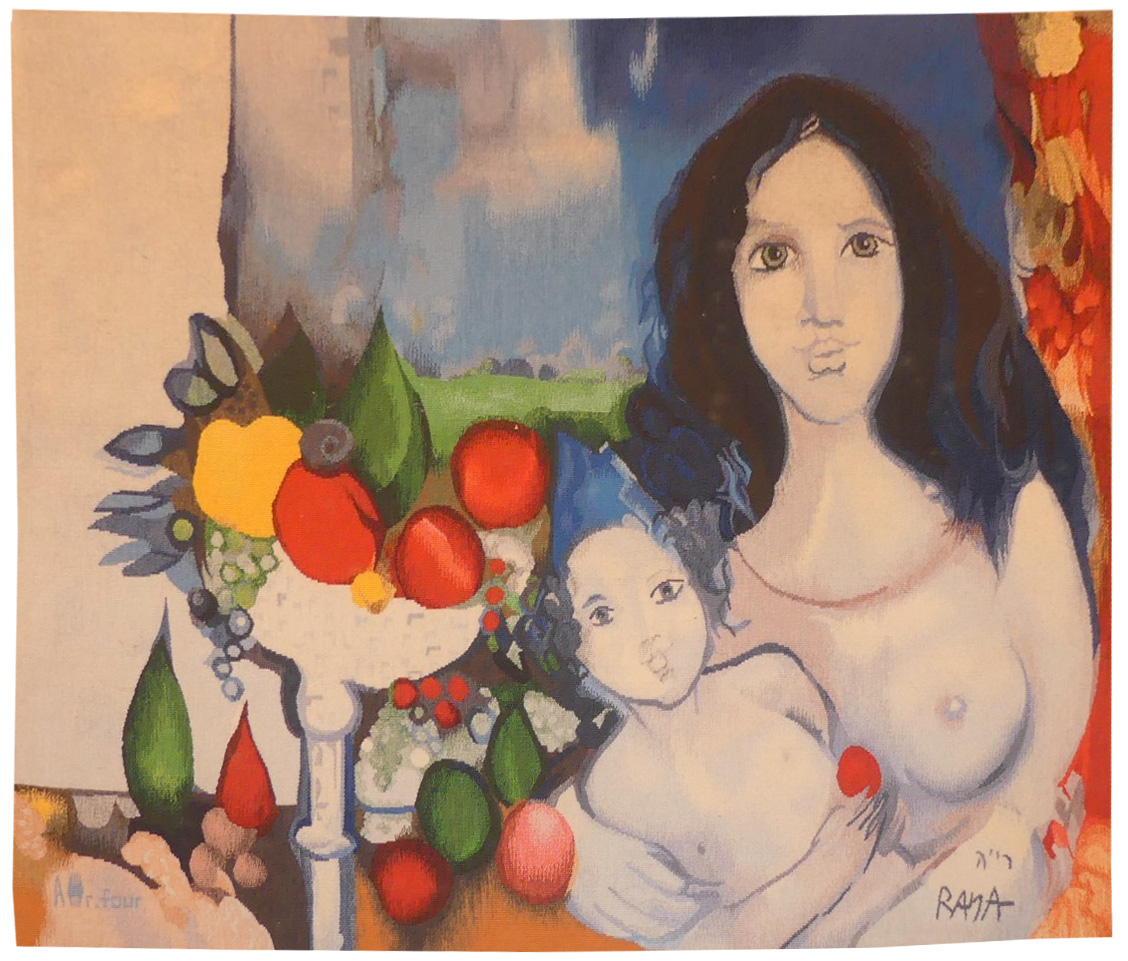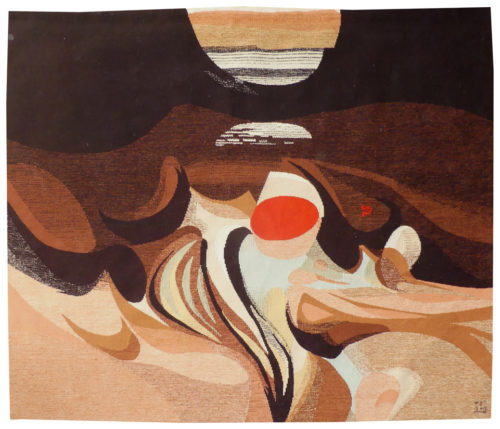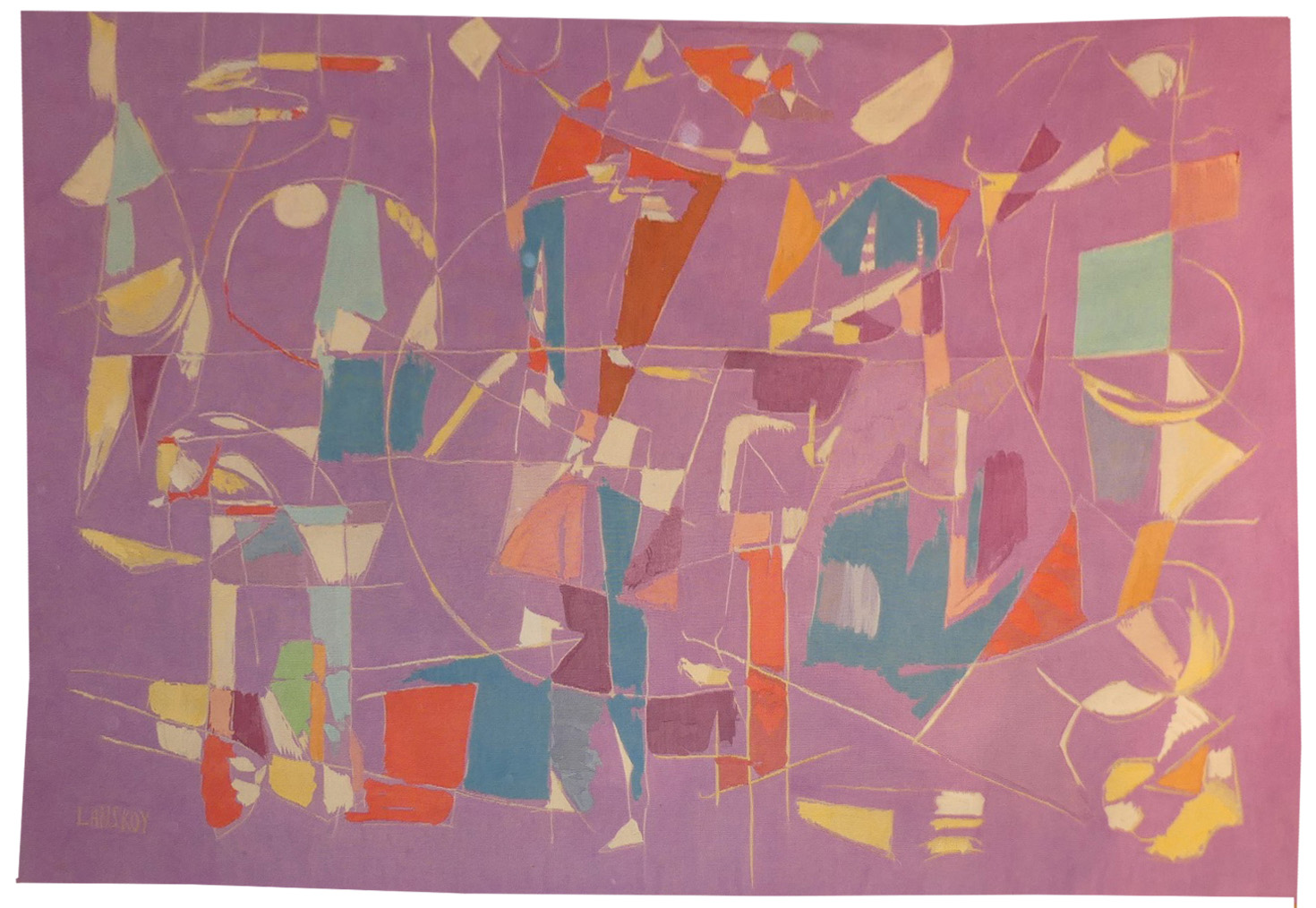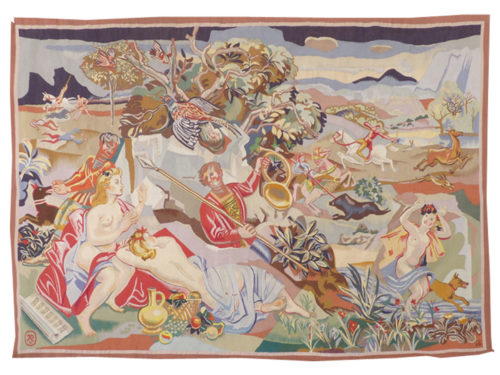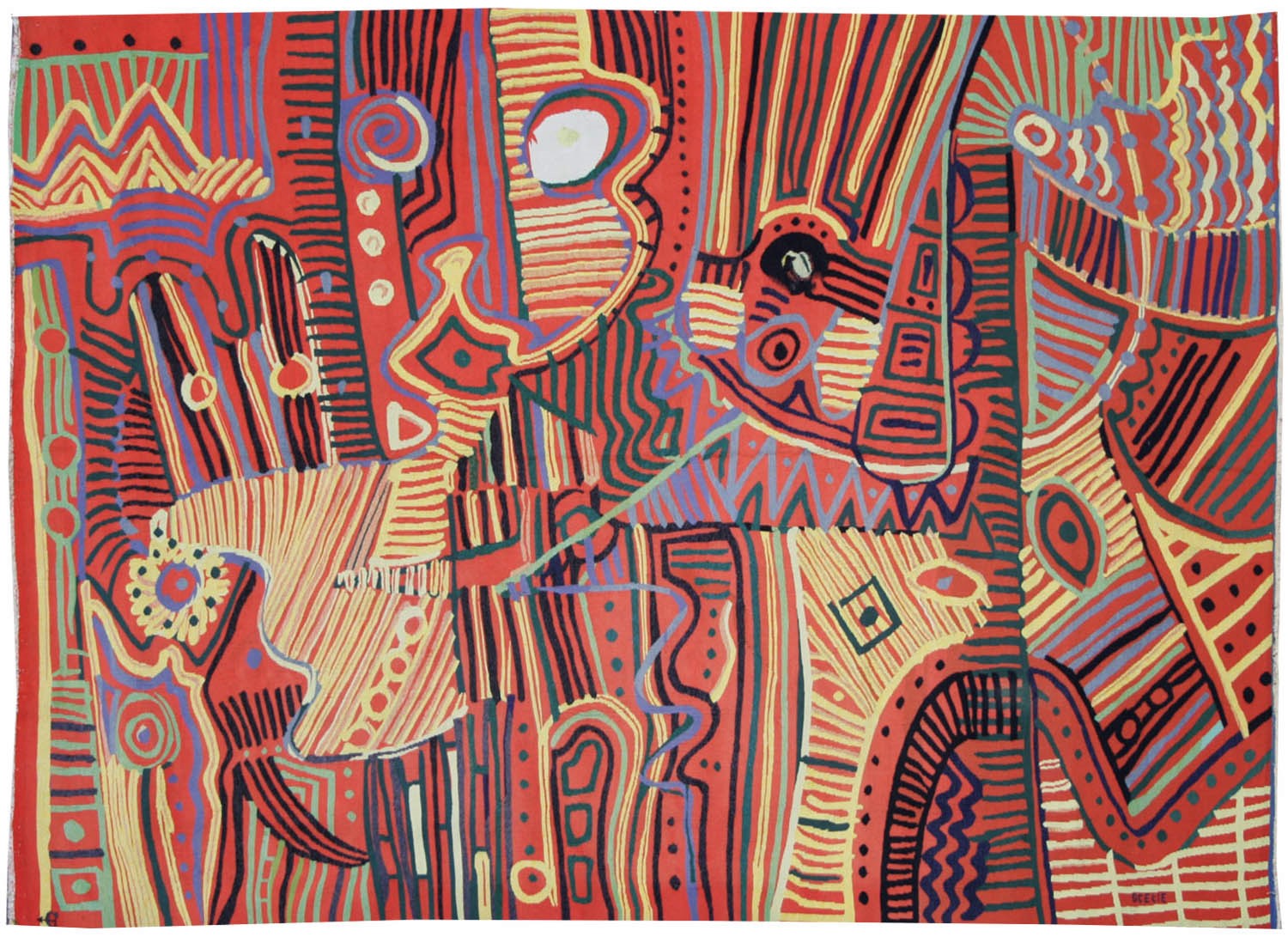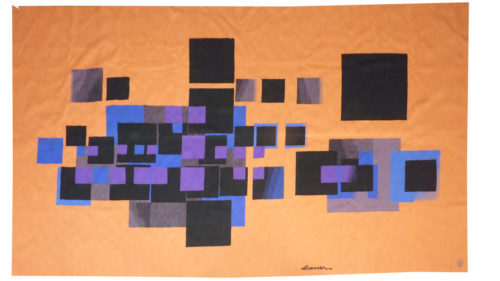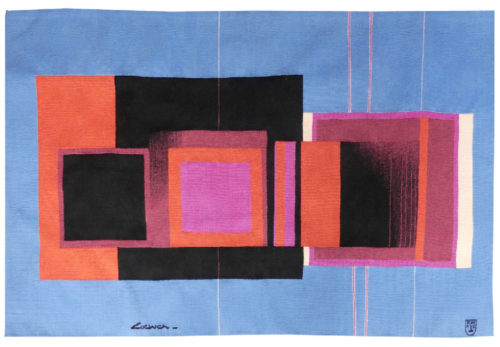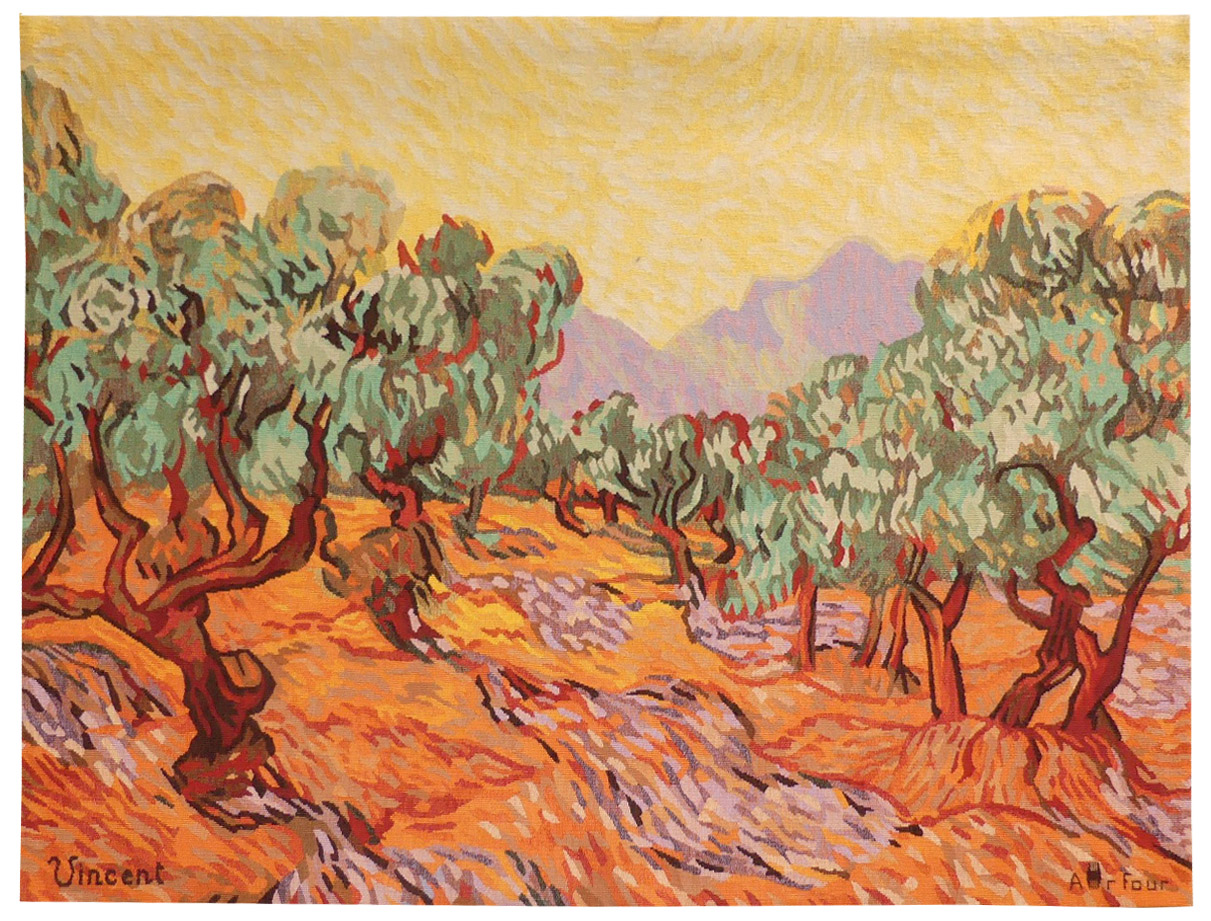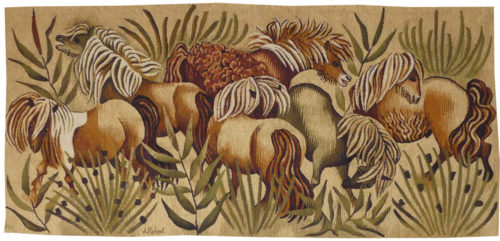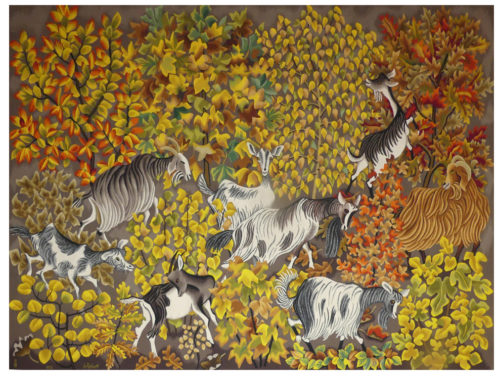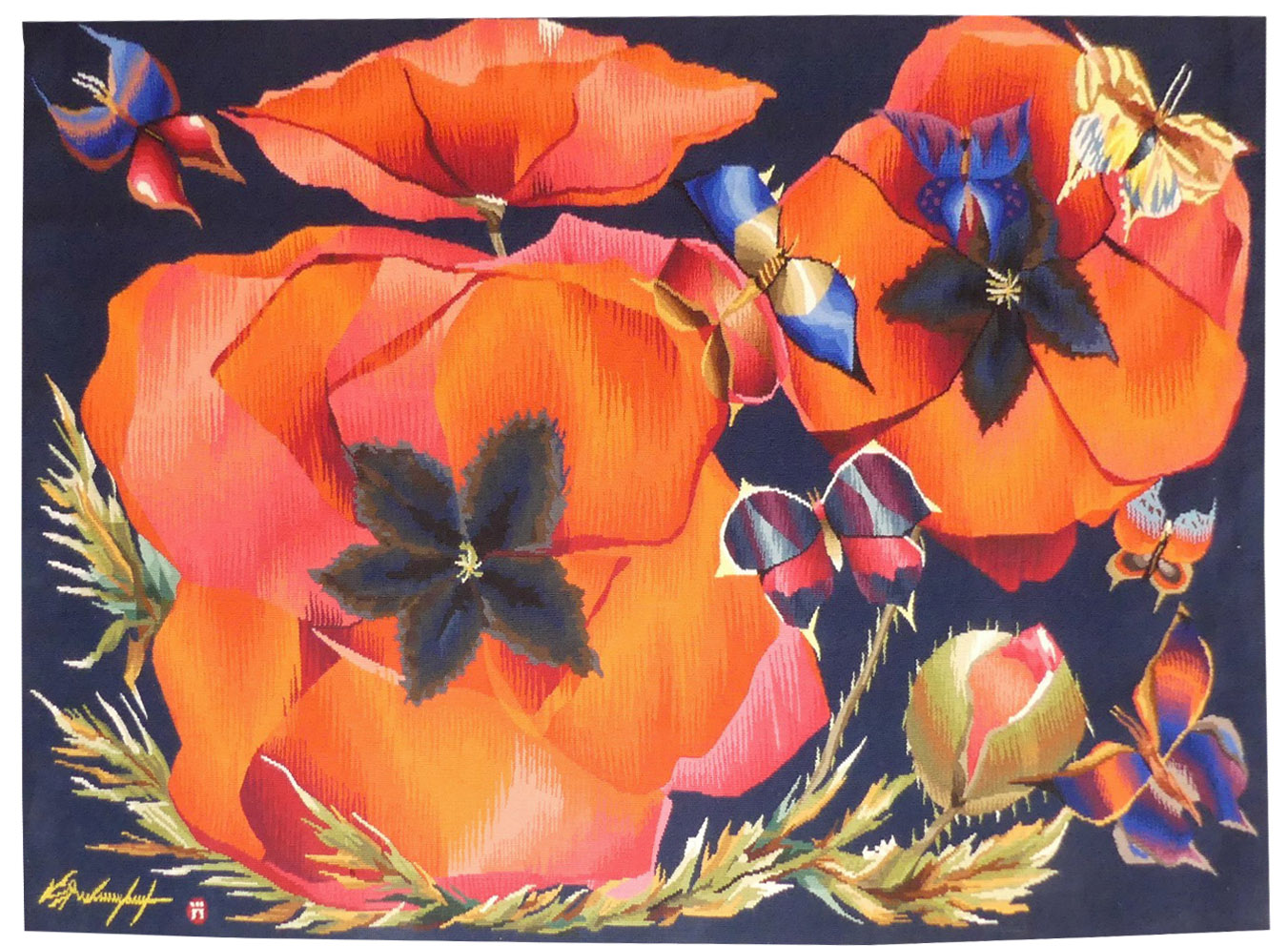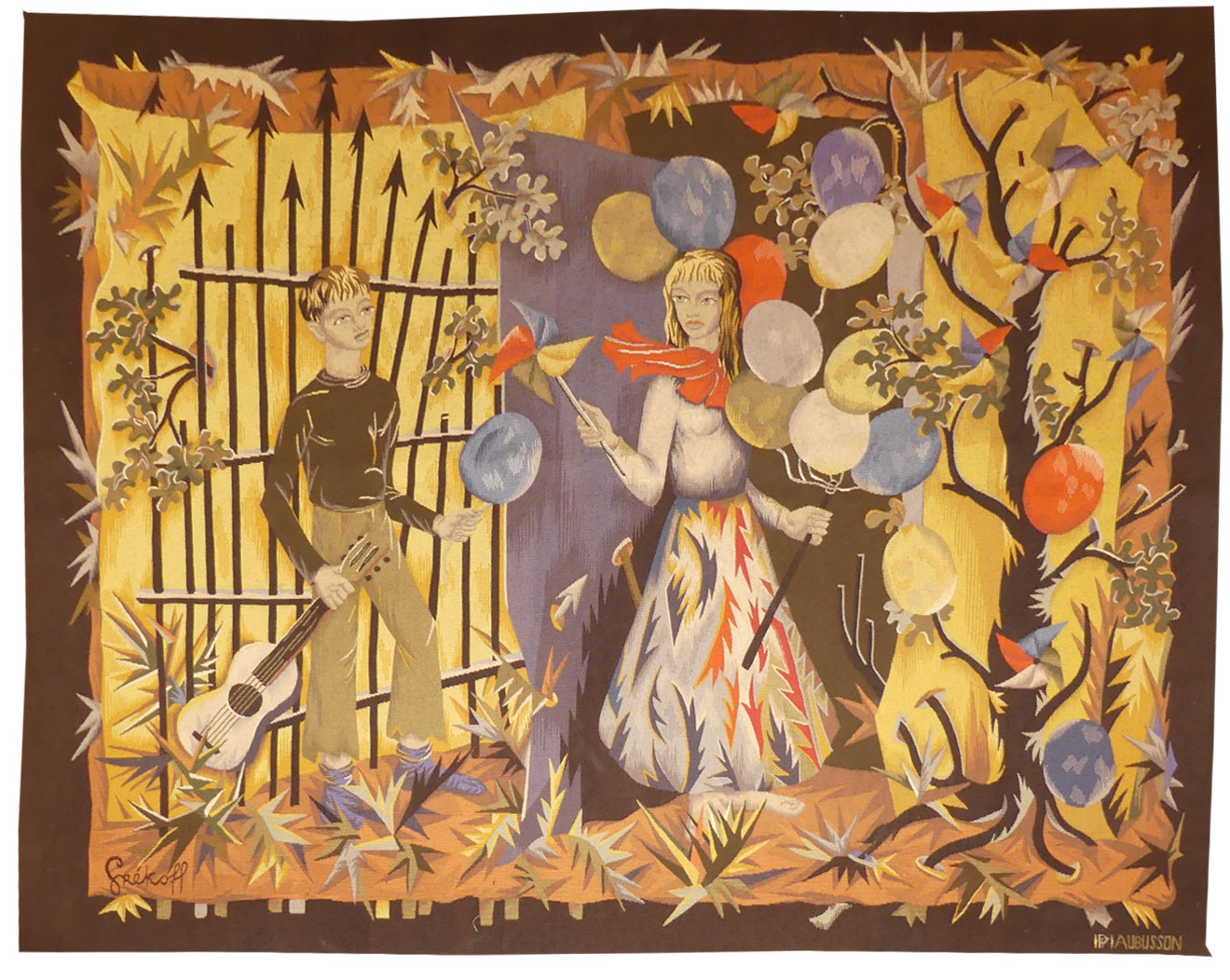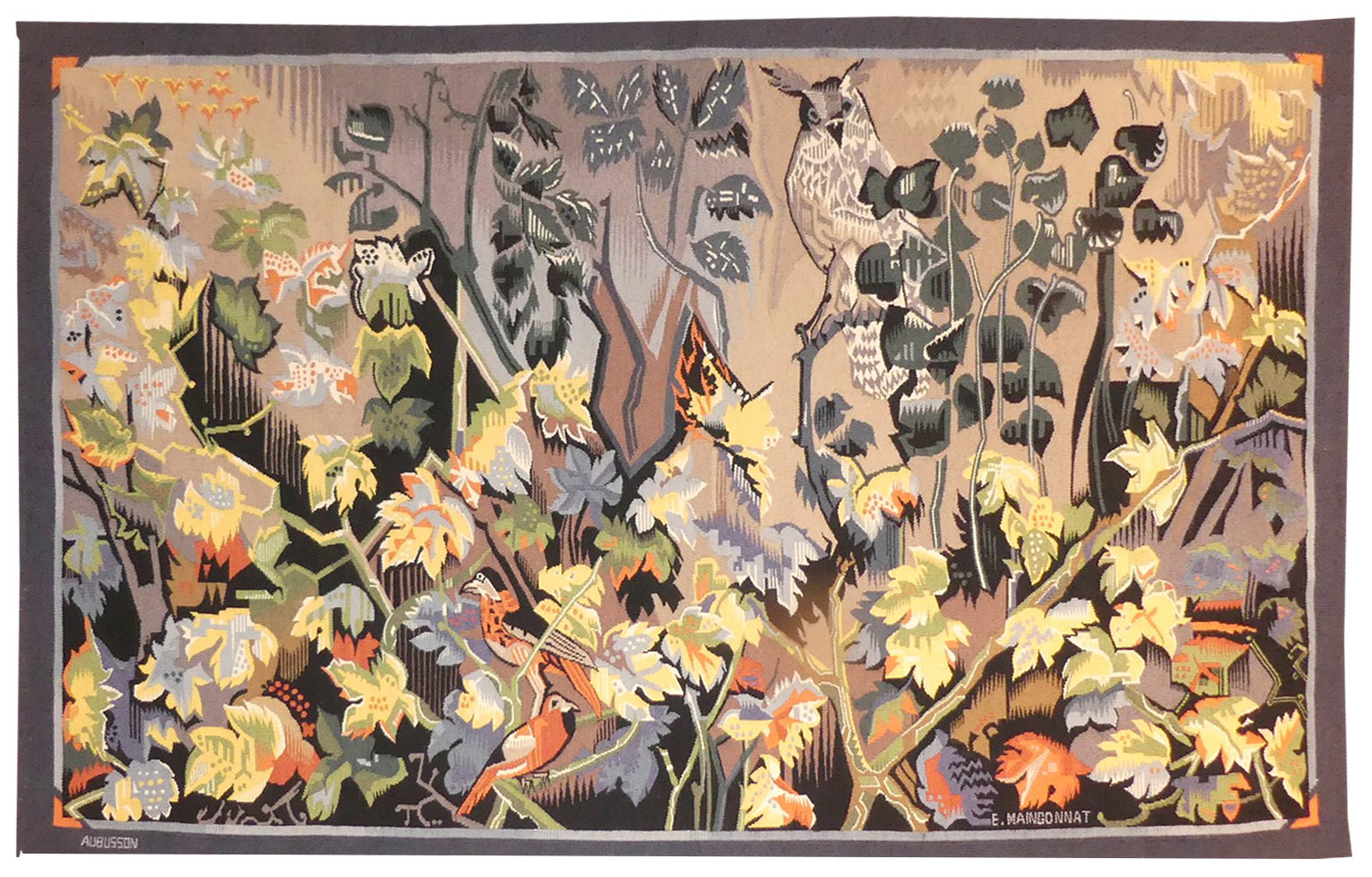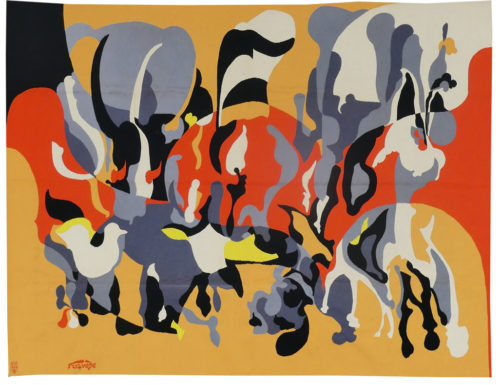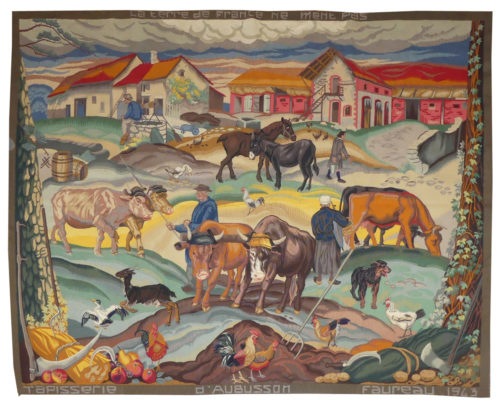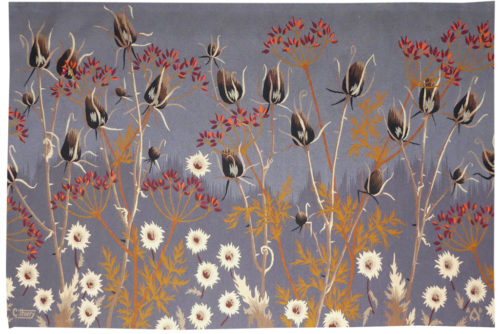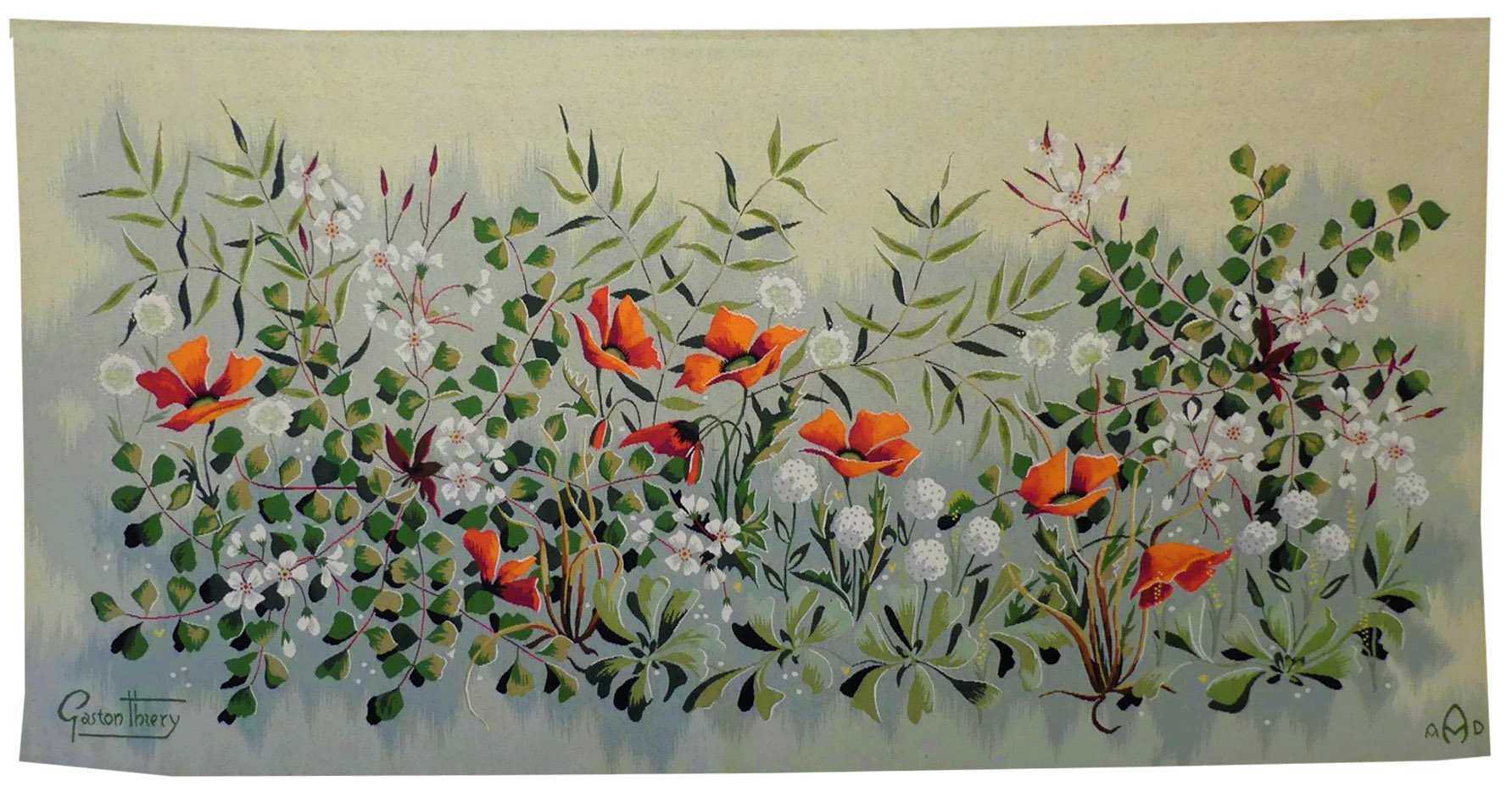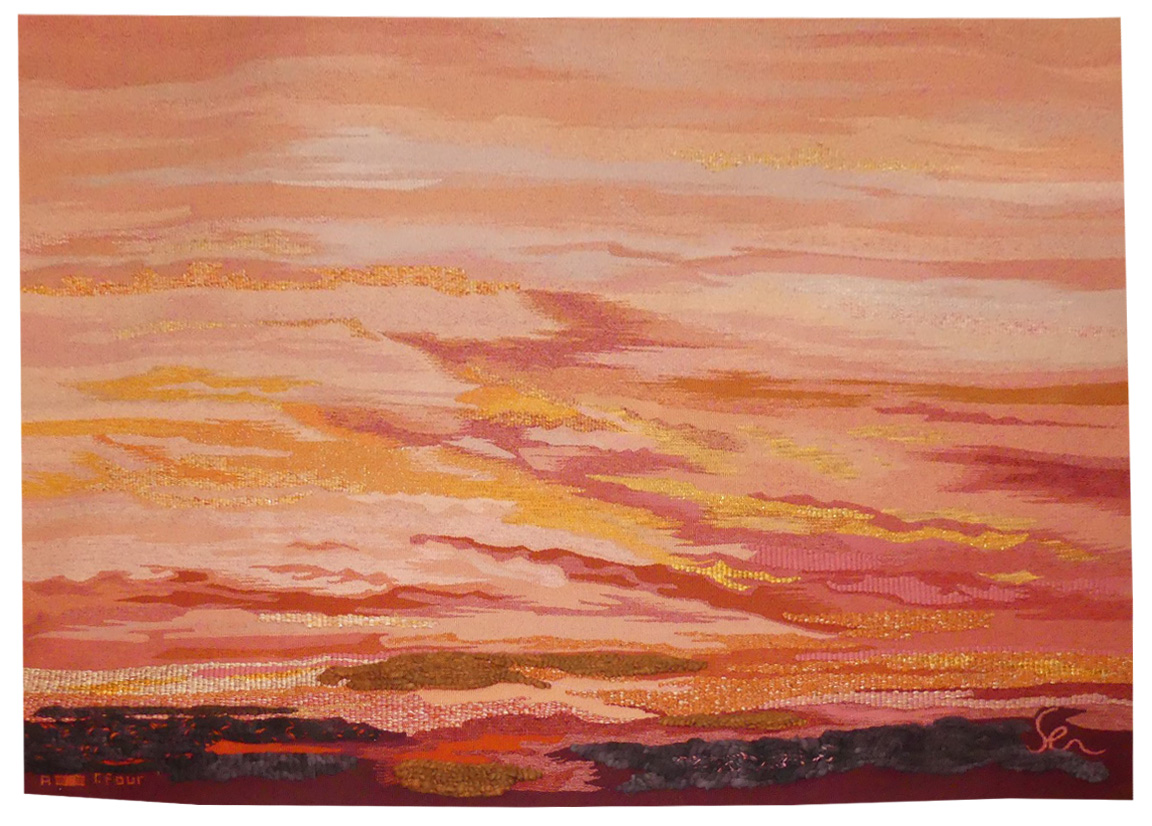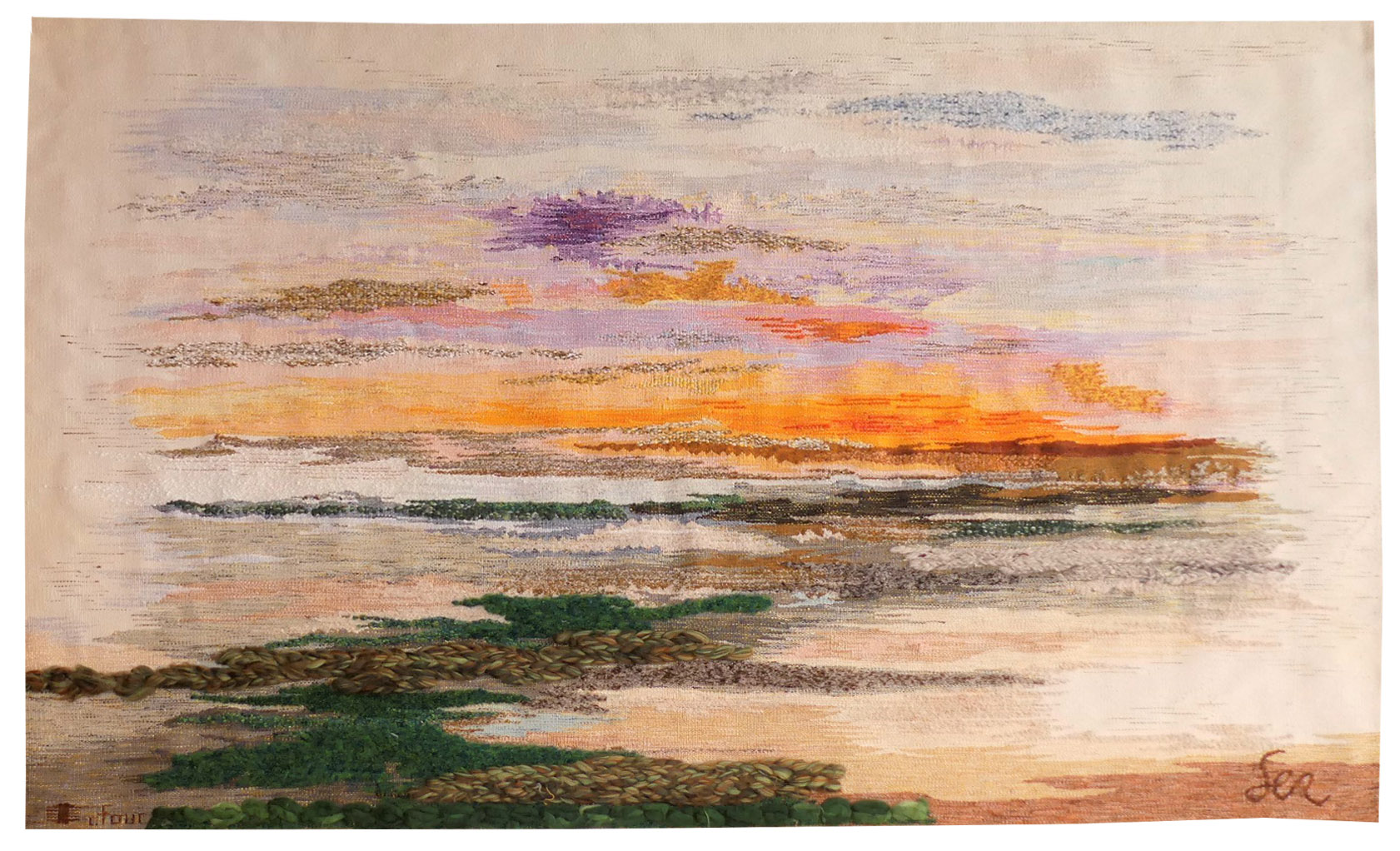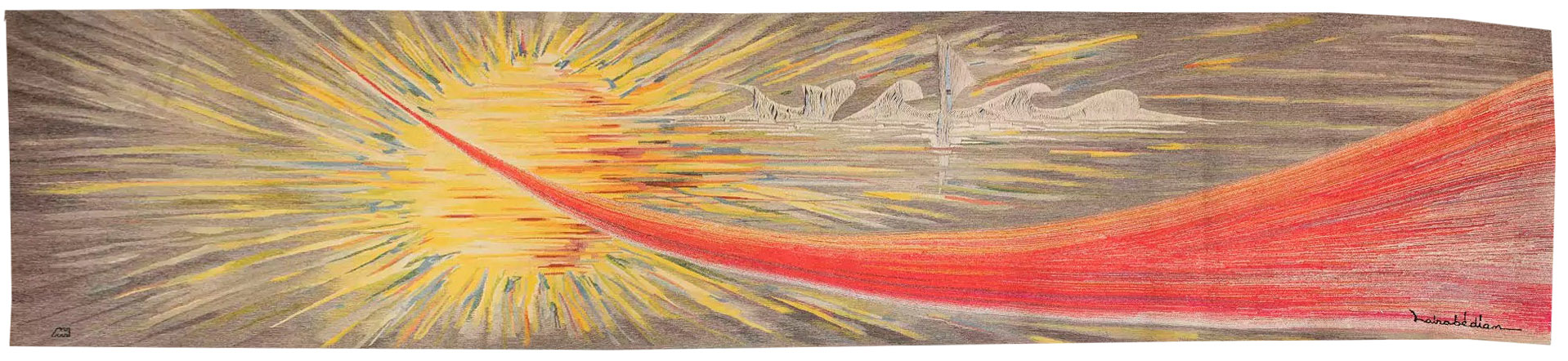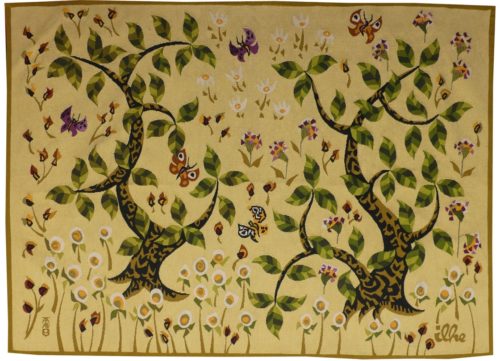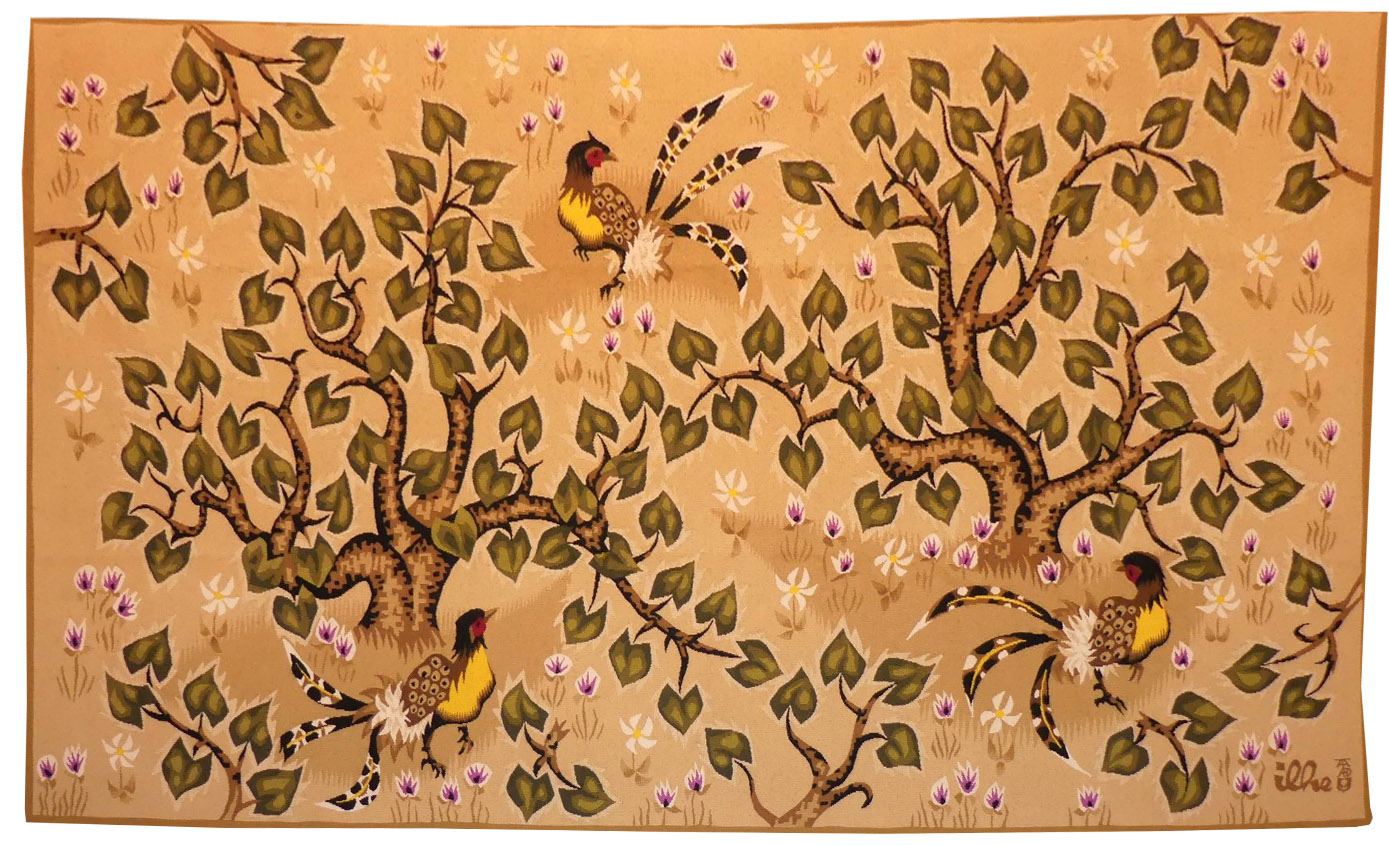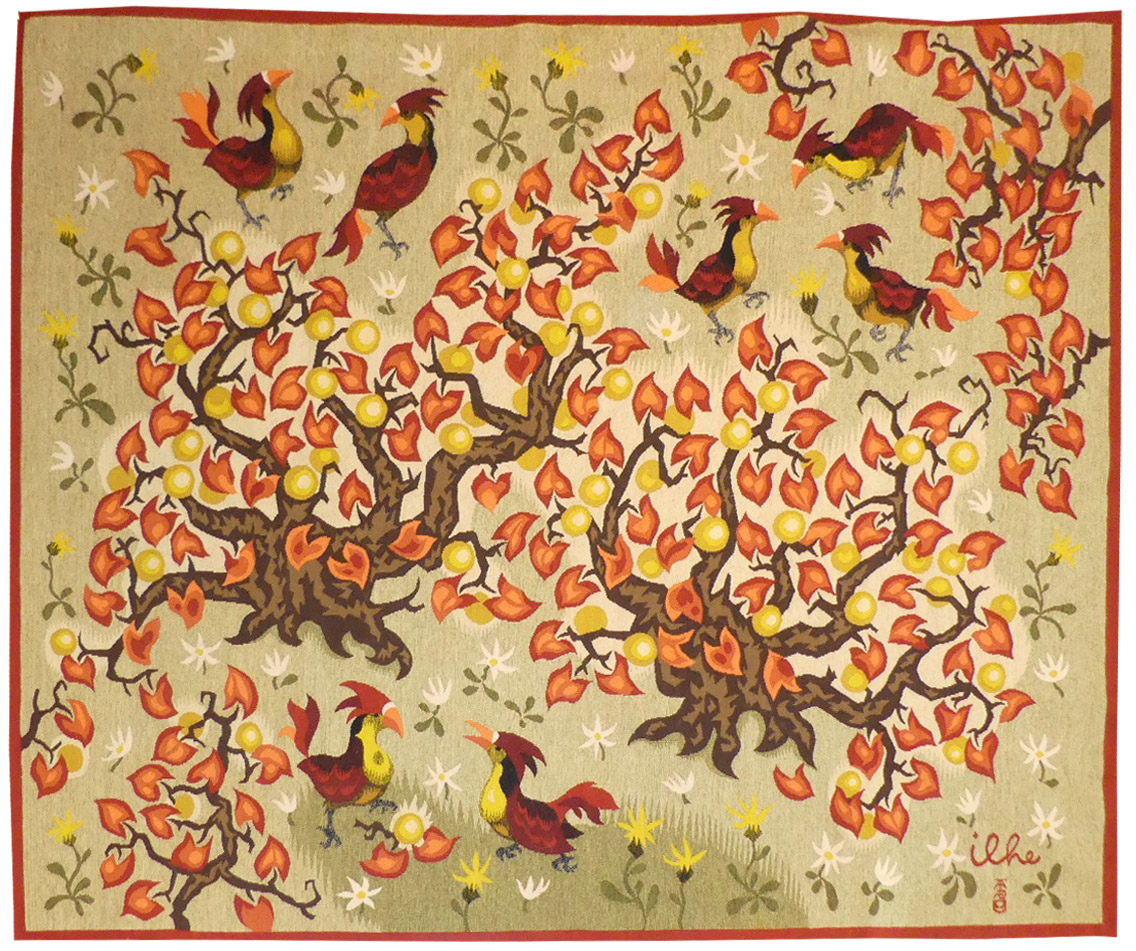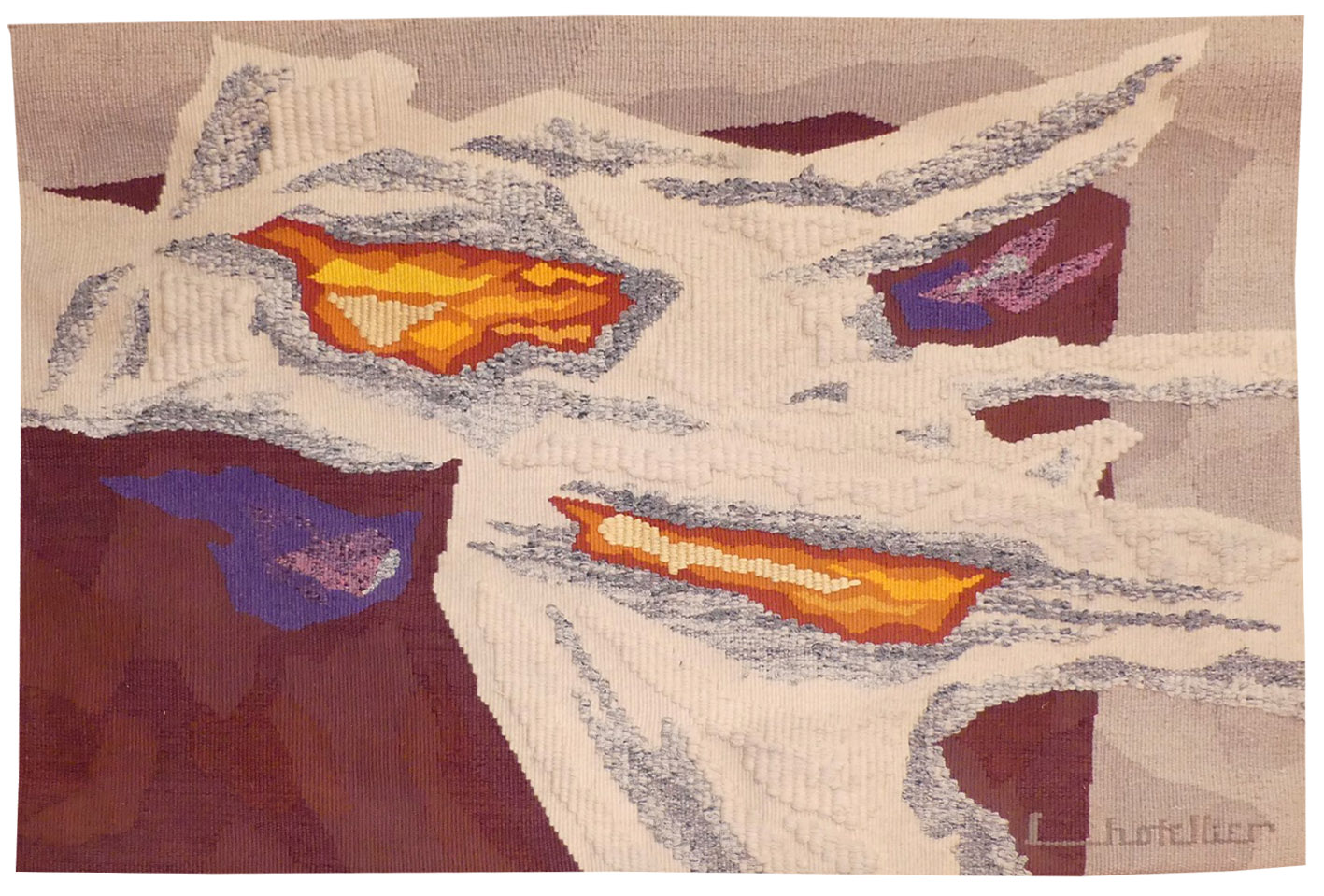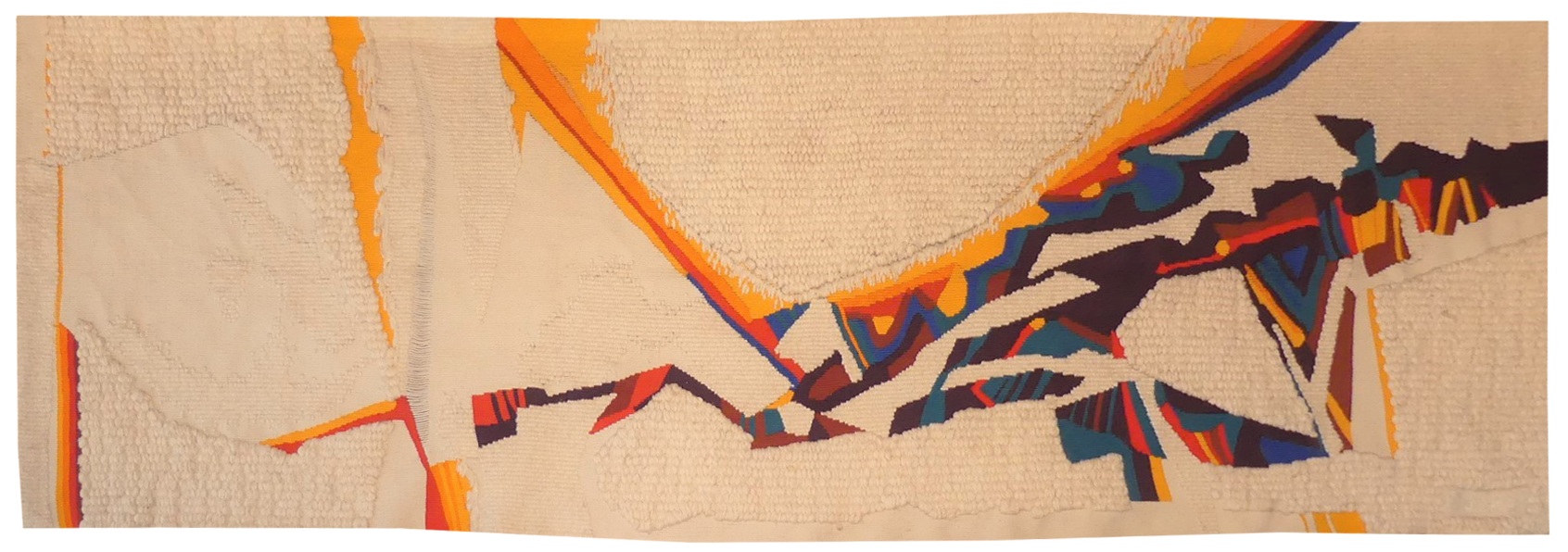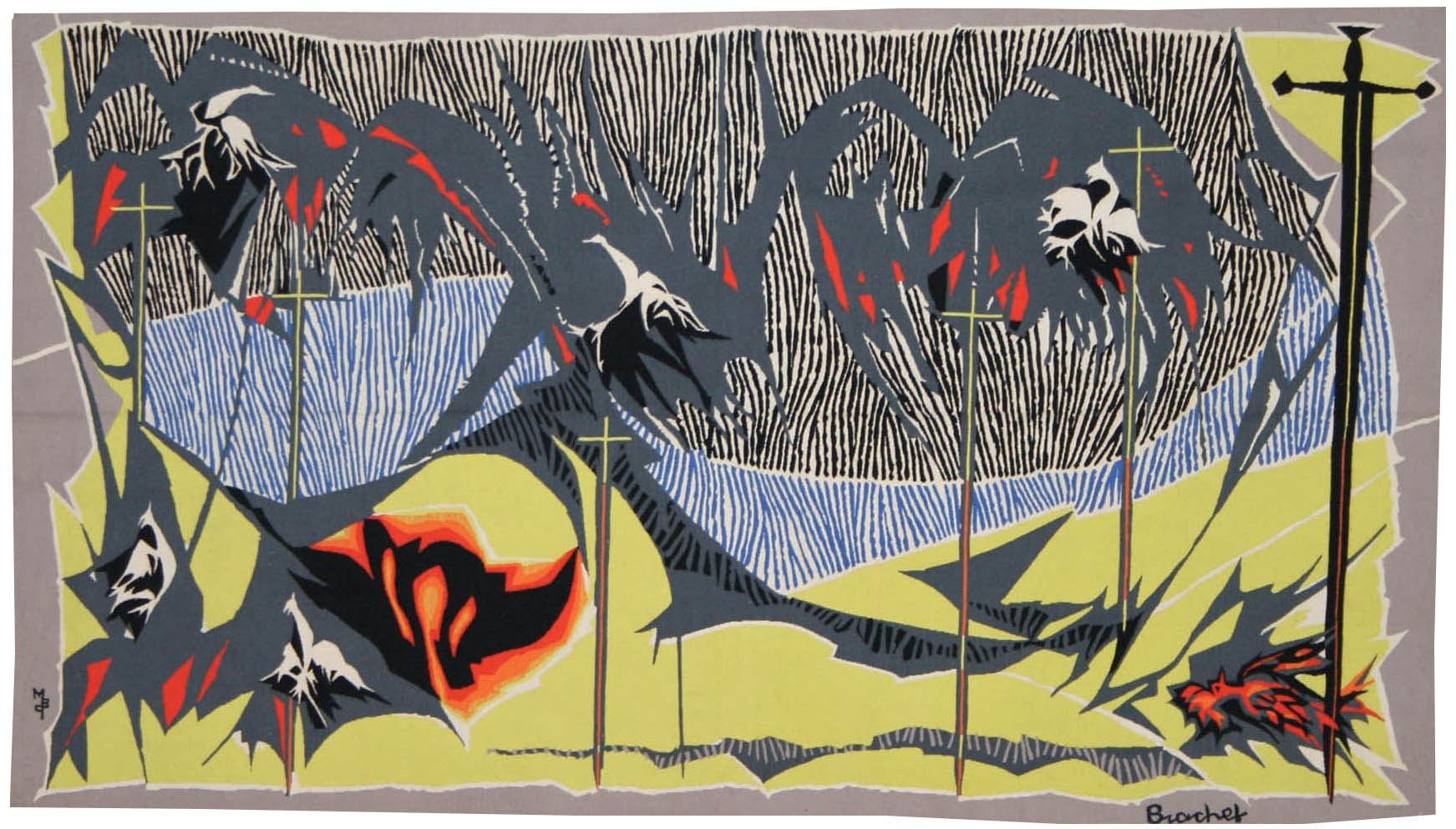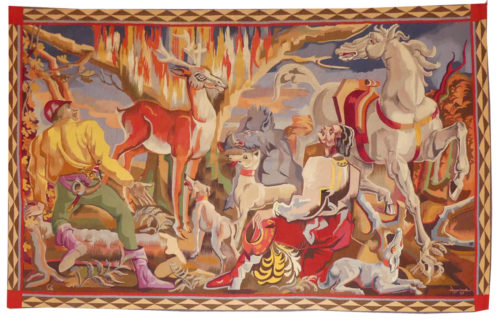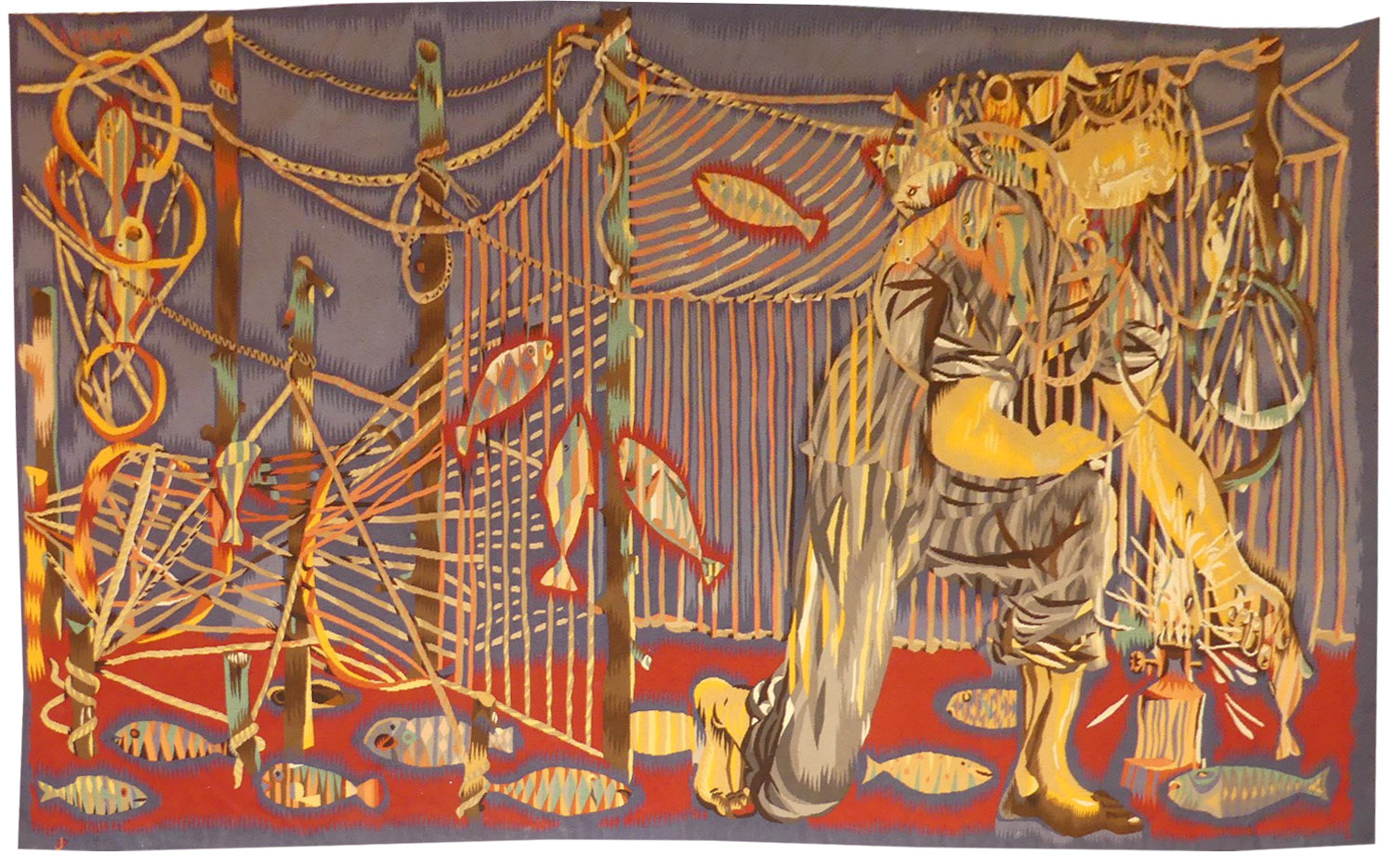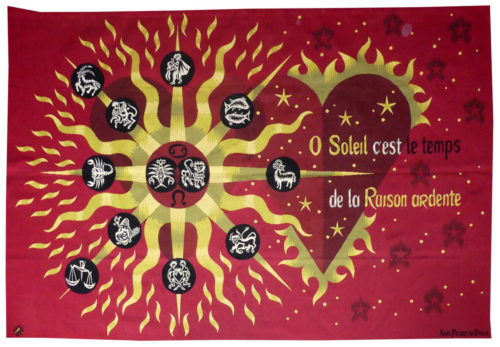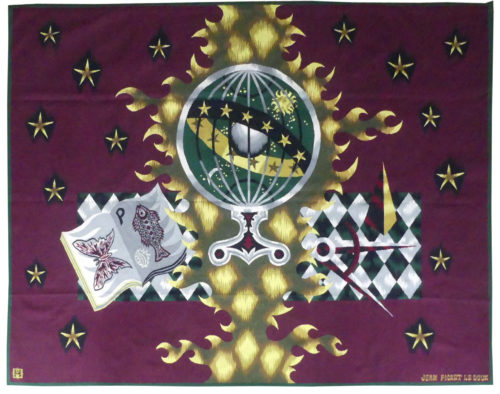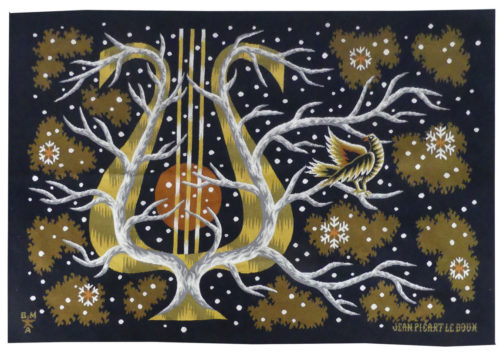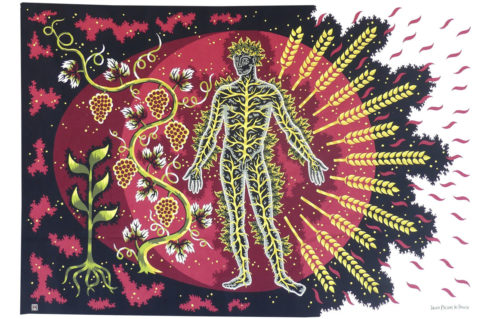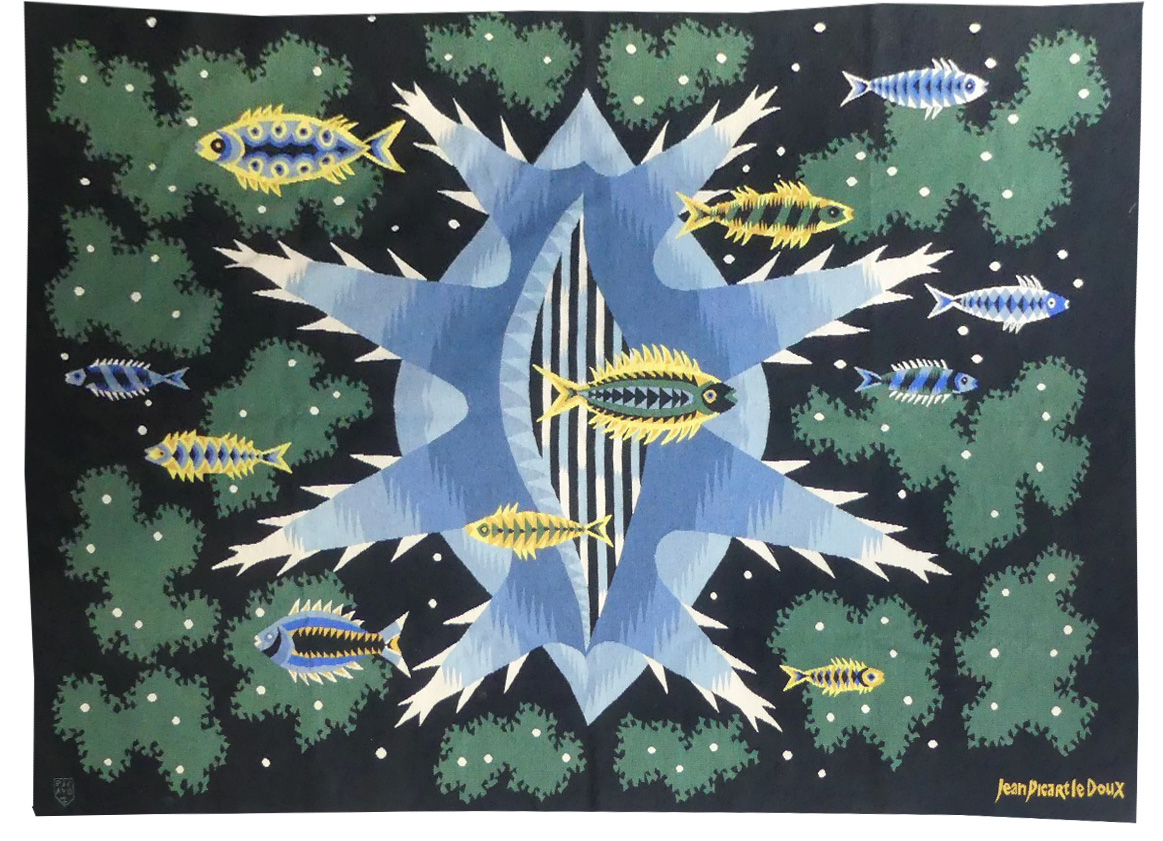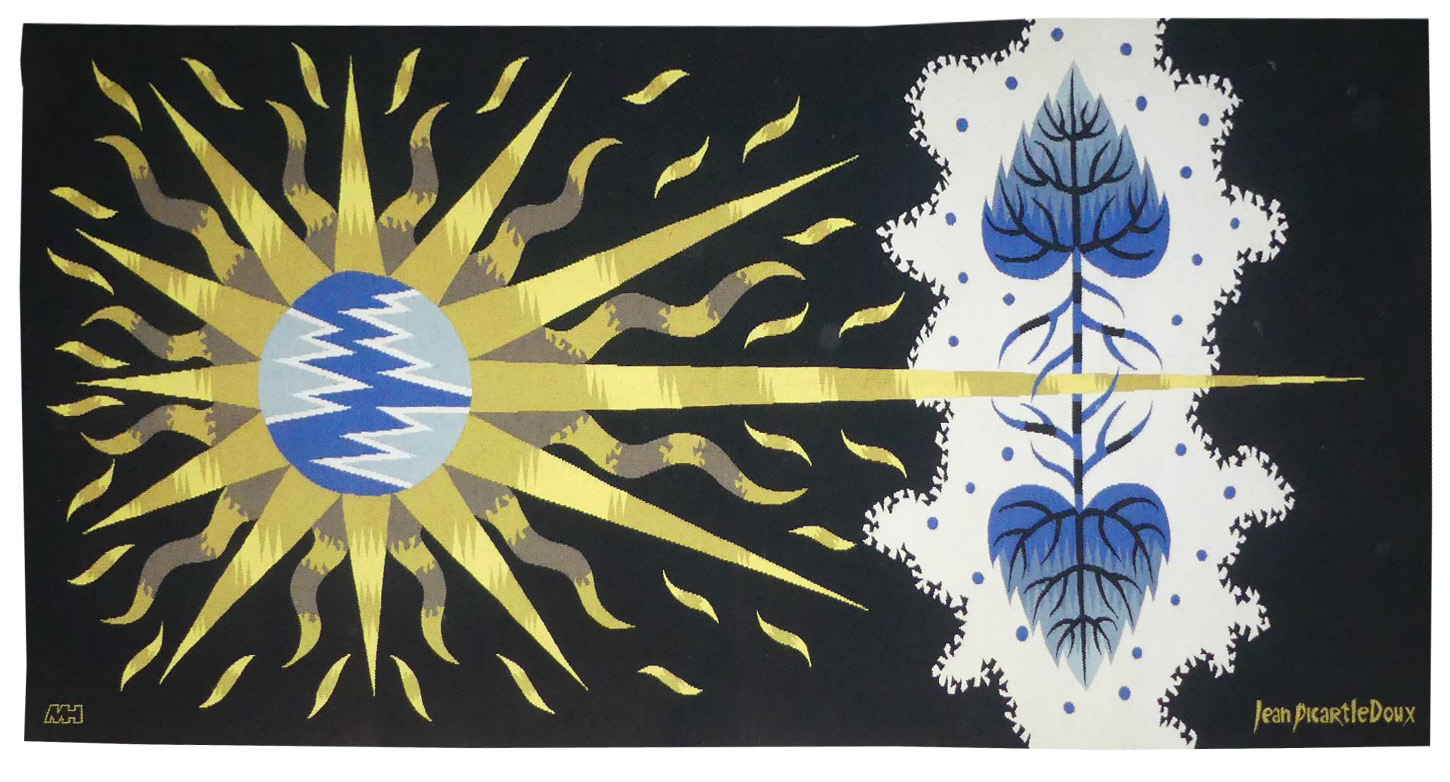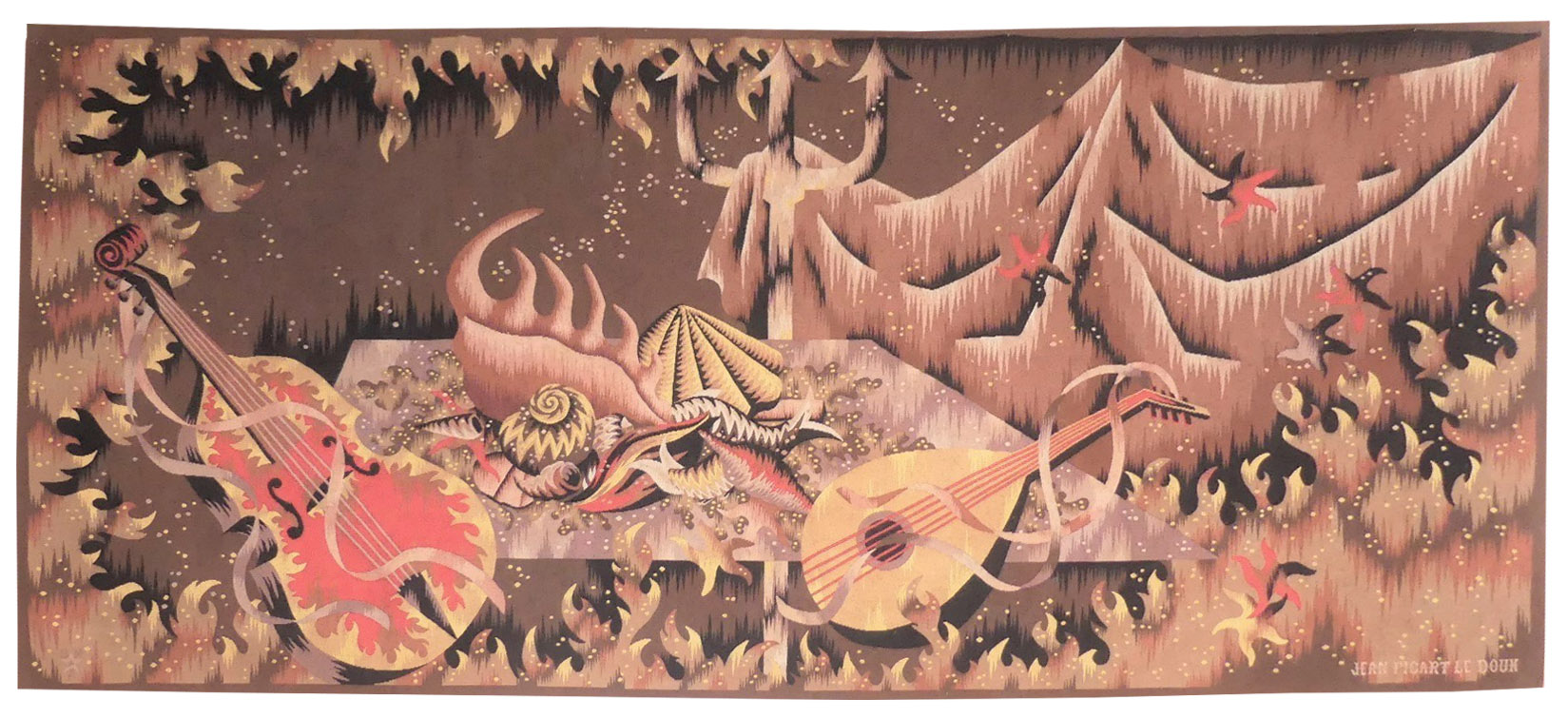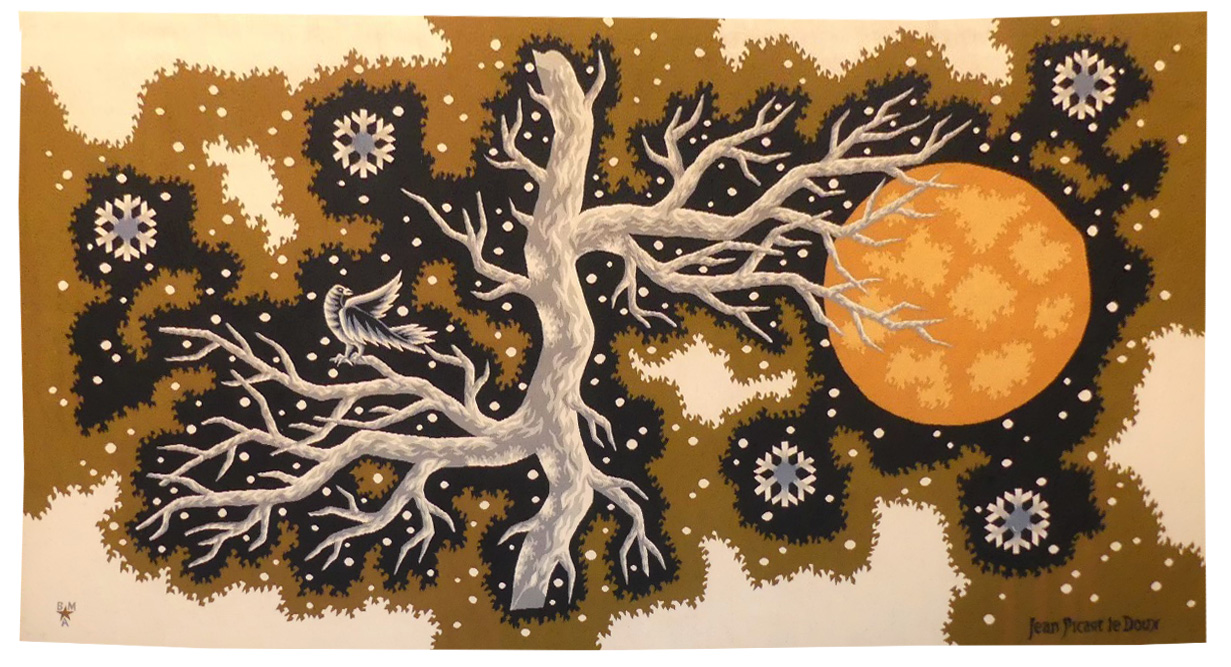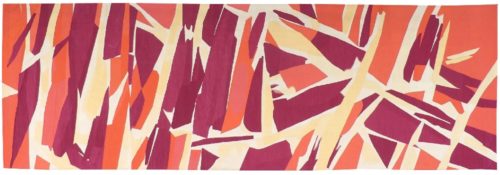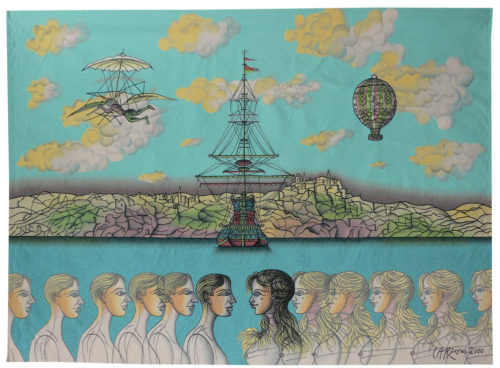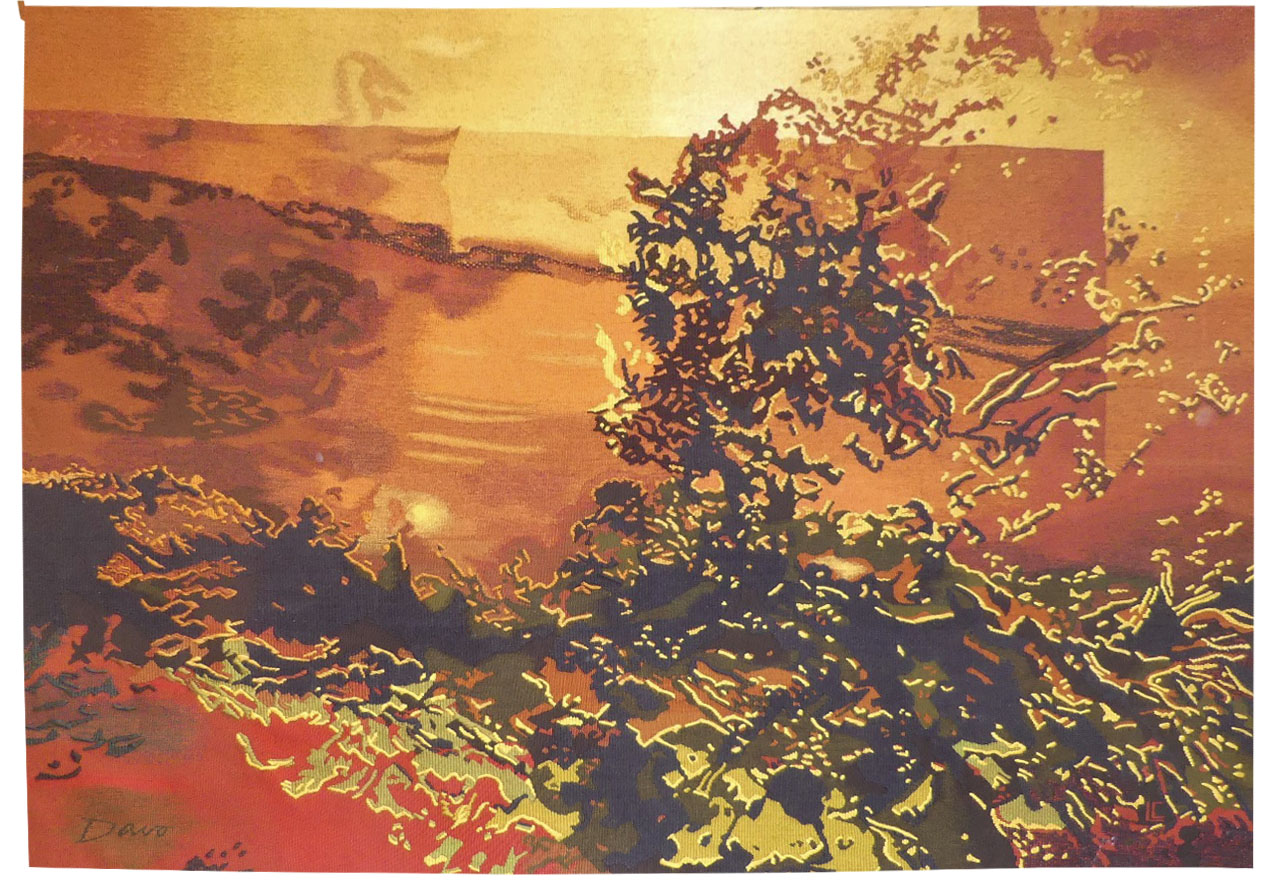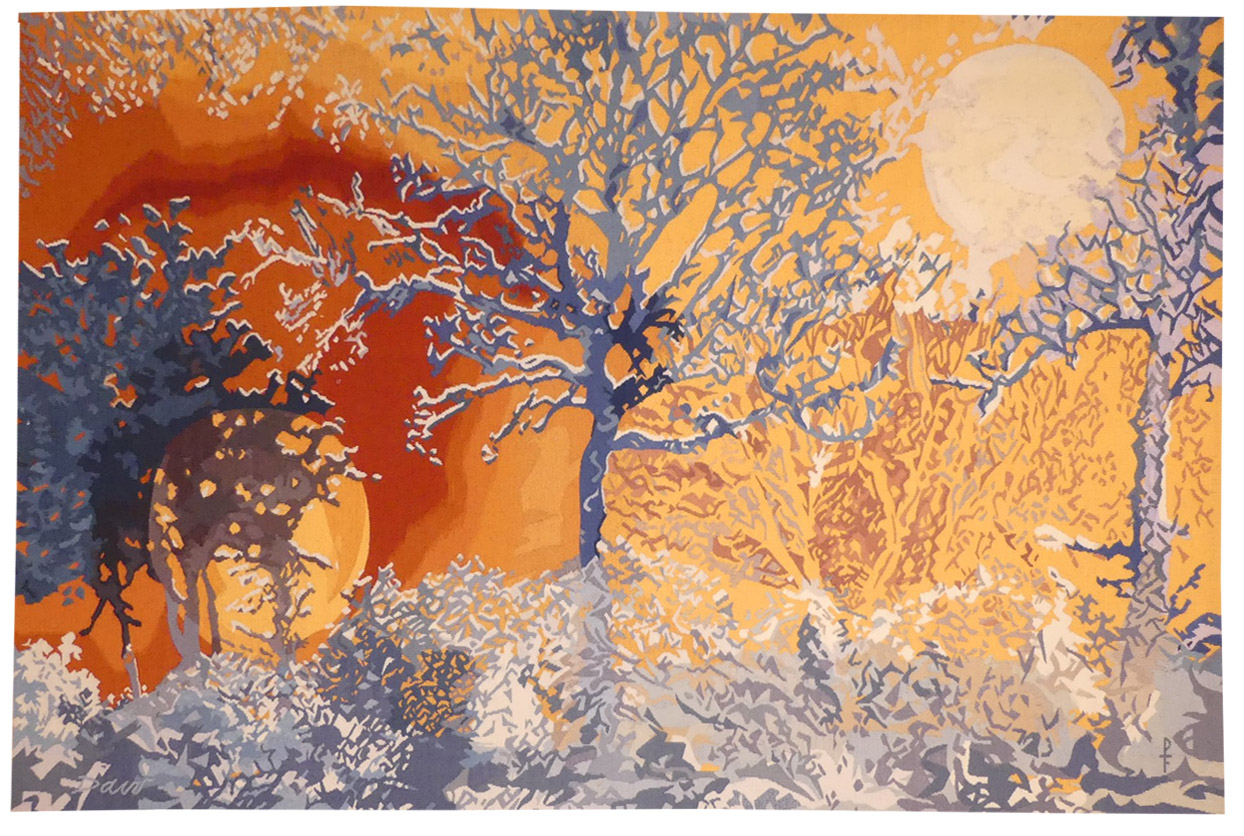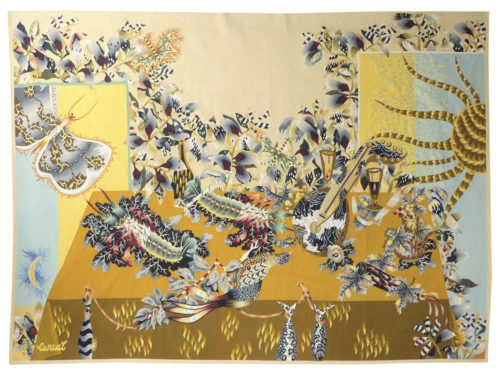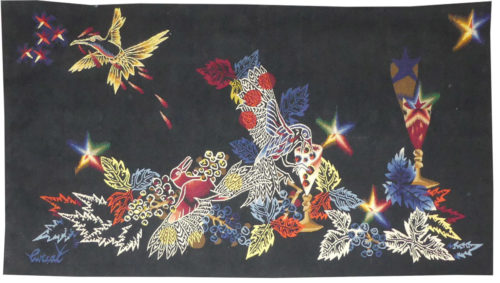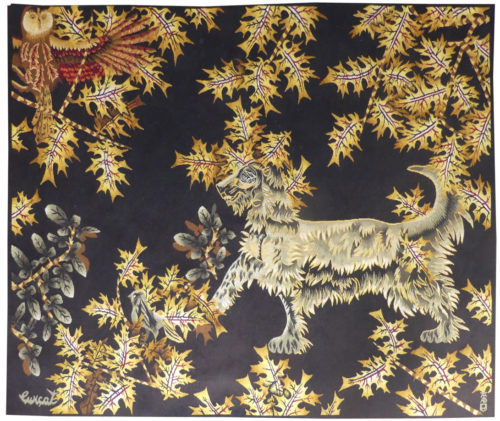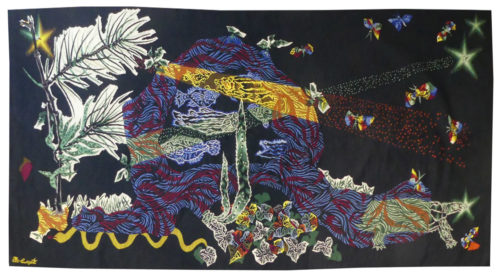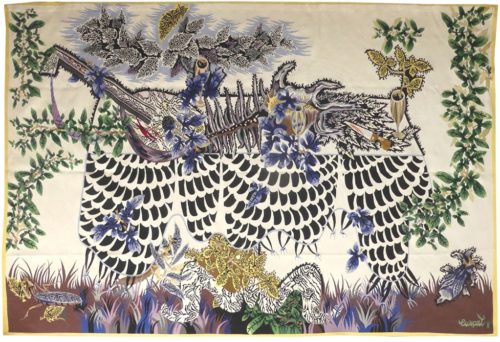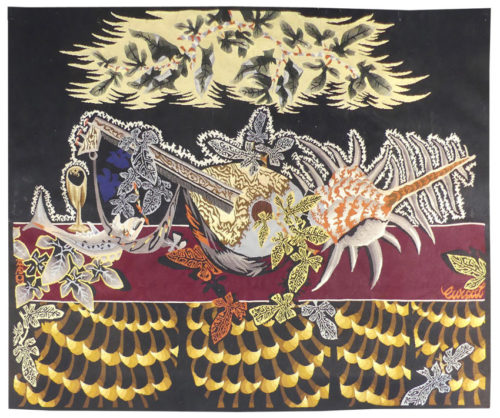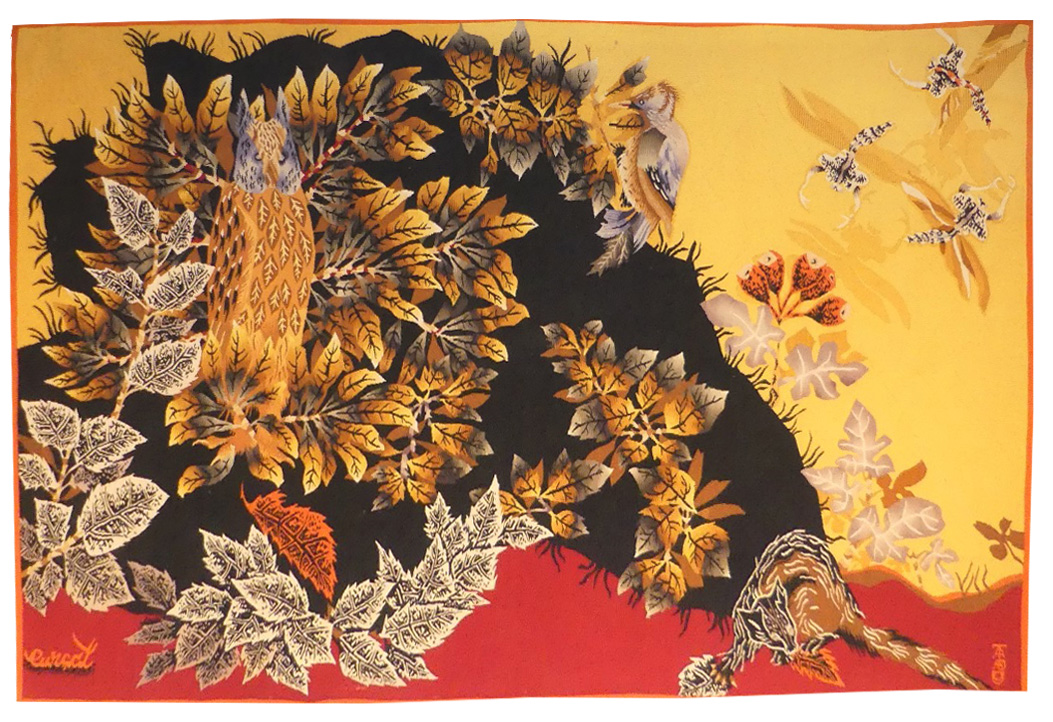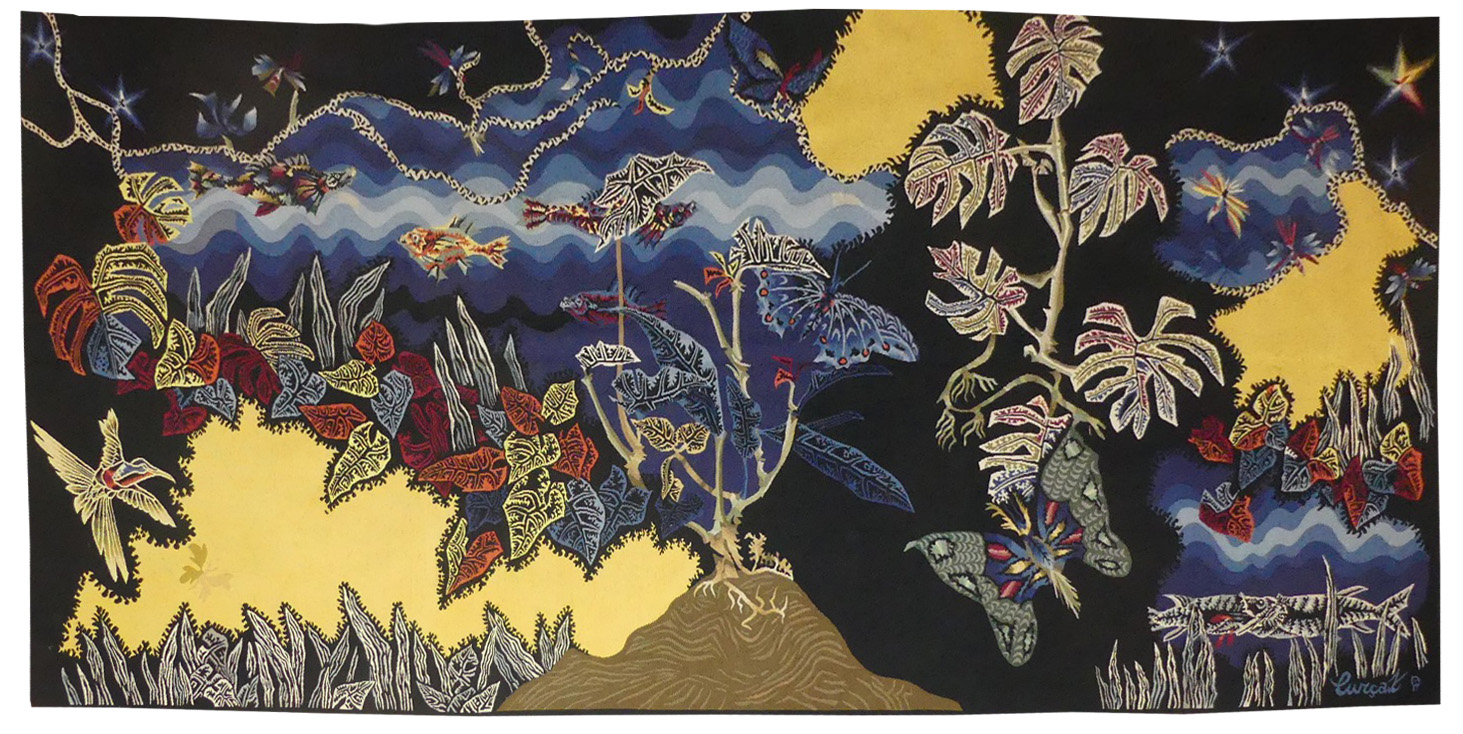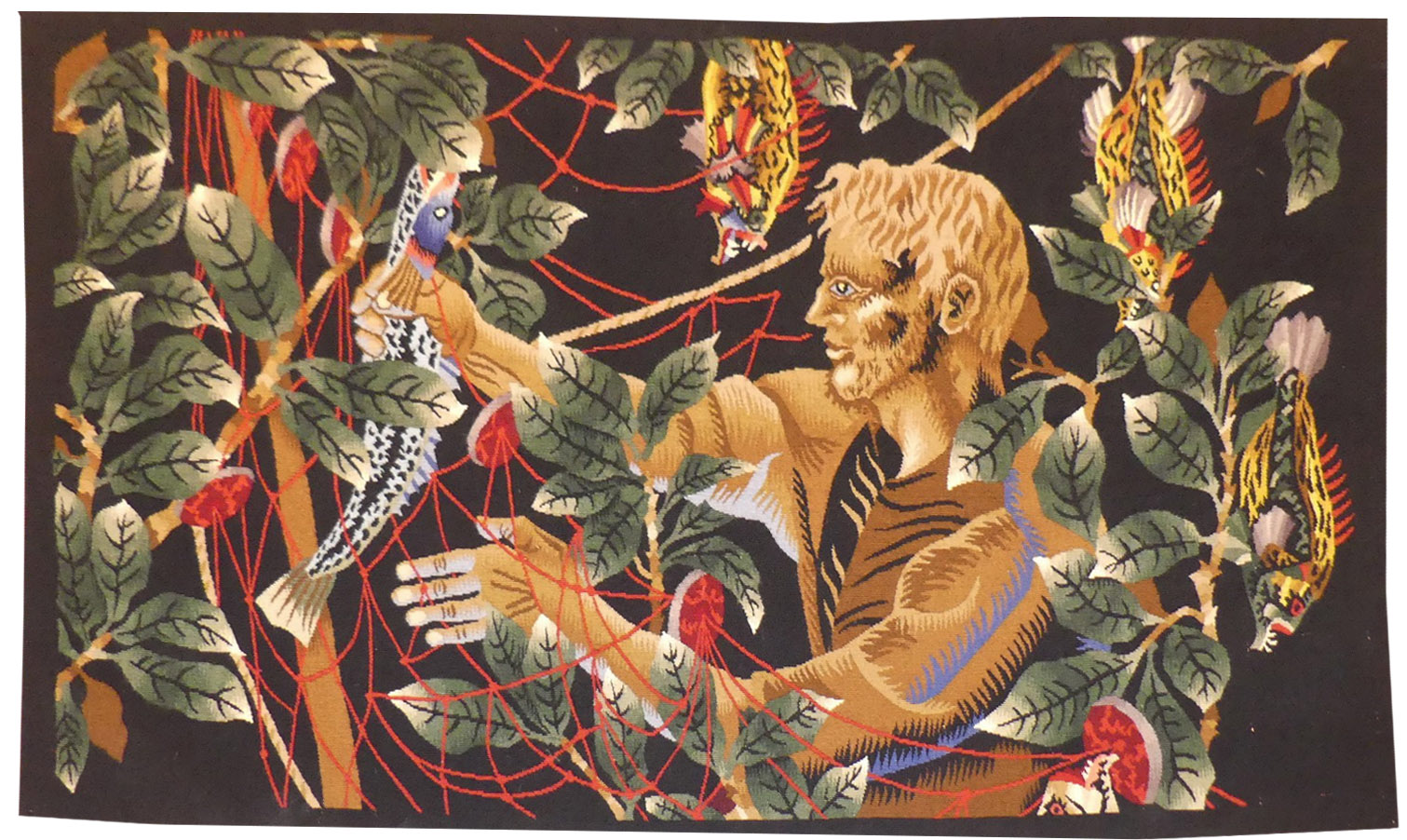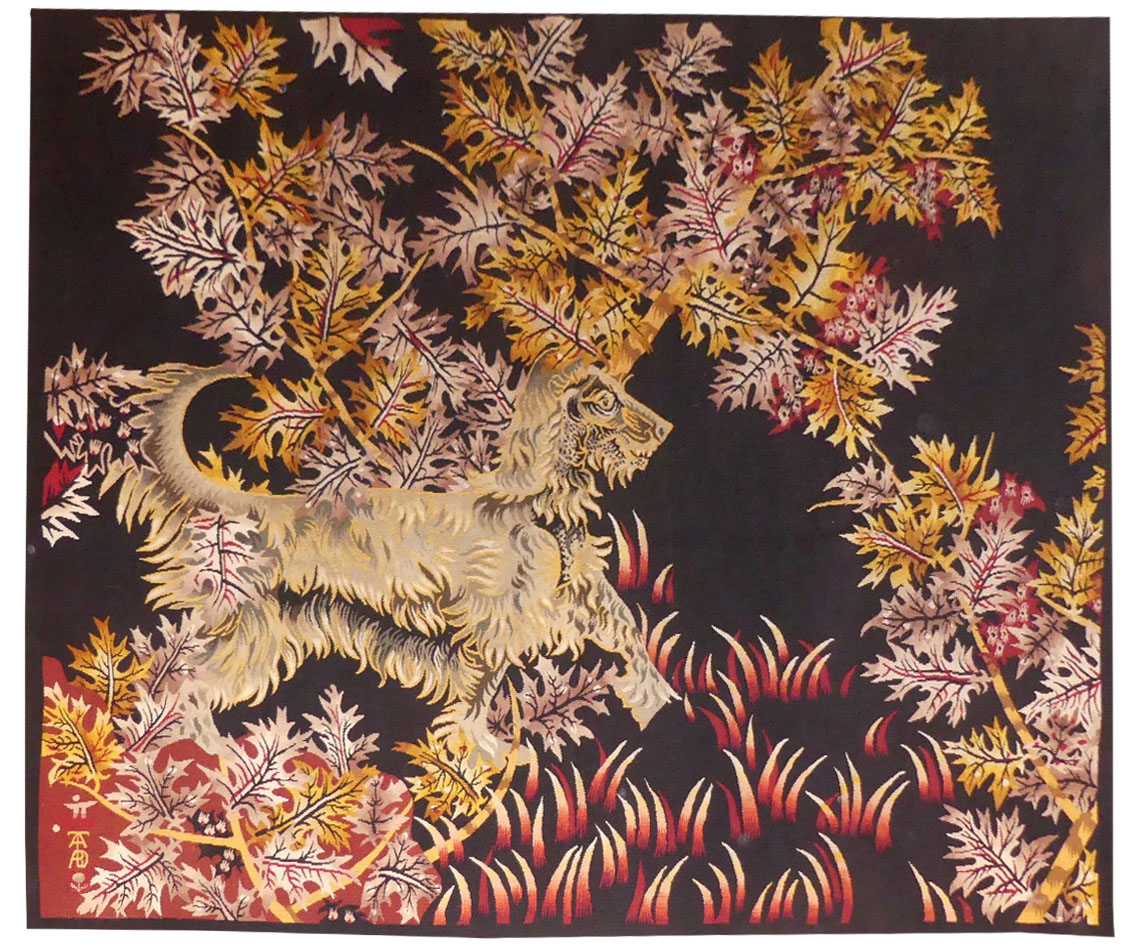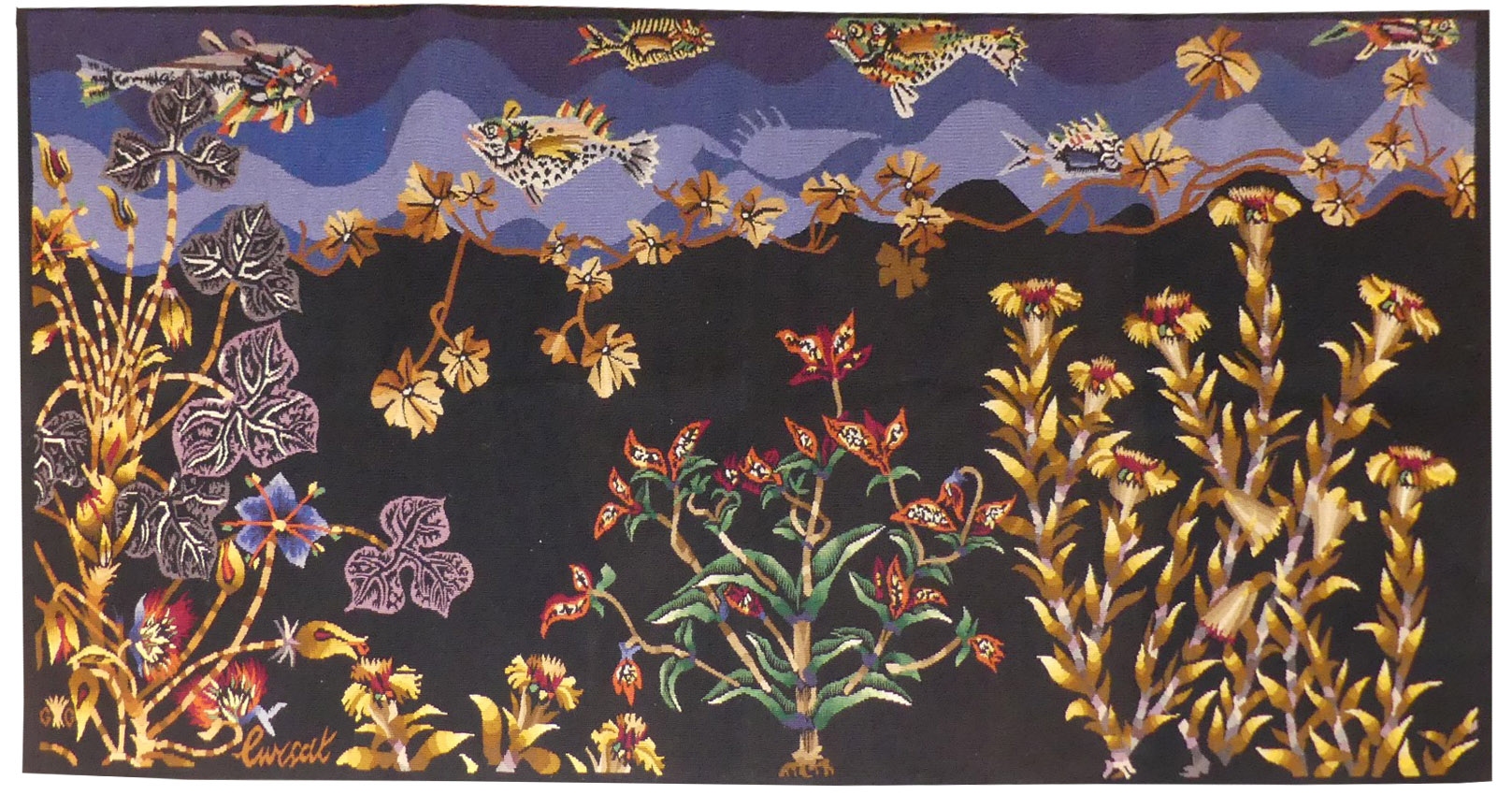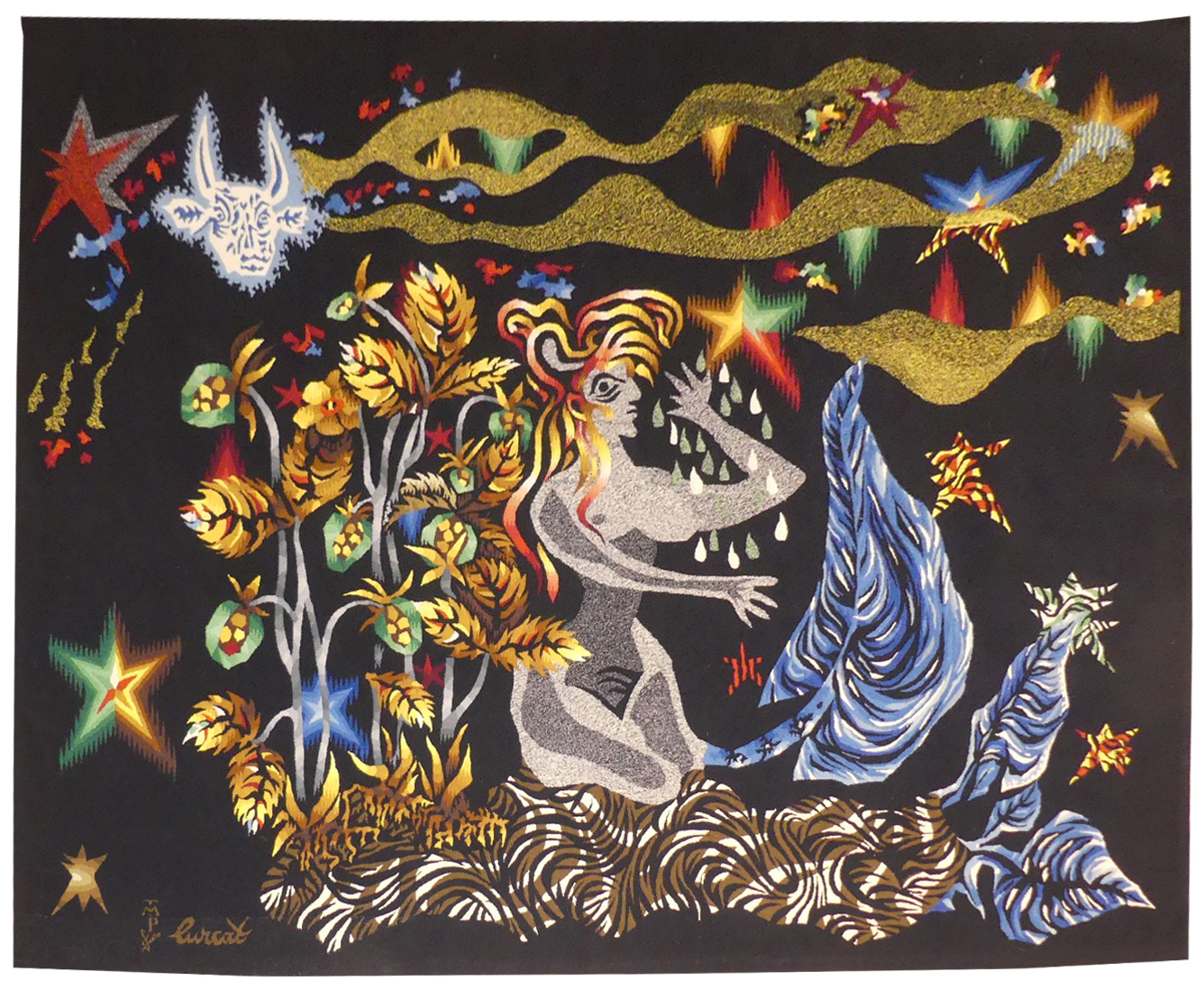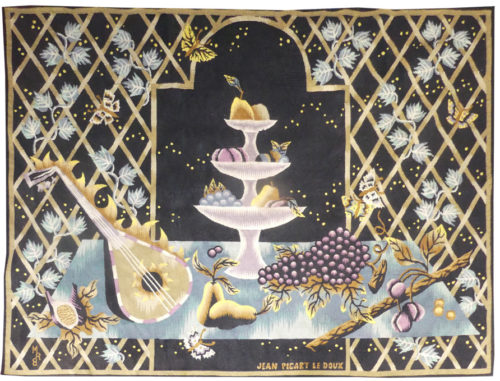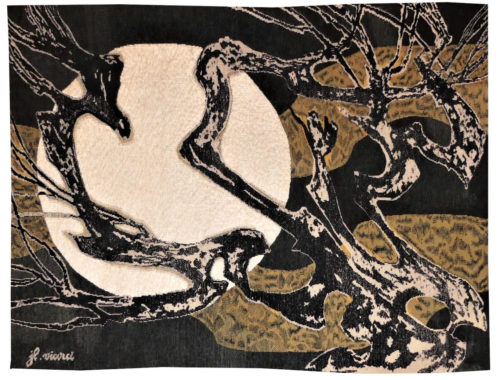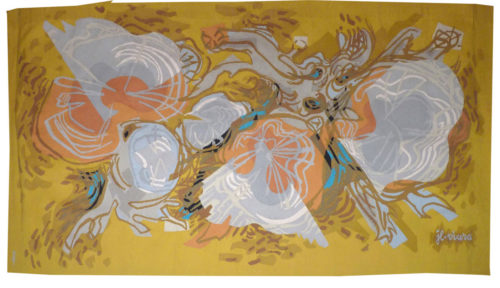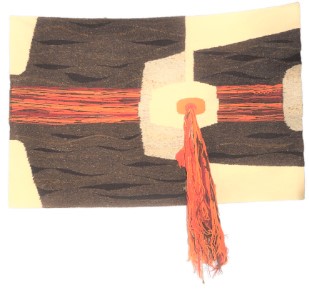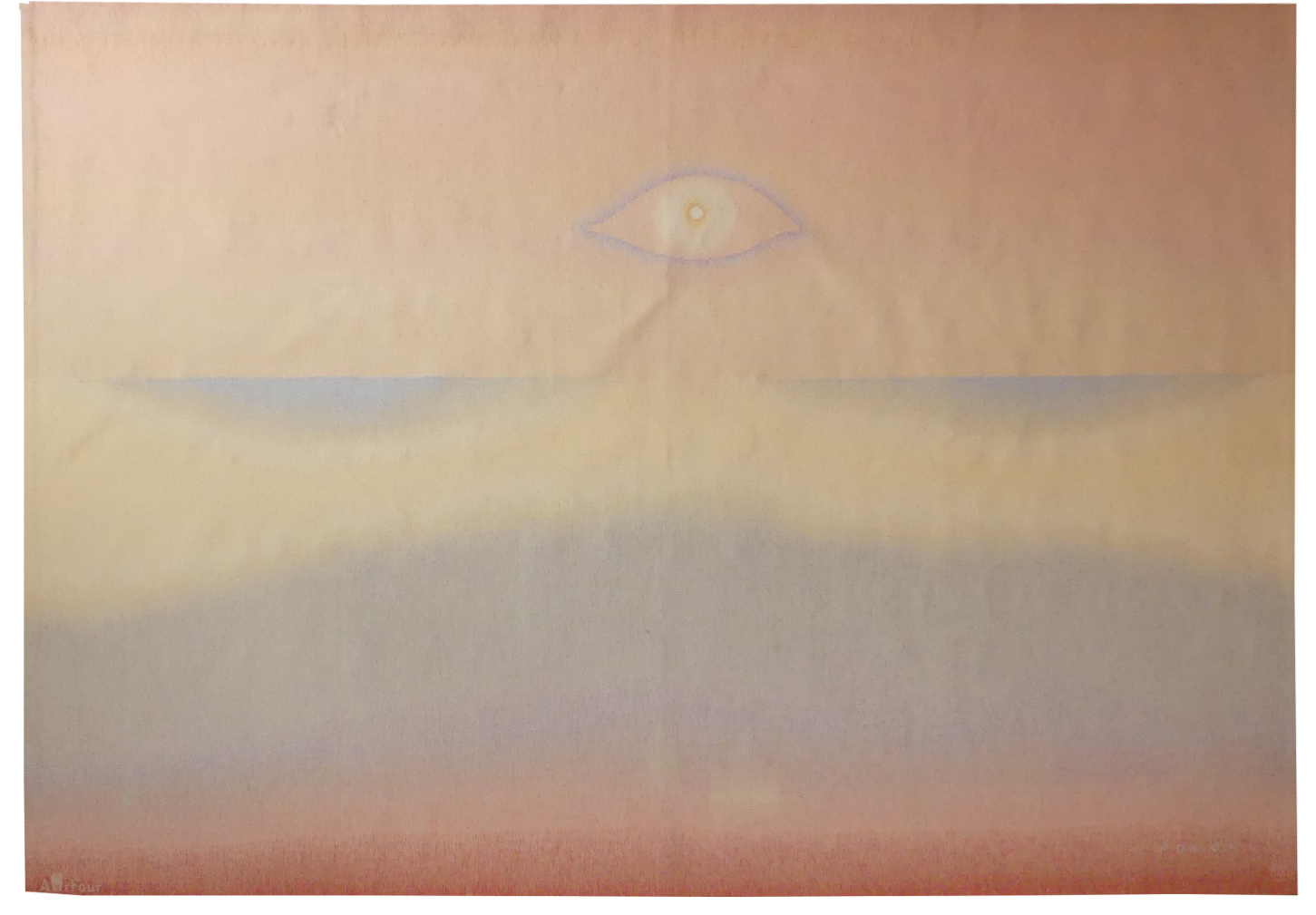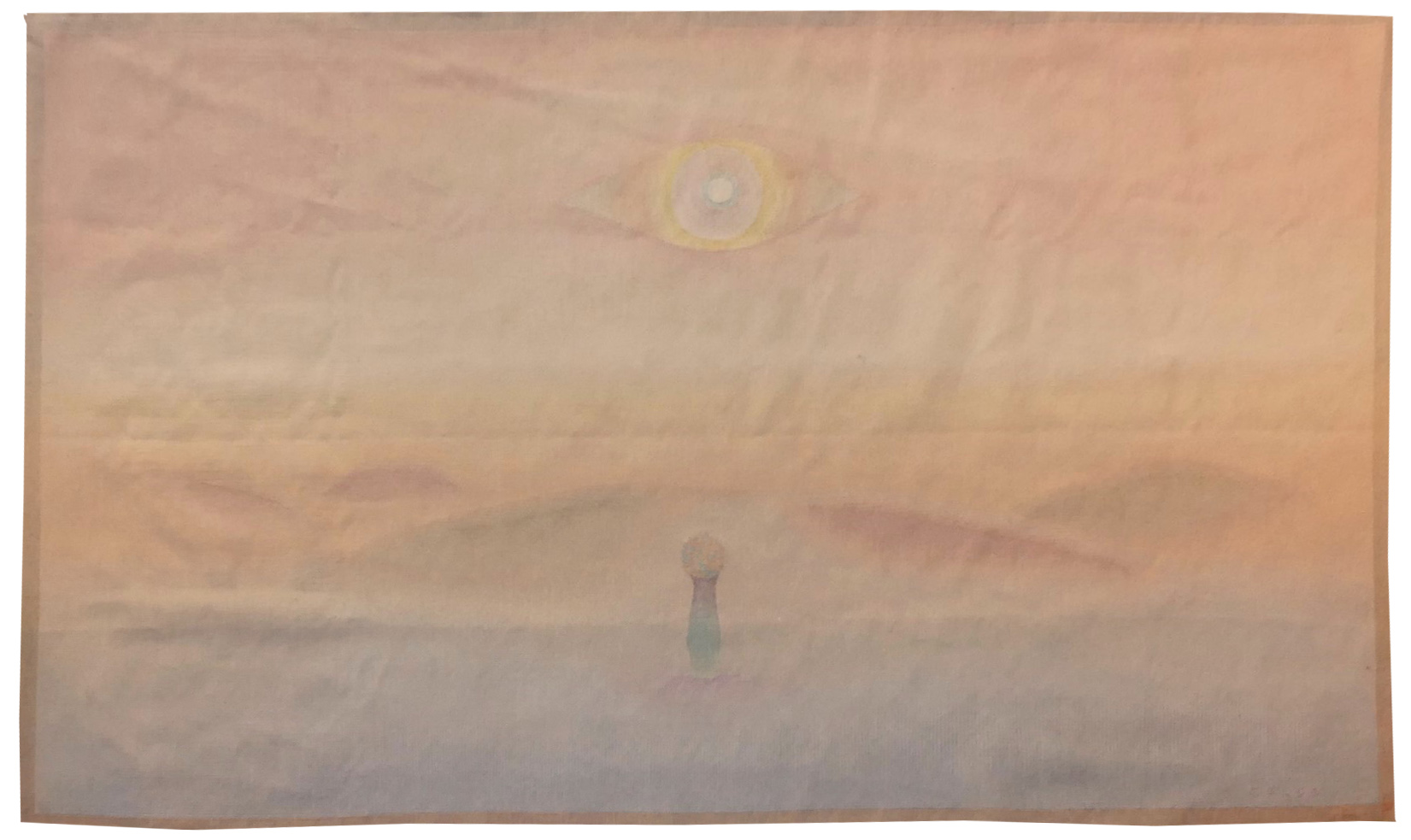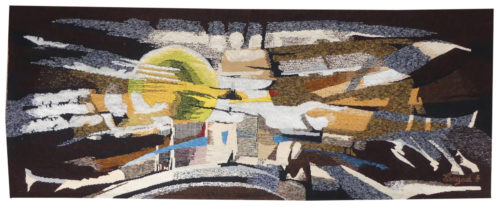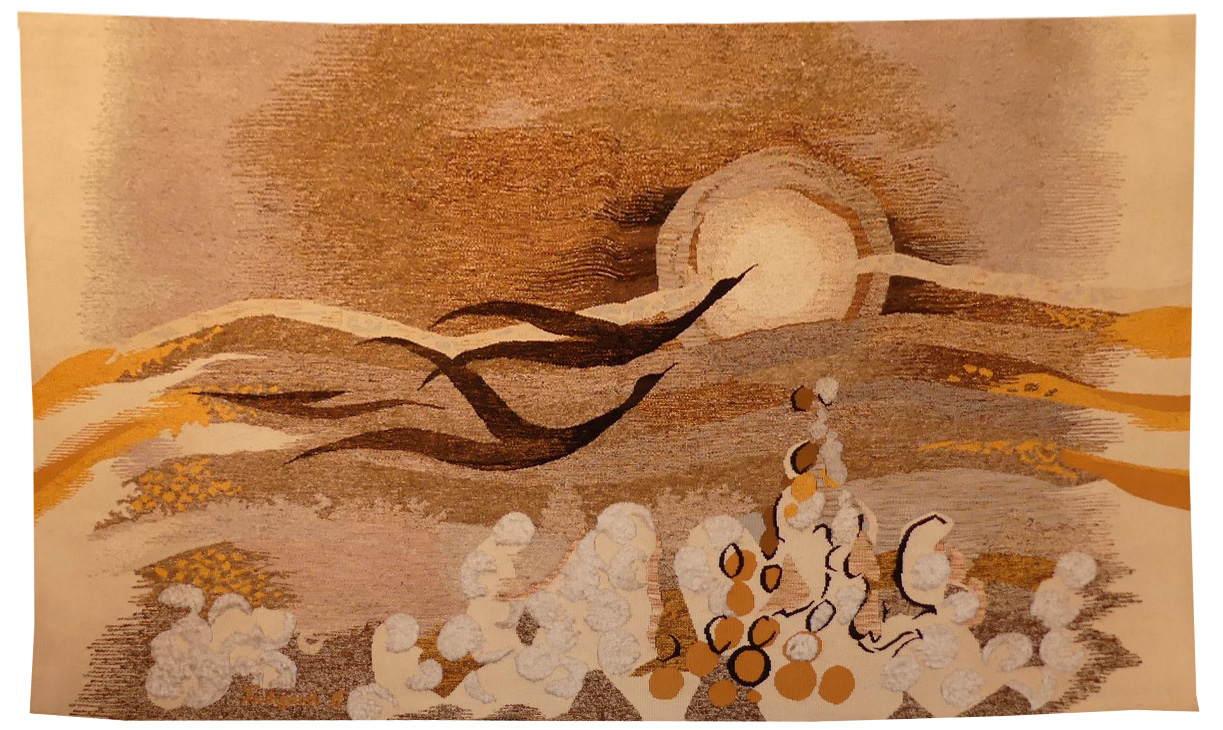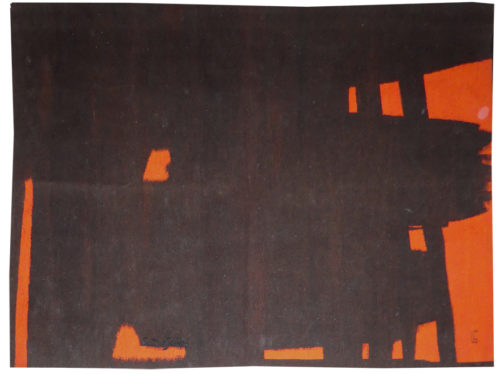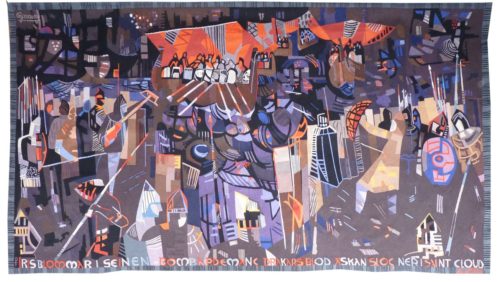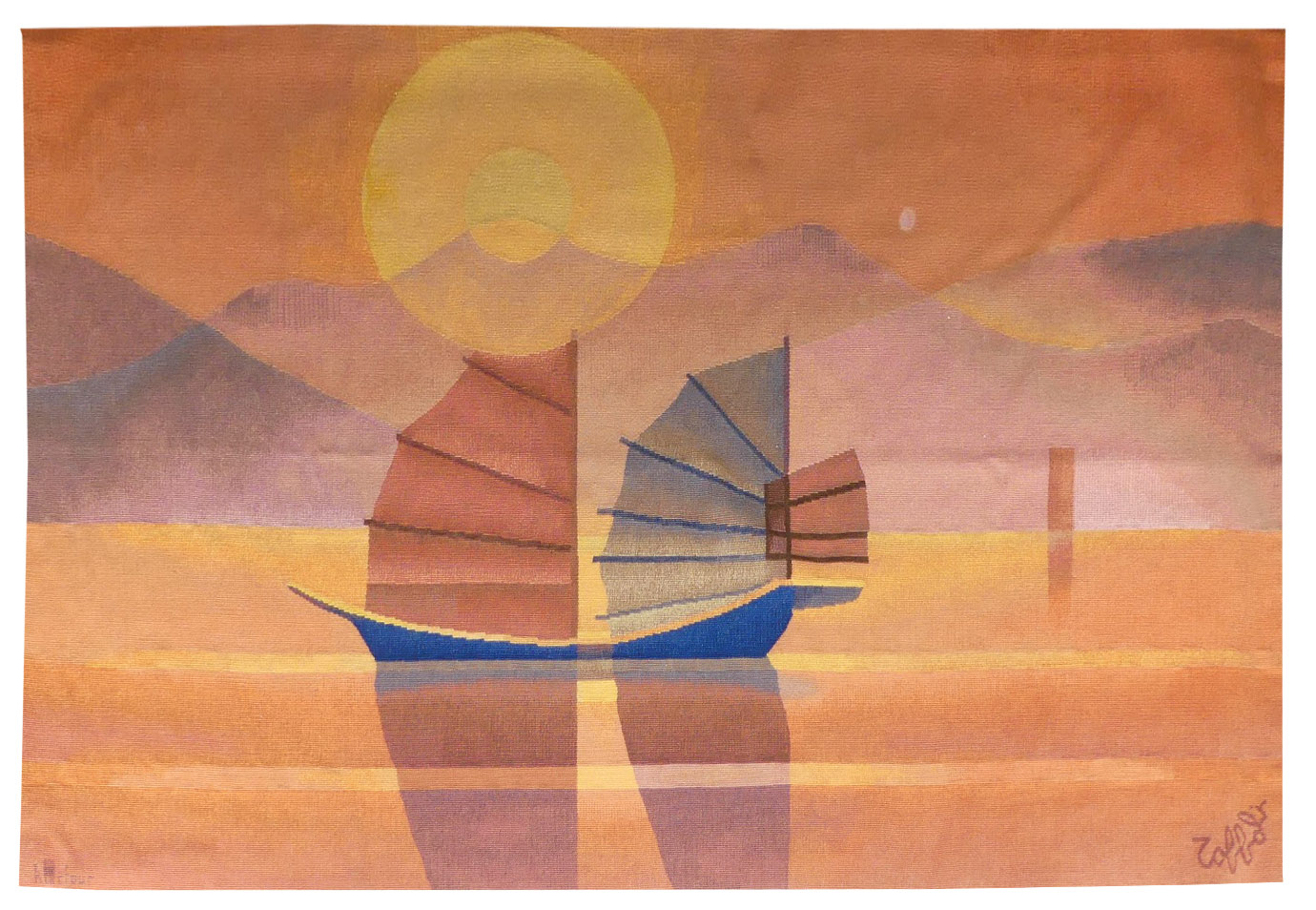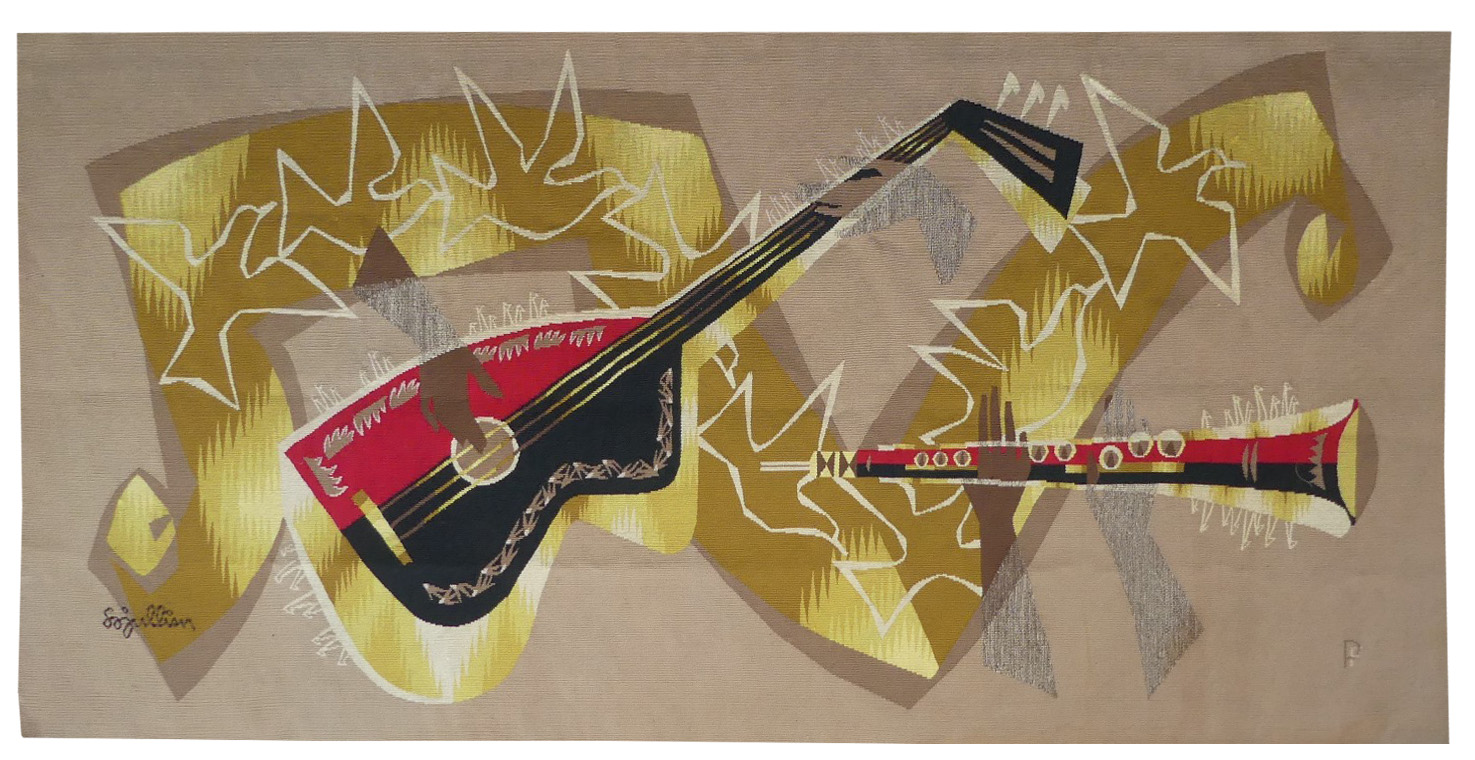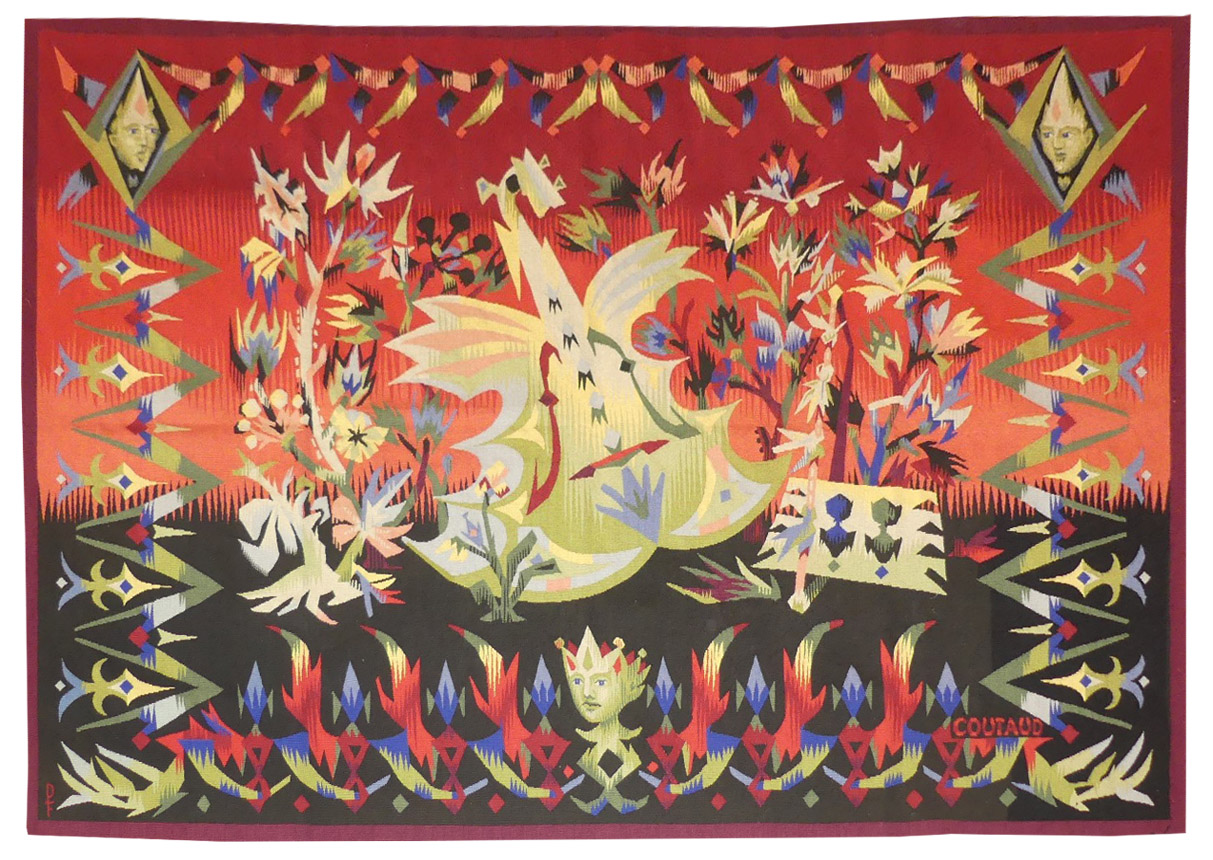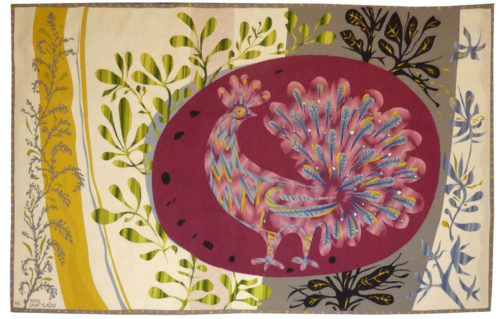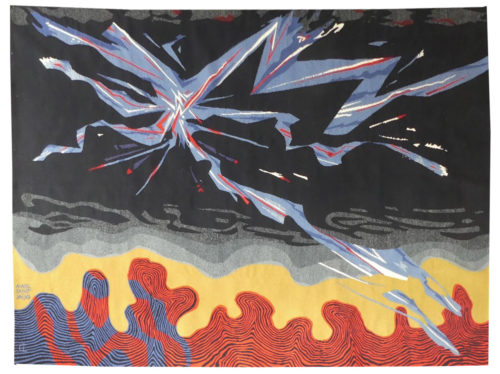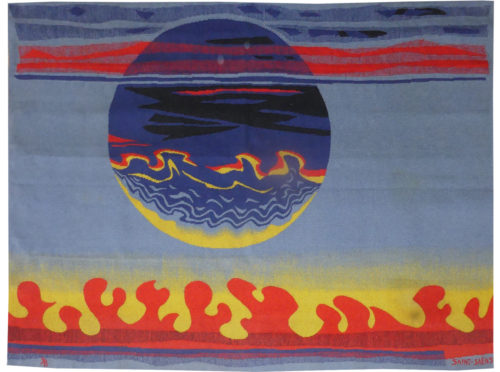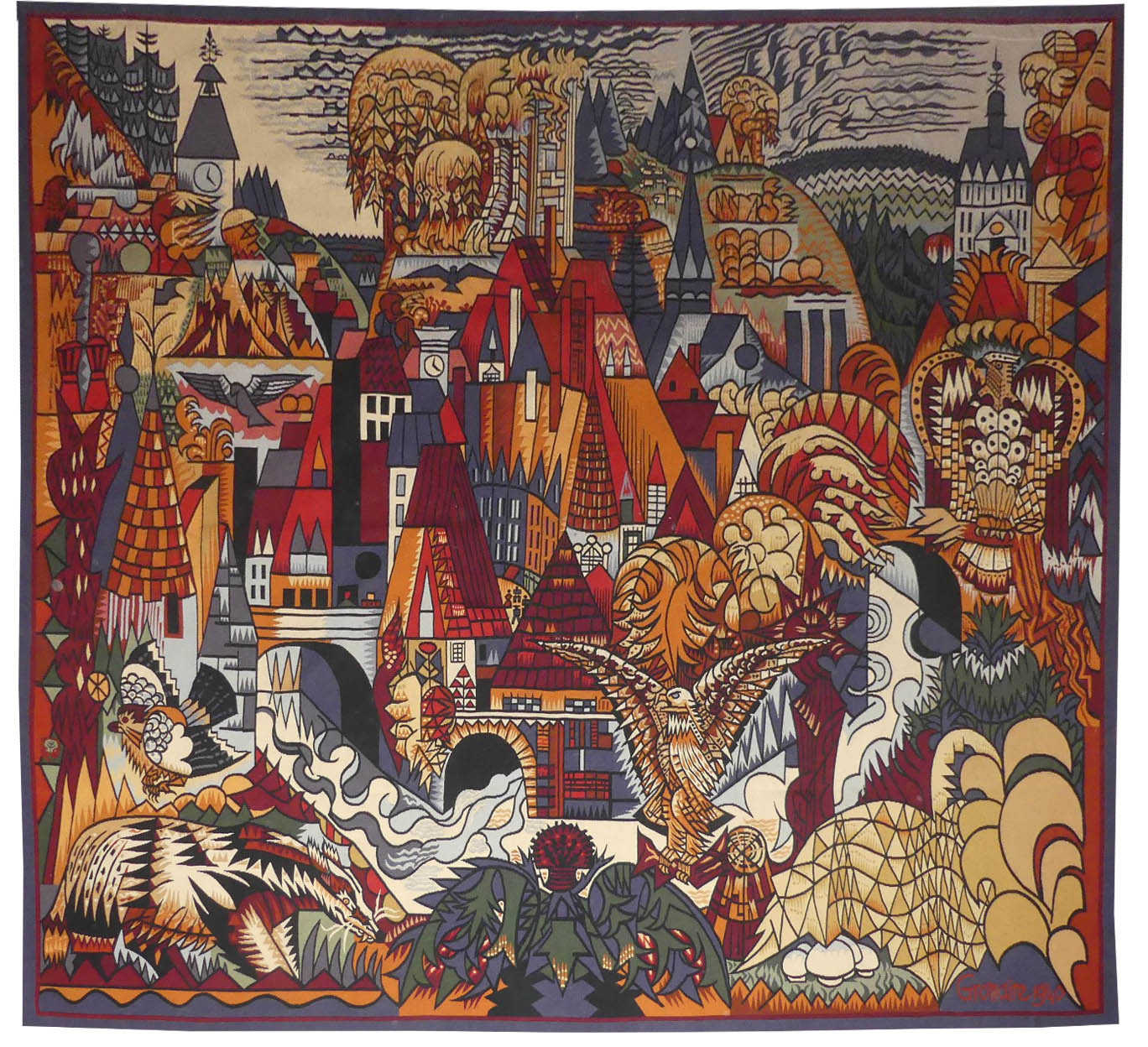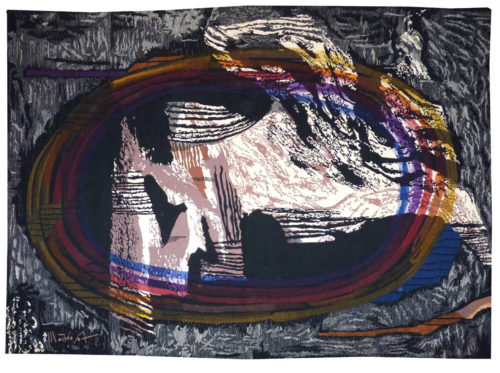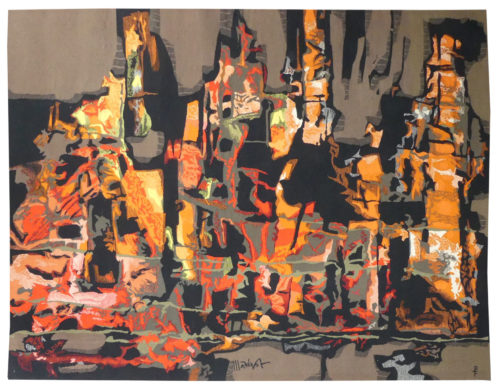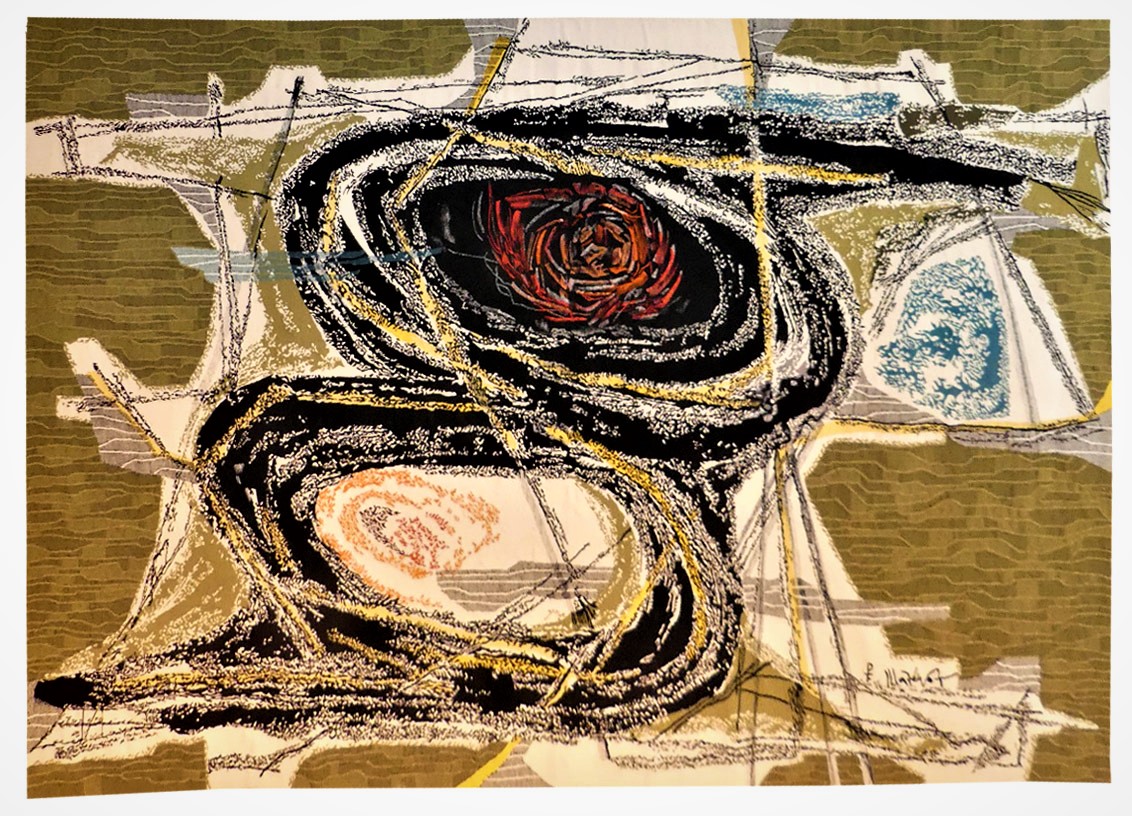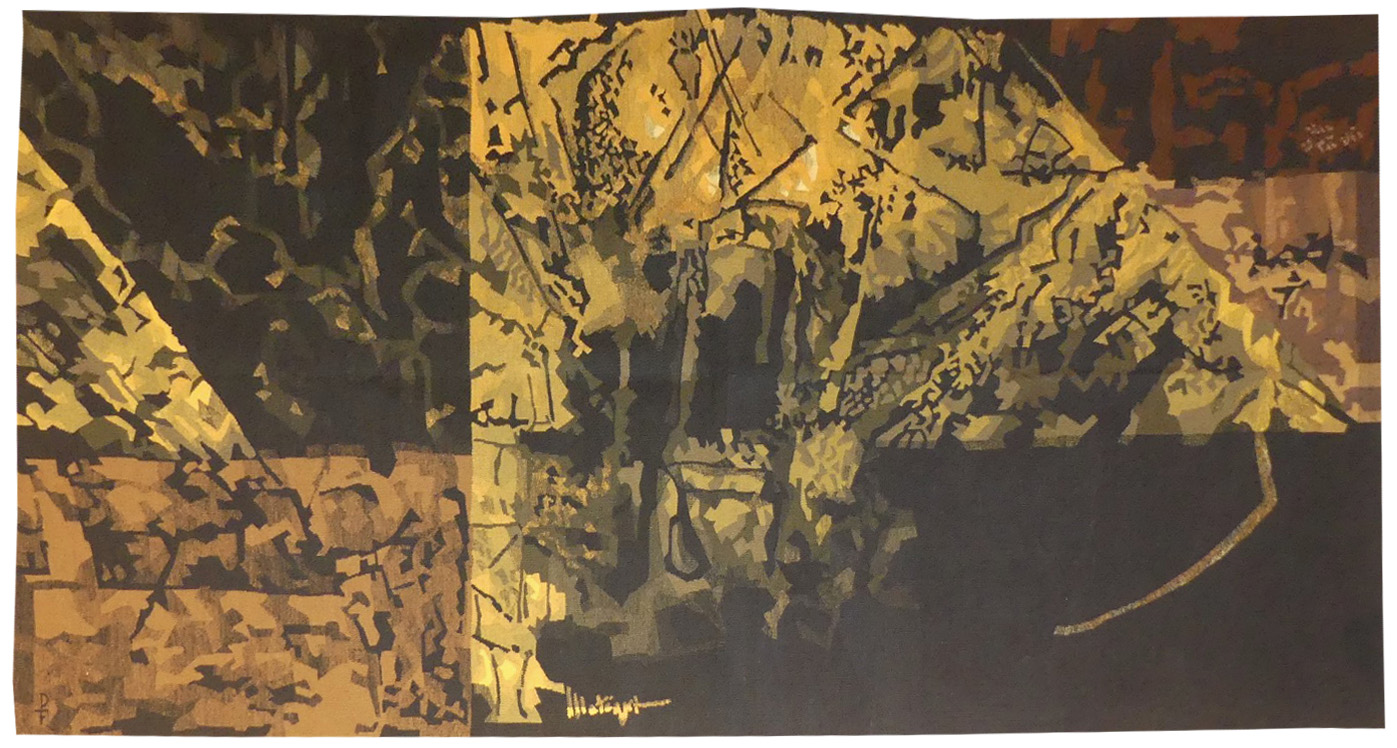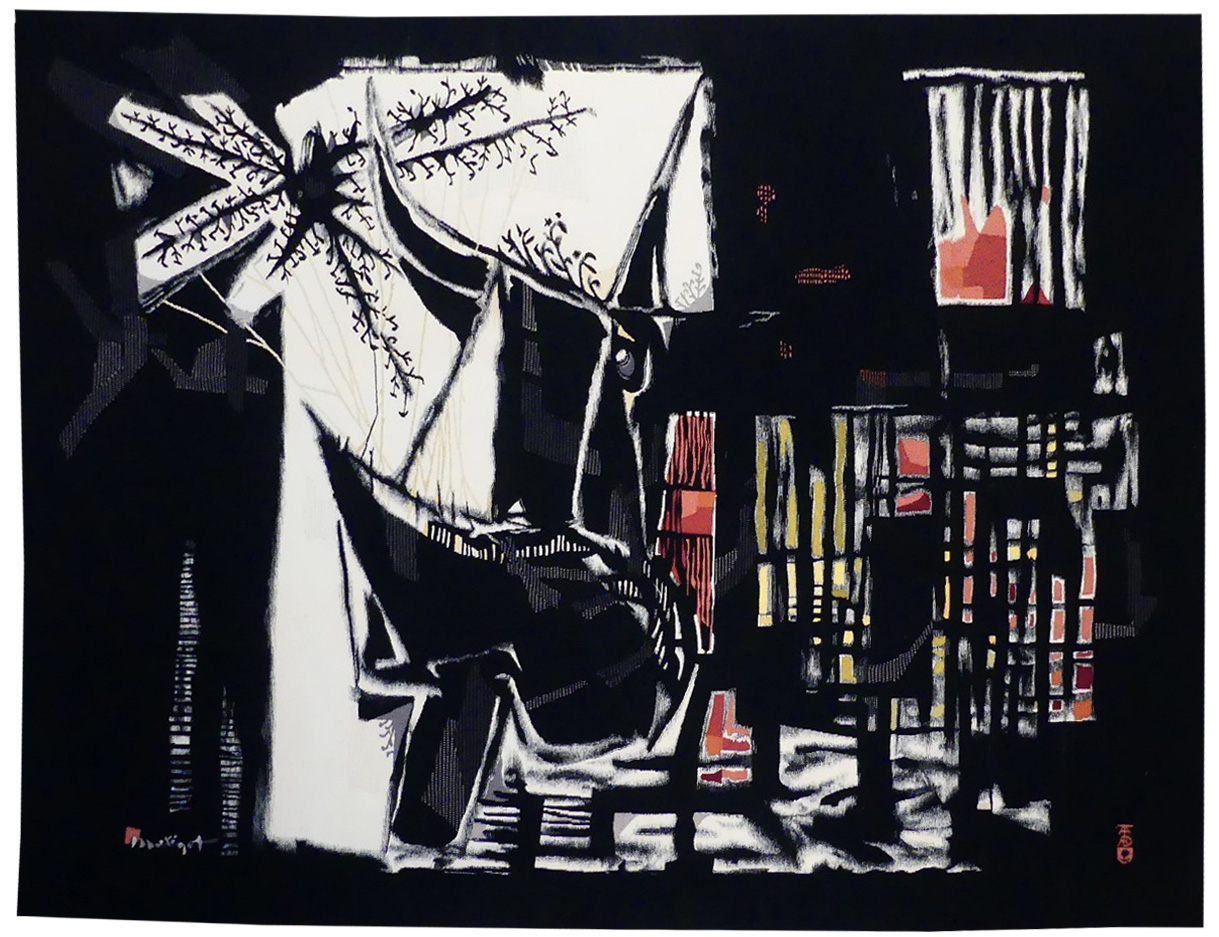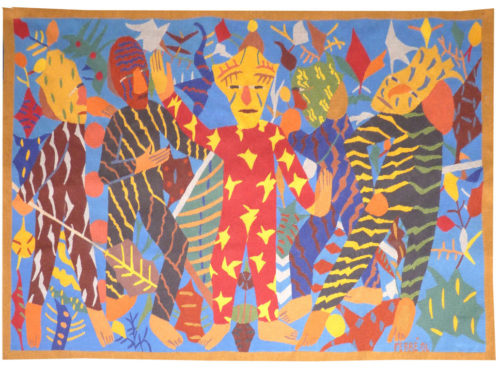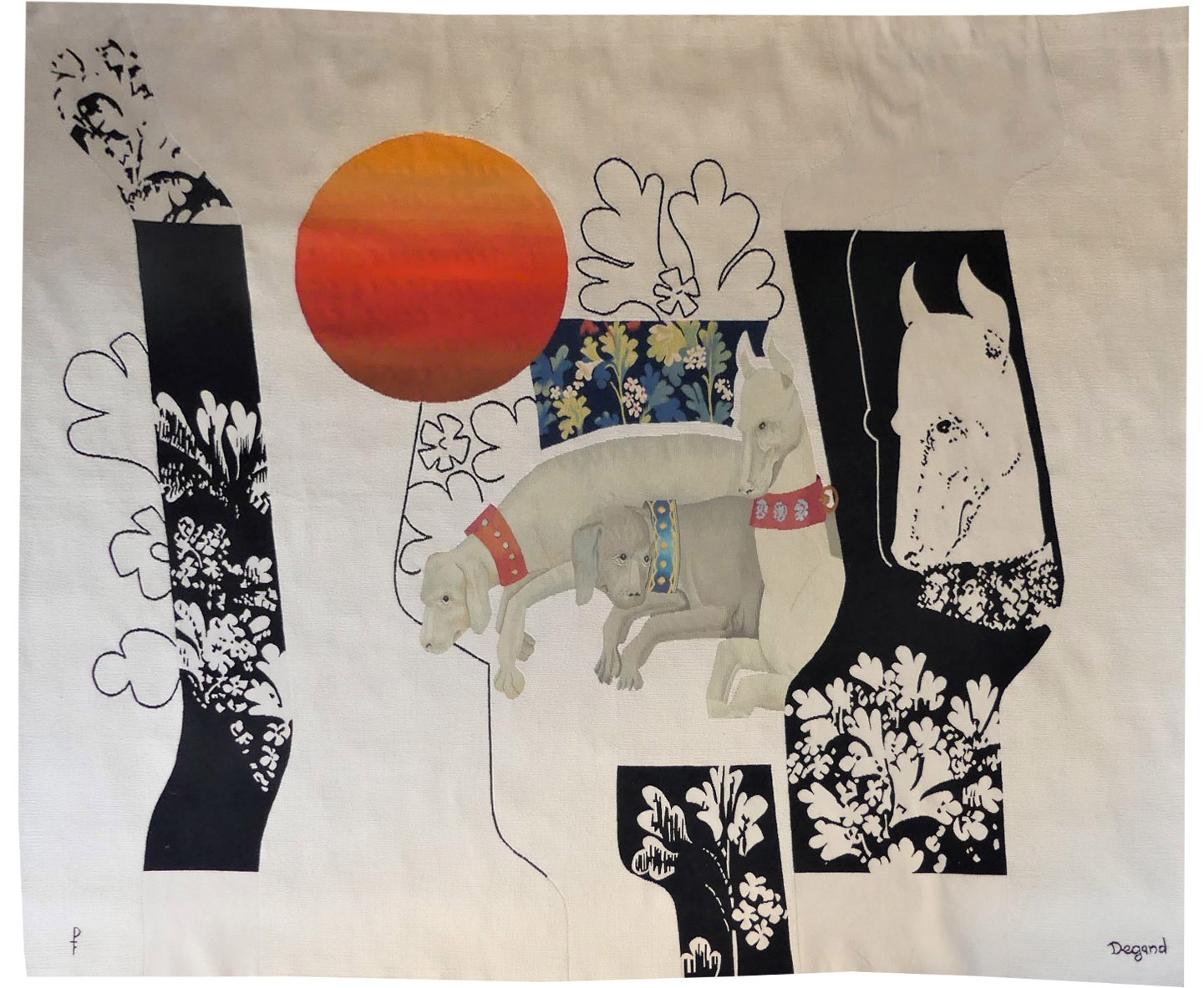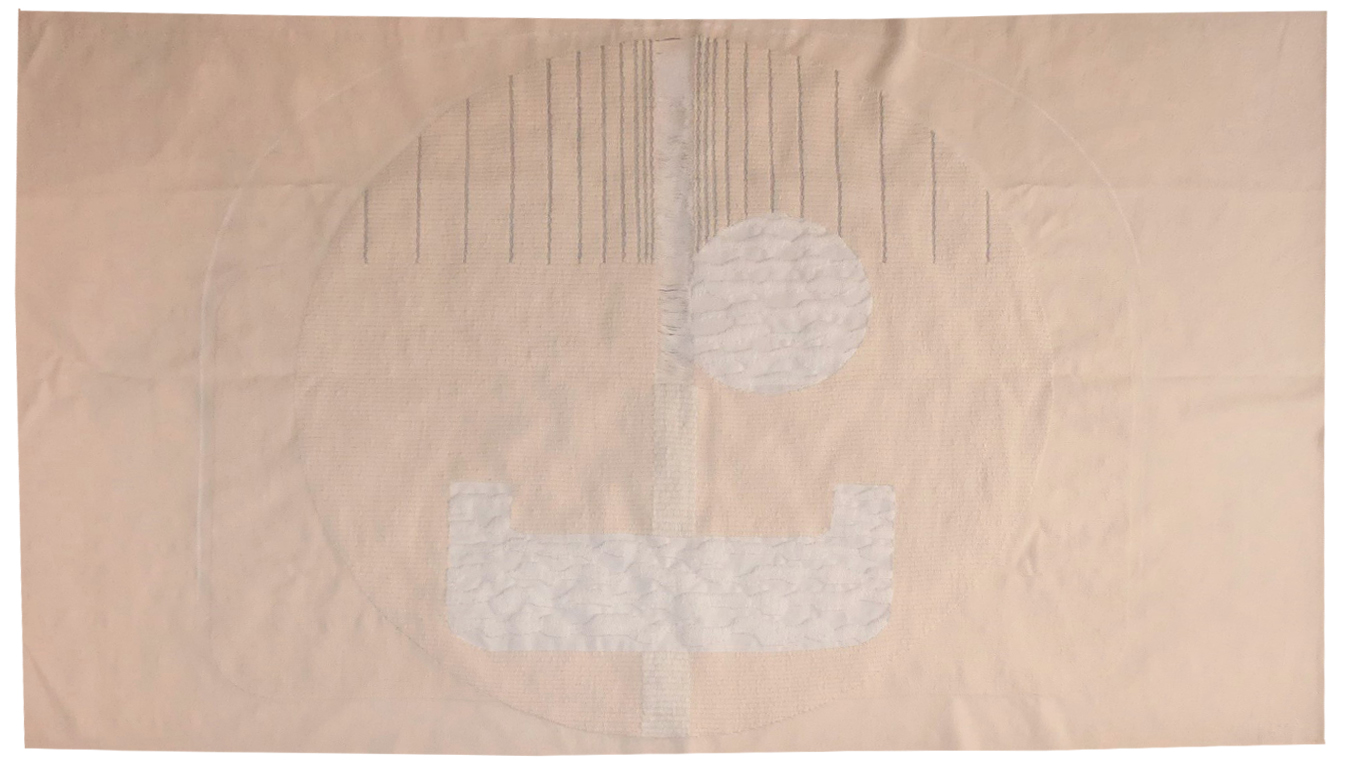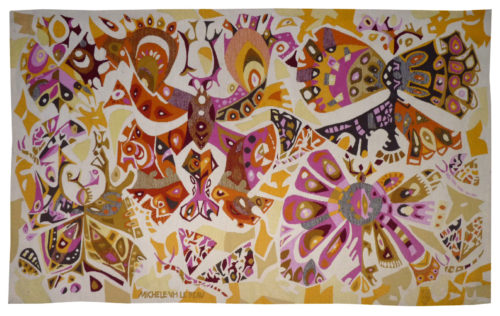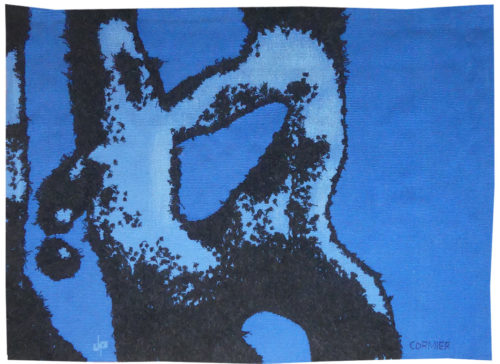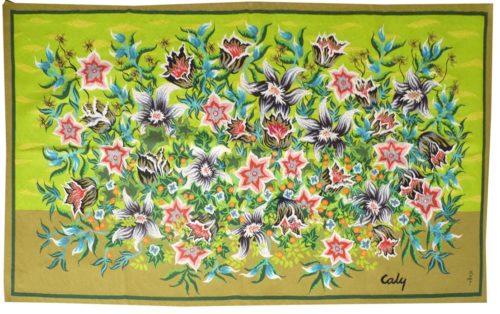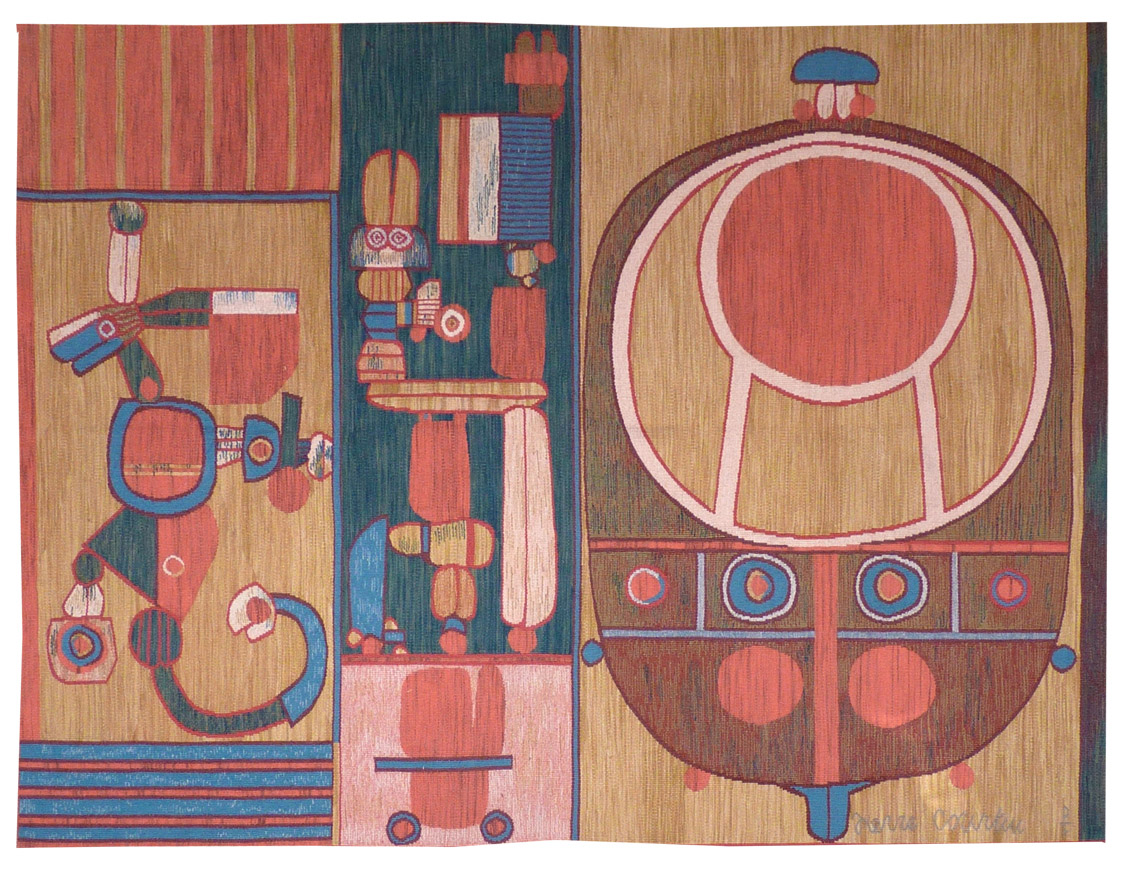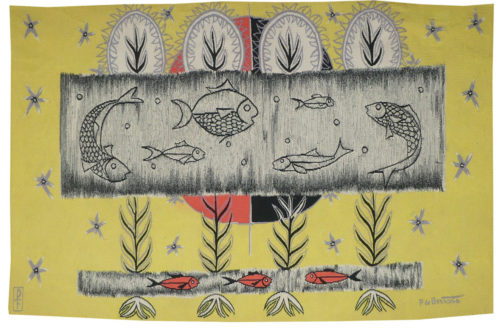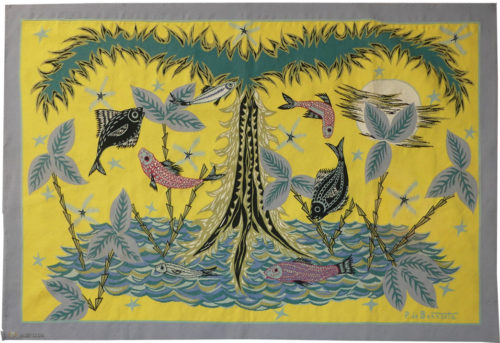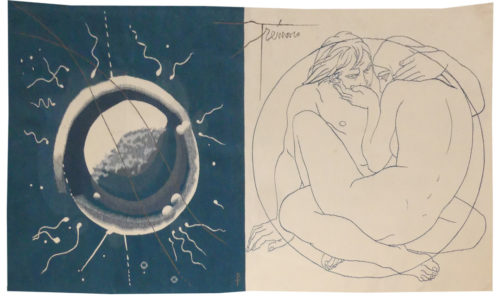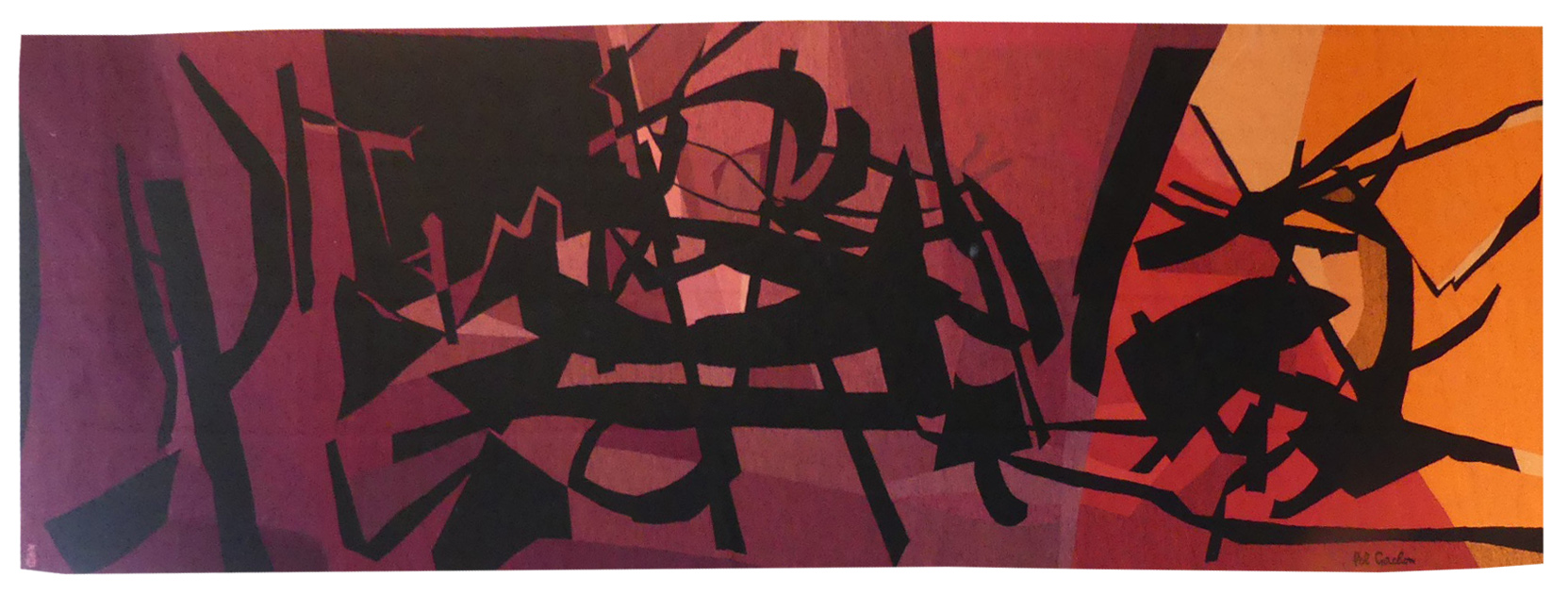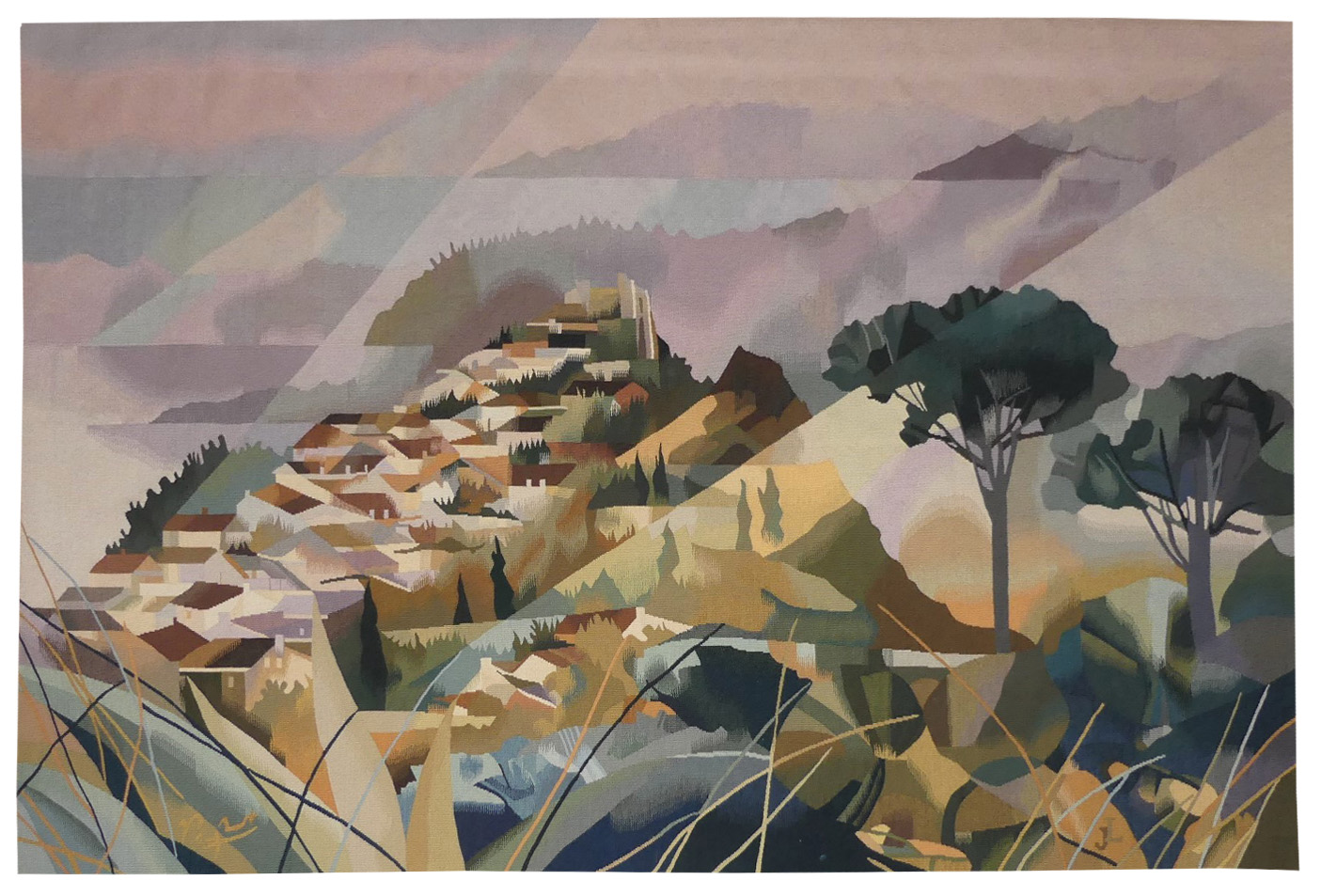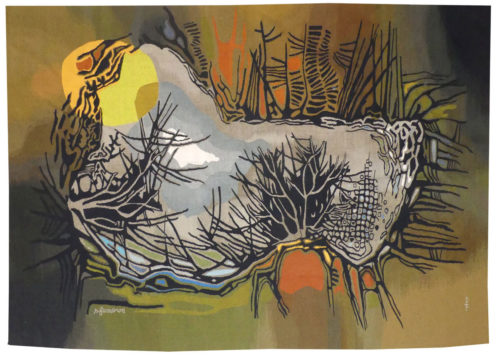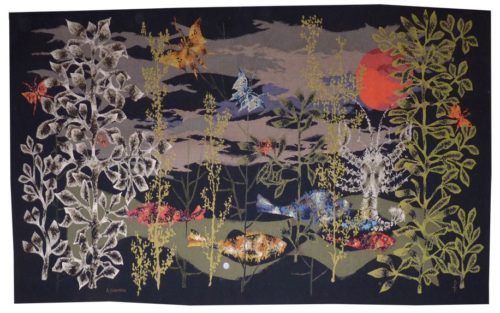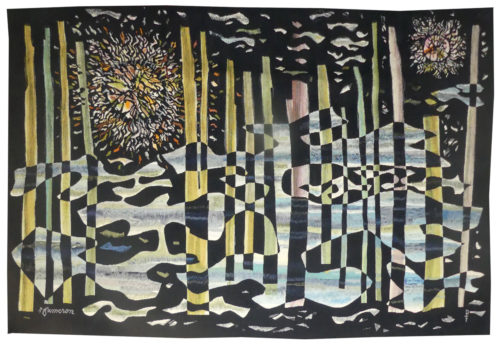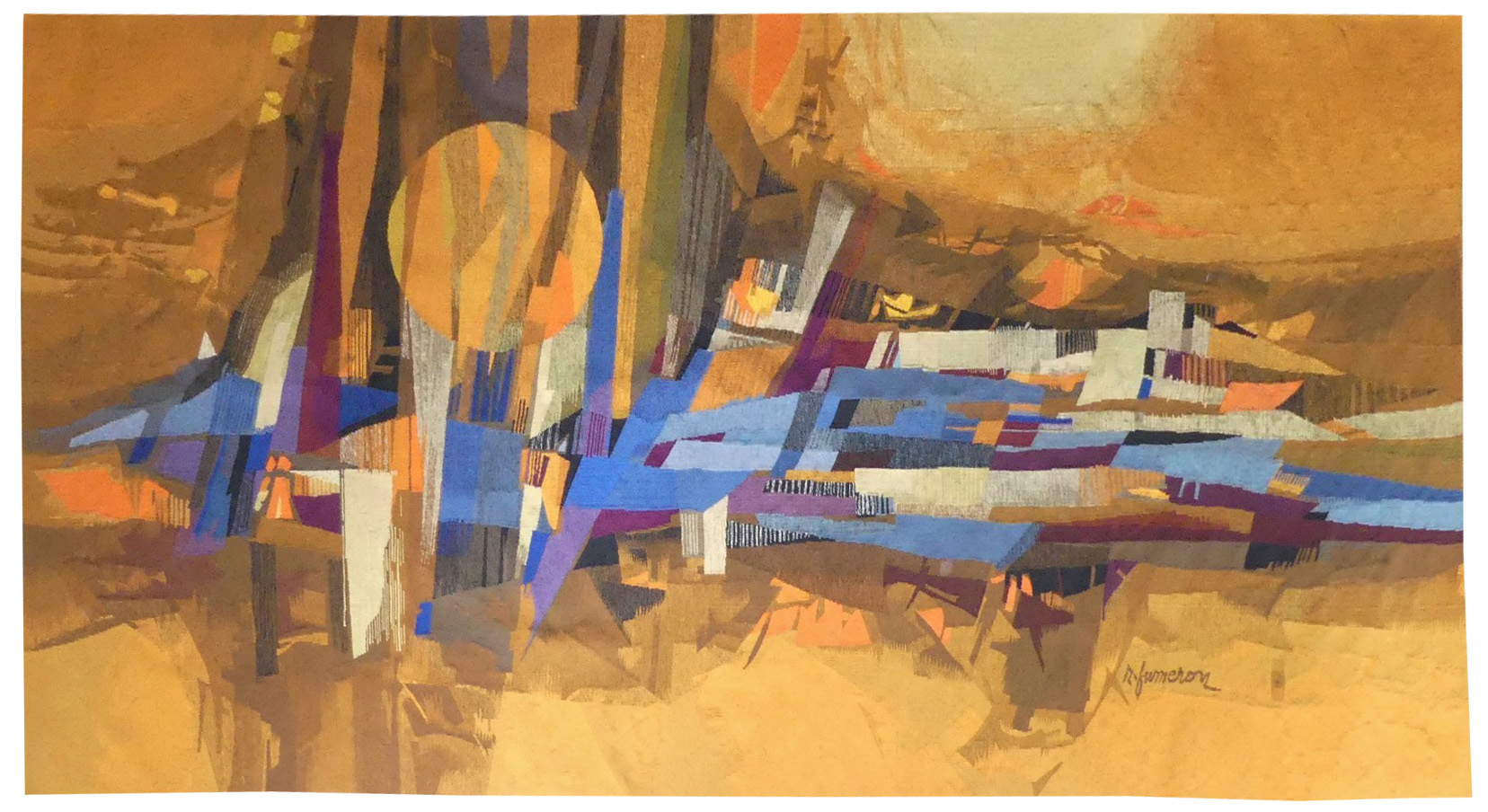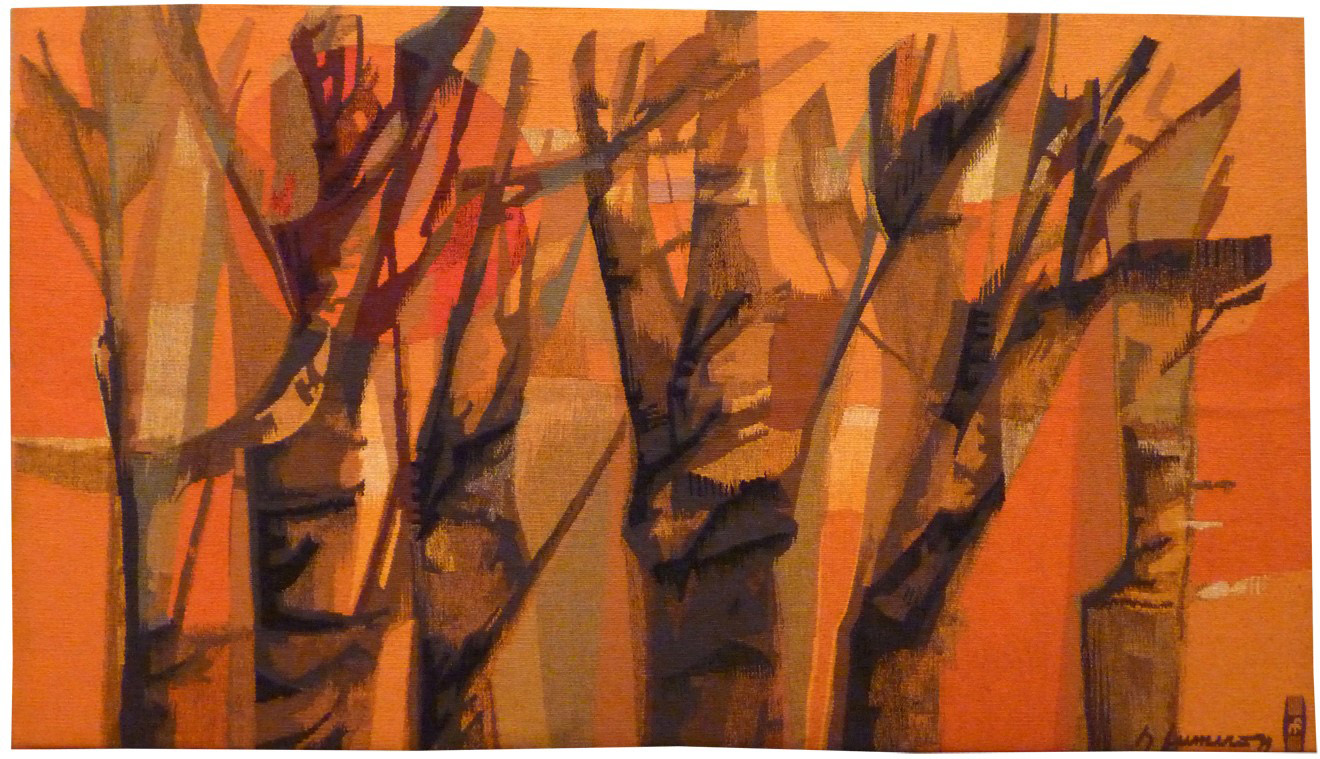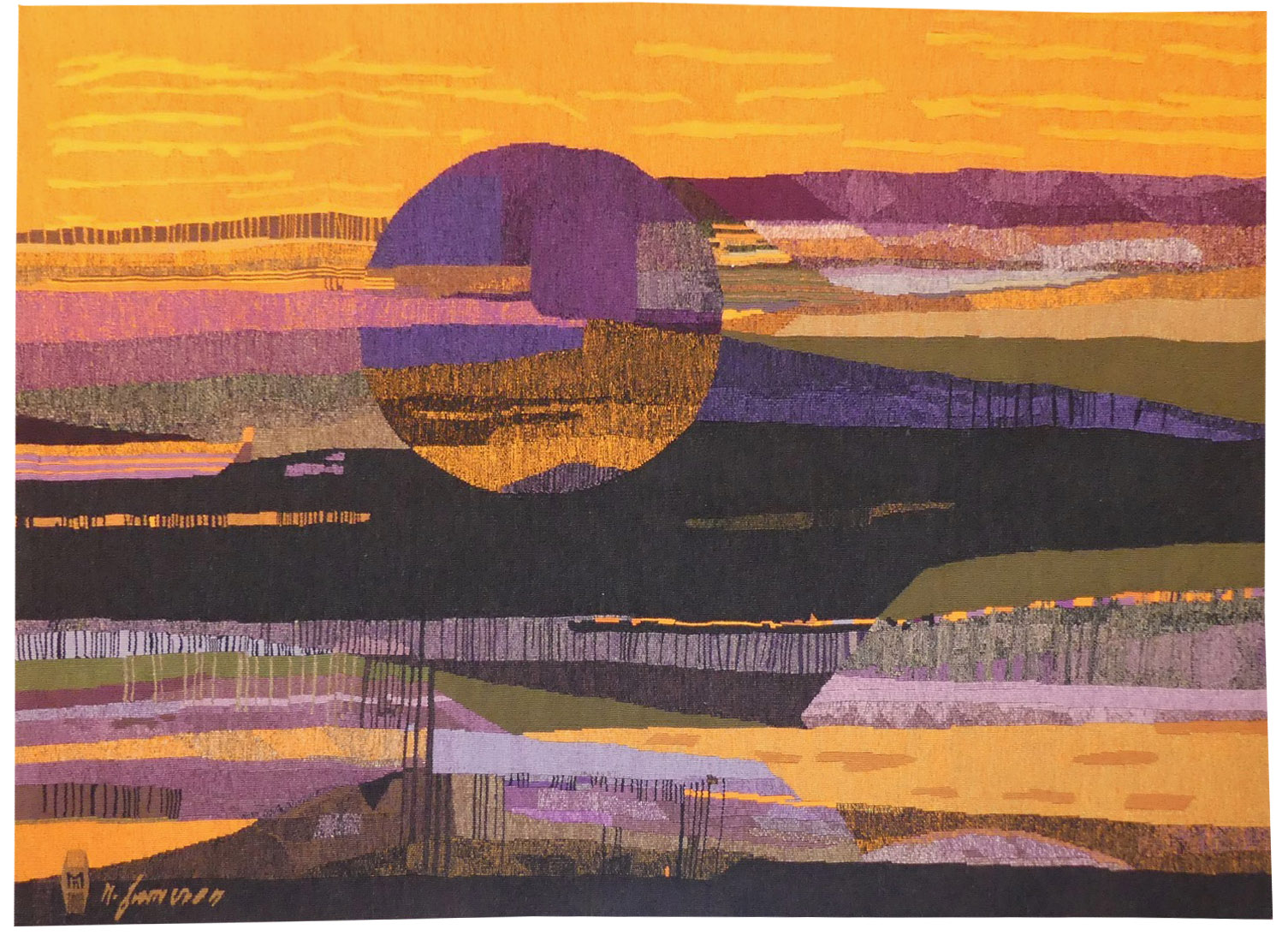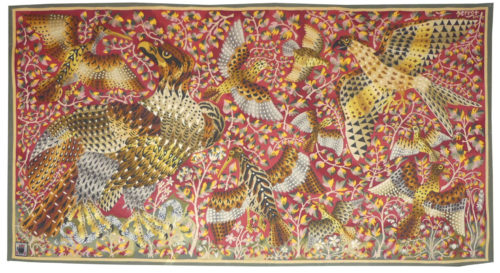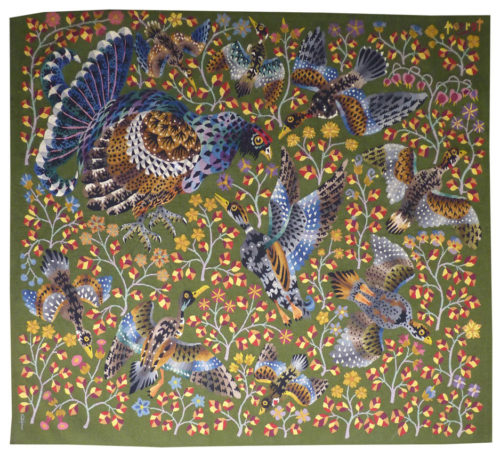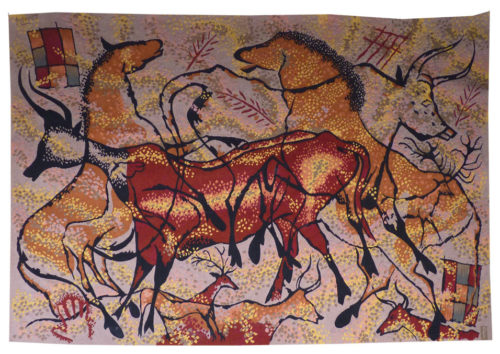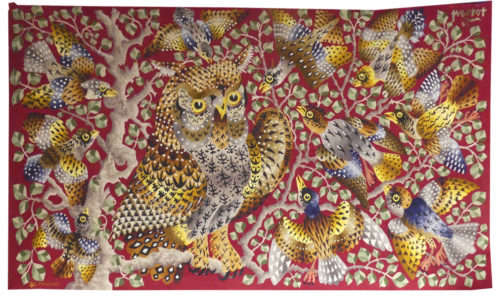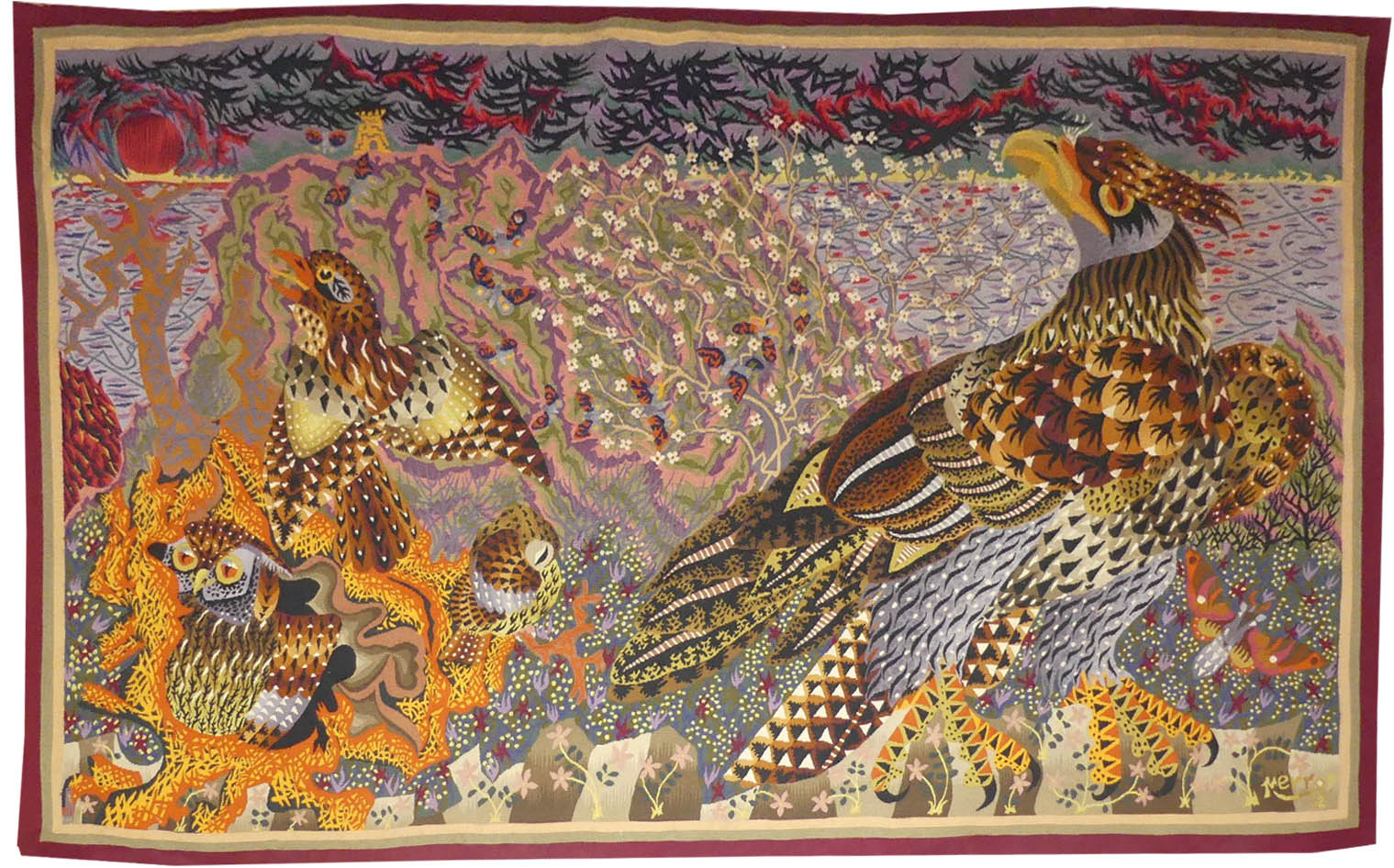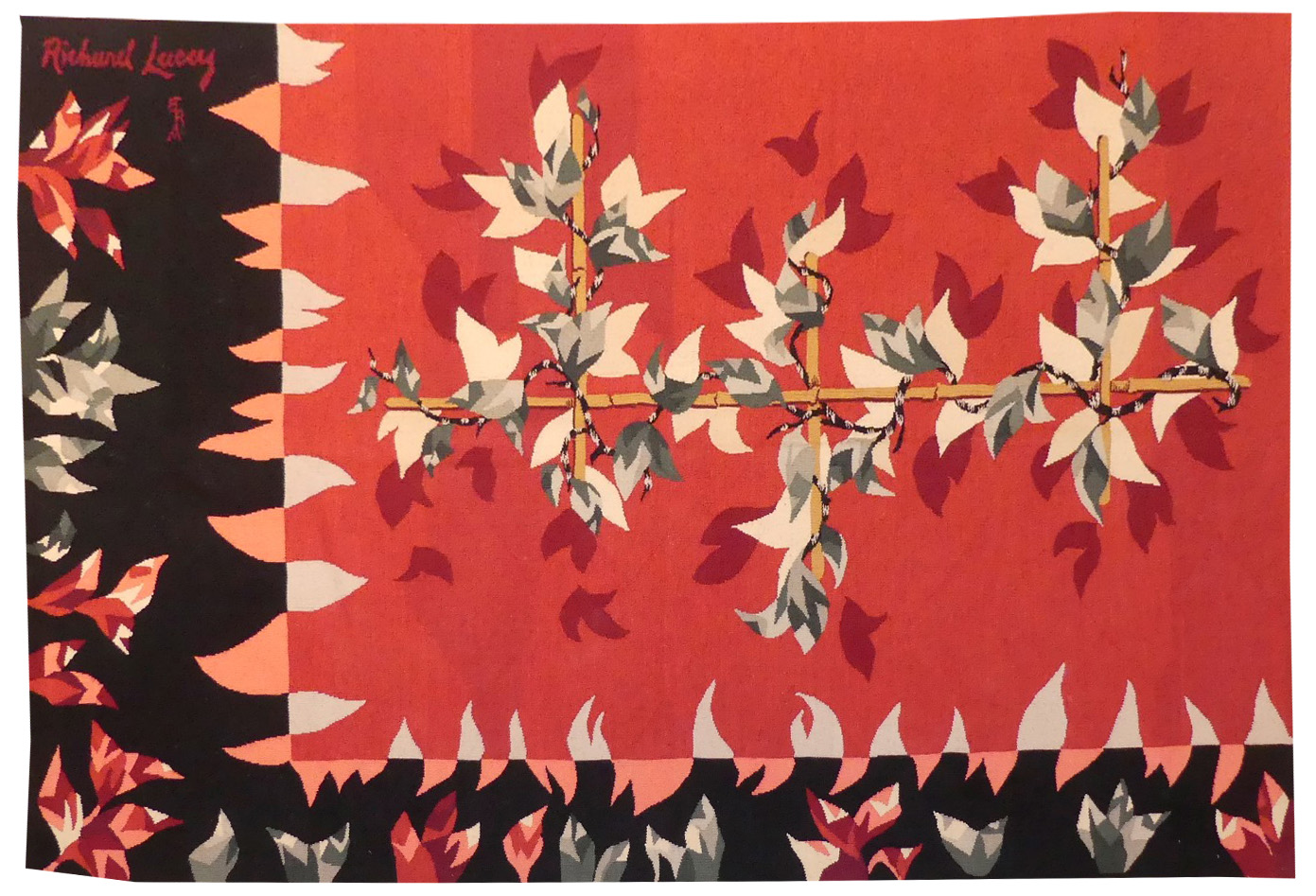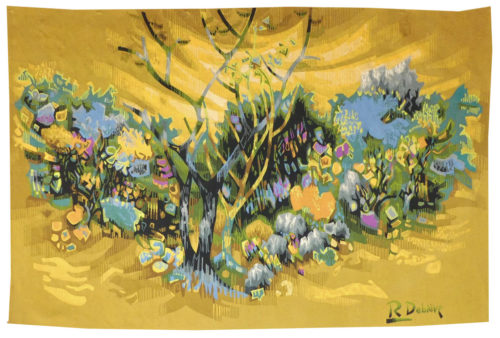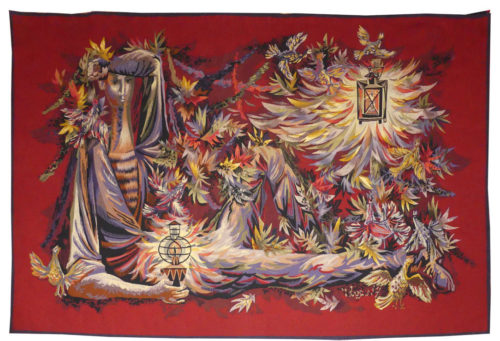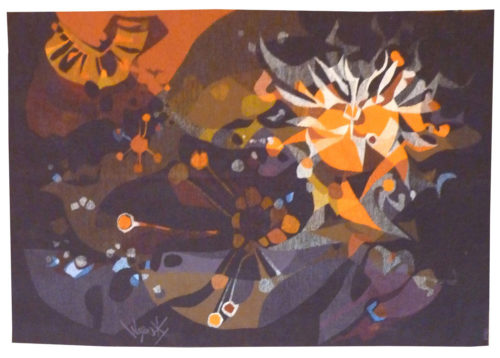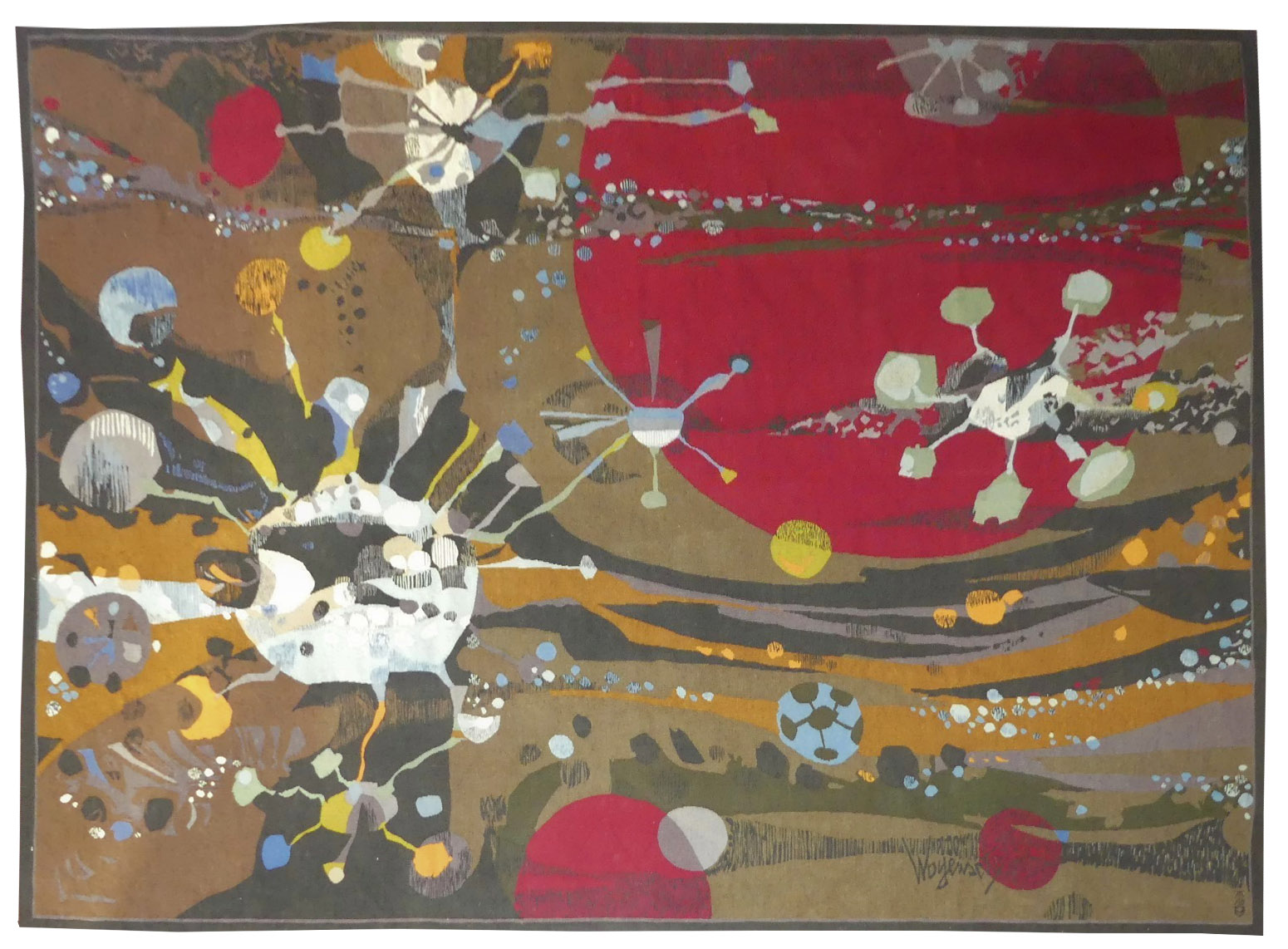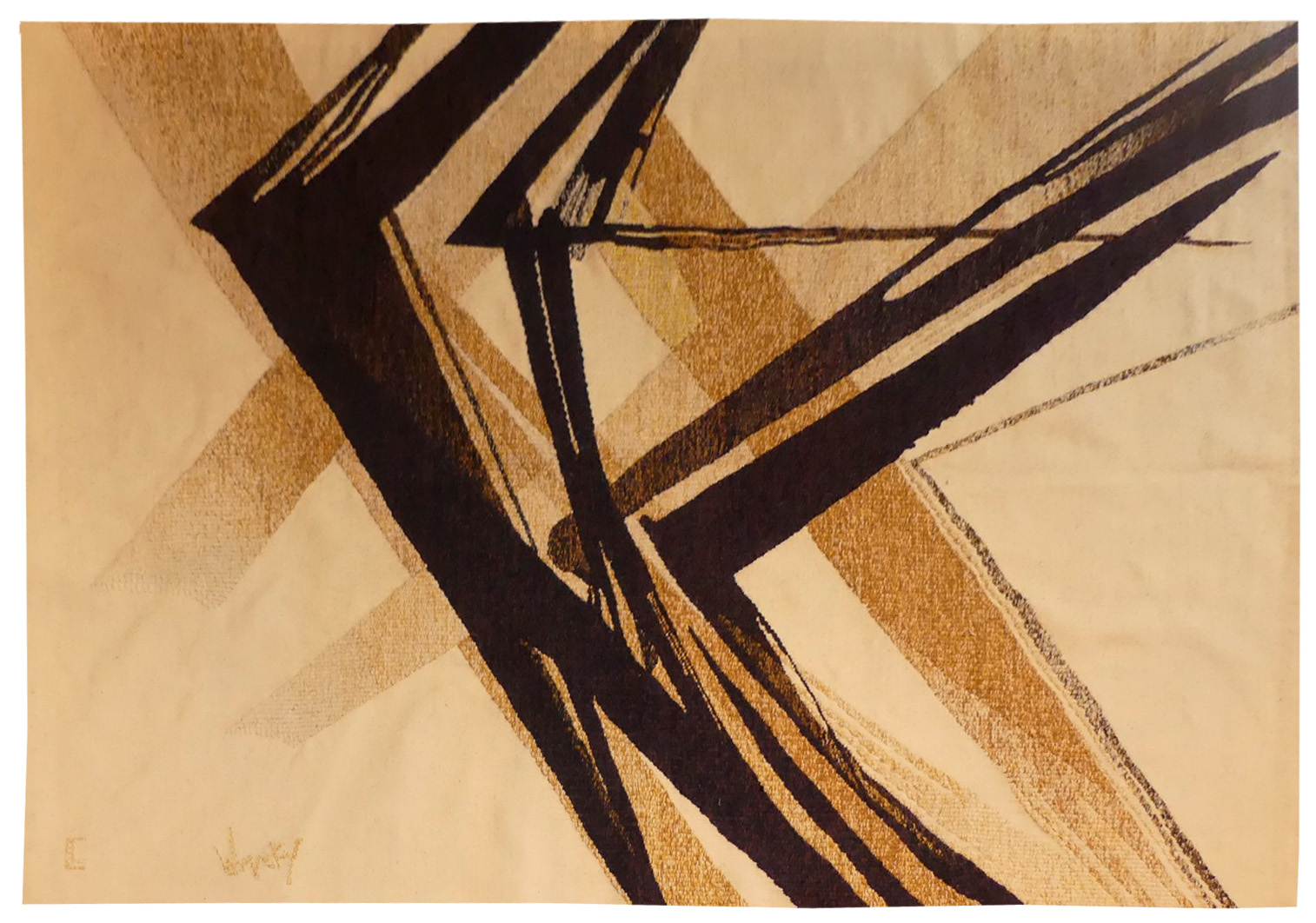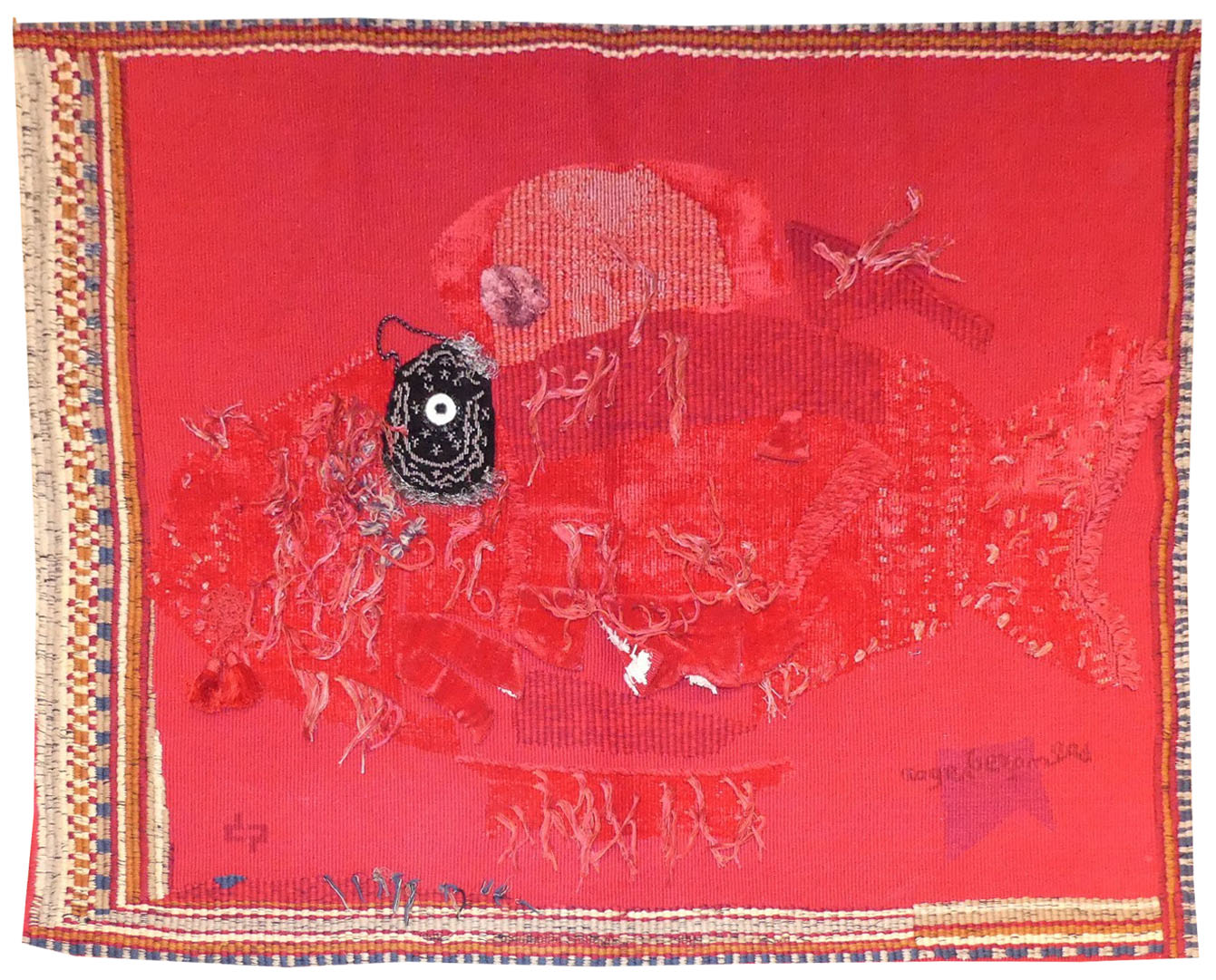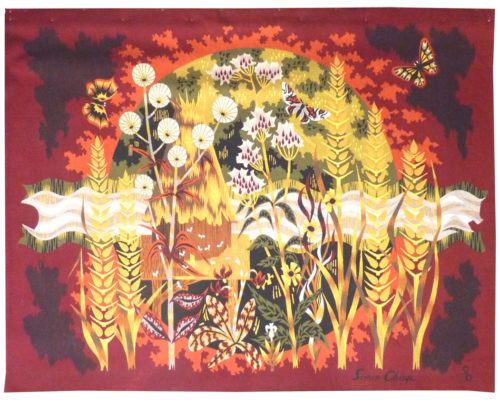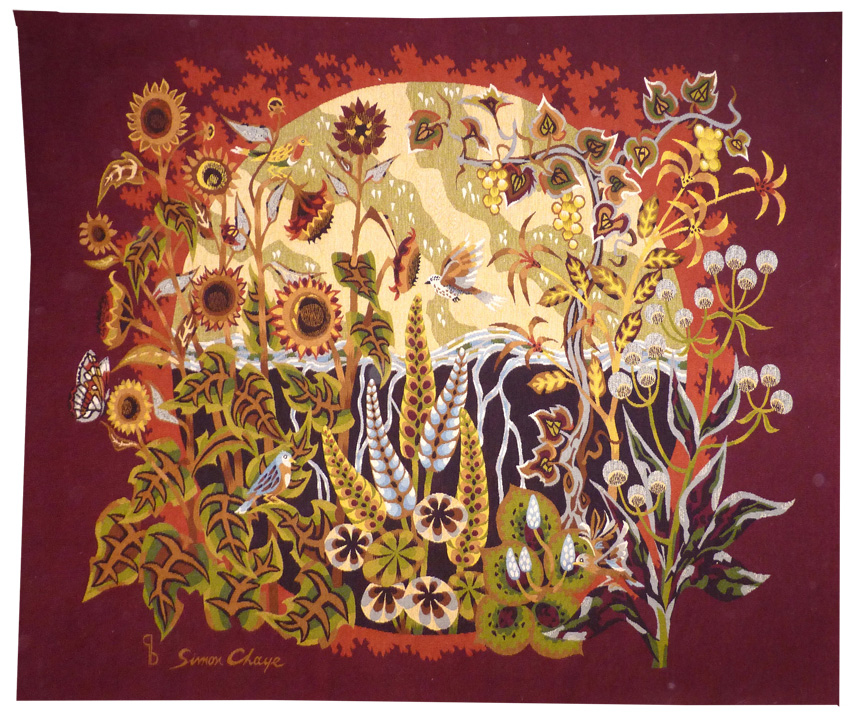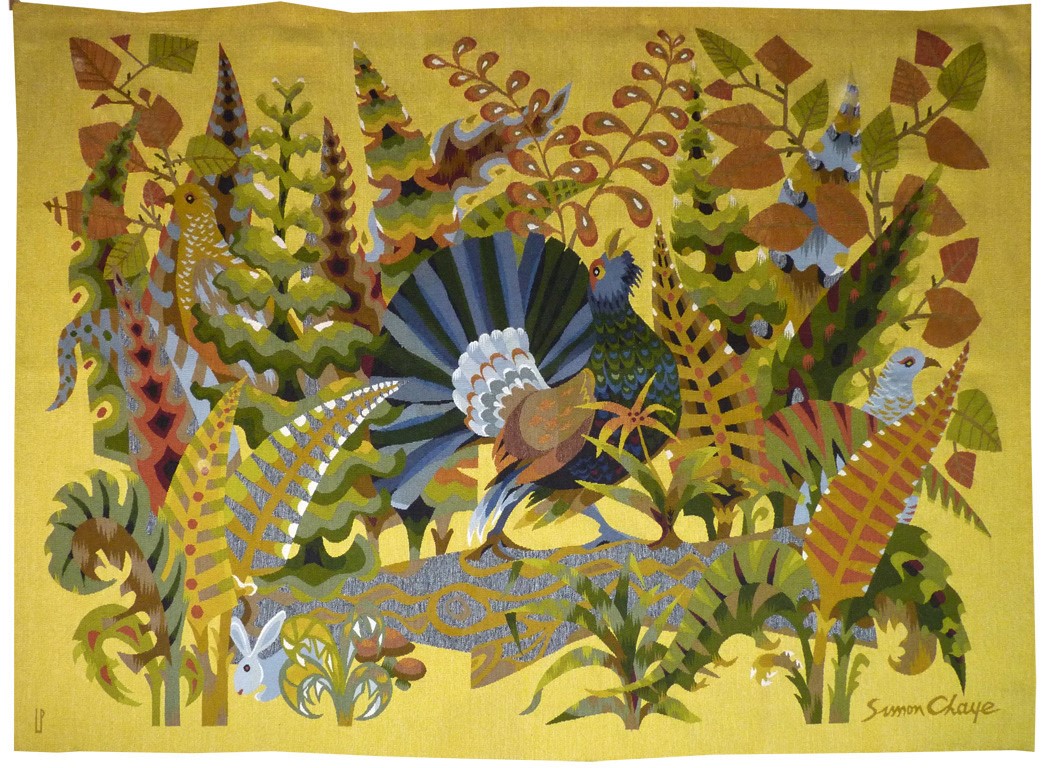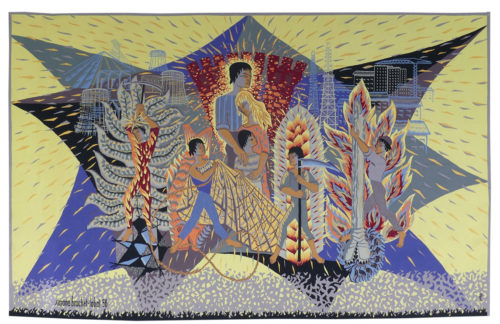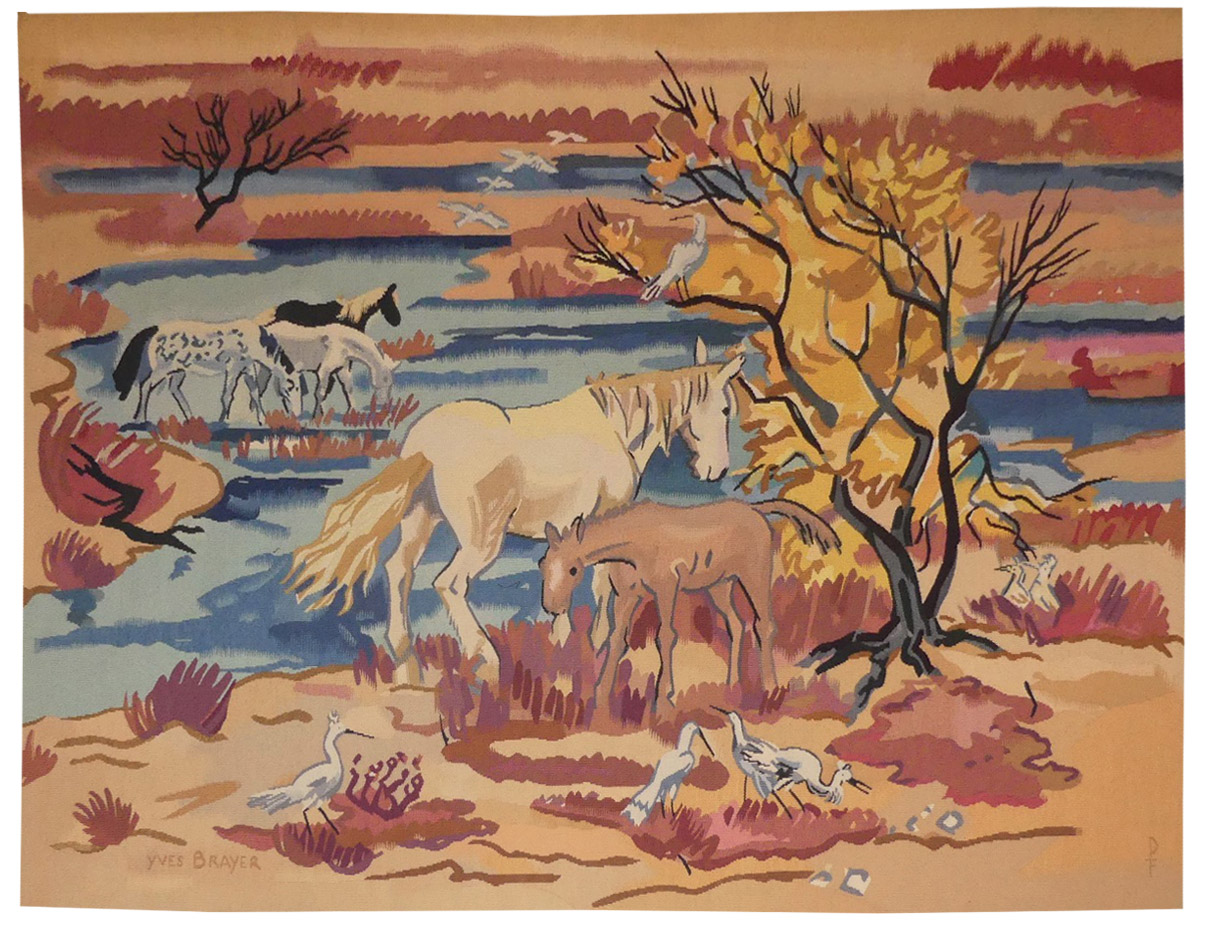-
D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. On trouve ici les mêmes préoccupations autour de la lumière (et de l’ombre) que dans « les armes de la lumière » (et que chez Matégot). Borderie est alors tissé aussi par d’autres ateliers que Legoueix à Aubusson, Rado, Daquin et, plus confidentiel, Chartron à Angers (qui tissa notamment Jorj Morin). Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 Cat. Expo. André Borderie et la tapisserie d’Aubusson, Aubusson, Manufacture Saint-Jean, 2018Tapisserie tissée par l’atelier Cartron. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/1. Circa 1970.
-
Eaux vives
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1970.D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. Malgré ses couleurs chaudes et ses formes lyriques (notamment cette accolade verticale, comme des remous aquatiques), « Eaux vives » reste singulière dans l’œuvre de Borderie : l’habituelle homogénéité chromatique est altérée par ce frappant ovale rouge central. Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 J.J. et B. Wattel, André Borderie et la tapisserie d'Aubusson, Editions Louvre Victoire, 2018 -
Vent de sable
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA/2. Circa 1970.D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. Abstraction dynamique, gamme chromatique entre orange et marron, modèles abstraits jouant sur les effets plastiques de la lumière à travers les couleurs : un carton classique d’André Borderie. Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 J.J. et B. Wattel, André Borderie et la tapisserie d'Aubusson, Editions Louvre Victoire, 2018 -
Les armes de la lumière
D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. « Au centre de l’œuvre peint et tissé d’André Borderie, il y a la lumière » (F. de Loisy in Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 p.7). Ce constat a valeur ici de manifeste, avec des préoccupations proches de celle de Matégot (cf. « Ombres et lumières », « Piège de lumière »…) Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 Cat. Expo. André Borderie et la tapisserie d’Aubusson, Aubusson, Manufacture Saint-Jean, 2018Tapisserie tissée par l’atelier Cauquil-Prince. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/1. Circa 1970. -
Composition
Tapisserie, probablement d'Aubusson. Circa 1970.Si le passage à l’abstraction s’opère chez Lanskoy à partir des années 40, ses premiers cartons datent des années 50 : ils seront donc tous abstraits. D’abord tissé à Aubusson chez Picaud, il donne ensuite la plupart de ses cartons à Maurice Chassagne (dont aucune marque d’atelier, ni bolduc ne figurent jamais sur les tapisseries qu’il a tissées), mais il fut aussi tissé aux Manufactures Nationales, et « Consolation » orna le paquebot « France », preuve de l’inscription de l’artiste dans l’histoire de l’art français. Protagoniste majeur de l’abstraction lyrique, défendu par les principales galeries de l’époque (Jeanne Bucher, Louis Carré), Lanskoy, dont la peinture foisonnante s’épanouit parfois en fééries de couleurs (les roses, les mauves, les oranges… ont régulièrement droit de cité) parvient à se passer de ses caractéristiques empâtements lorsqu’il s’agit d’être tissé. De même, le lyrisme des formes y apparaît souvent plus contenu. -
Nymphes et chasseurs
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton pour la Compagnie des Arts Français. 1941.La place d’André Planson dans l’histoire de la tapisserie est liée au rôle que voulût lui donner Jacques Adnet dans le cadre de la synthèse des arts prônée au sein de la Compagnie des Arts Français, dont il était directeur. Dès 1941, Adnet sollicite plusieurs peintres (Brianchon, Vera,…. et Planson) afin de réaliser des cartons de tapisserie, en lien avec le mobilier et l’architecture intérieure : “nous avons voulu démontrer que la tapisserie contemporaine trouve sa place dans un ensemble et peut aider efficacement à l’ambiance d’une pièce” (L. Chéronnet, Jacques Adnet, Art et Industrie, 1948). La compagnie des Arts Français organisa tout au long des années 40 des expositions de tapisserie dans ses locaux. Ces vélléités décoratives, importantes pour le renouveau de la Tapisserie, restent cependant éloignées des préoccupations de Lurçat et de ses épigones. Le style aimable et joyeux (qu’on songe aux réalisations contemporaines de Lurçat ou de Gromaire) de la Compagnie apparaît pleinement dans ce carton de 1941, qui réactualise les thèmes traditionnels de la tapisserie, à mi-chemin entre scène de chasse et plaisirs champêtres, dans une volonté de renouveau du grand goût décoratif. Si certaines innovations techniques de l’école de Lurçat sont déjà assimilées (tons comptés, gros point,…), on remarque que cette volonté décorative est encore influencée par la technique picturale (utilisation de la perspective, des dégradés dans les chairs,…) -
Composition
Peintre malheureusement quelque peu oublié aujourd’hui, bien qu’il fût l’un des premiers abstraits libanais, Assem Stétié (il est le frère du plus connu poète et critique Saleh Stétié, proche lui-même de nombreux artistes) a mené une œuvre personnelle à la fois lyrique et maîtrisée, faite de signes de couleurs pures, une forme de calligraphie personnelle, particulièrement dans les années 70, dont nous pouvons dater notre tapisserie.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Caron. Circa 1970. -
La cage aux oiseaux
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1980.Bien que dessinateur de soieries dans sa jeunesse, et concepteur de tableaux de grand format servant de manifestes lors d’expositions (« la peste en Beauce » de 1953 mesurait par exemple 250 x 360 cm), l’intérêt de Lorjou pour la tapisserie fut tardif : peut-être considérait-il la rudesse et la robustesse de son style inappropriés au tissage (ses proches, d’ailleurs, Rebeyrolle, Mottet, Sébire, … ne seront eux-mêmes jamais tissés). Dans les années 70 son style devient plus onirique et moins expressionniste : c’est alors qu’il donnera des cartons pour l’atelier Pinton. La gamme chromatique, les motifs d’oiseaux, sont caractéristiques du Lorjou des années 70 ; la matière des tableaux est restituée en tapisserie par les différences de points de tissage. -
Camargue
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Bolduc signé de l’artiste, n°4/6. 1963.Attiré par les grandes surfaces, sous l’influence d’Untersteller à l’Ecole des Beaux-Arts, Hilaire a éxécuté de nombreuses peintures murales. Logiquement, il a réalisé, à partir de 1949, en même temps que de nombreux artistes, stimulés par Lurçat (il fera partie à ses côtés de l’A.P.C.T., Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), de nombreux cartons (quelques dizaines), dont certains ont été tissés à Beauvais ou aux Gobelins. On retrouve son style figuratif cubisant (qui confine parfois à l’abstraction) dans ses cartons de tapisserie : dans le nôtre, mais aussi par exemple dans celui réalisé pour le Salon Fontainebleau du Paquebot France, “Sous-bois “(190 x 988 cm, tissage Pinton, reproduit dans Armelle Bouchet Mazas, le paquebot France, Paris, 2006, p.169), où formes et couleurs sont fragmentées de façon kaléidoscopique. “Camargue” est reproduit dans le classeur “Tapisserie d’Aubusson” édité par la Chambre de commerce et d’Industrie de Guéret au début des années 80 pour illustrer le savoir-faire des ateliers d’Aubusson.Bibliographie : Cat. Expo., Hilaire, oeuvre tissé, galerie Verrière, 1970 (reproduite) Cat. Expo. Hilaire, du trait à la lumière, Musée Départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, 2010. -
Composition
Proche de Bertholle et de Le Normand, avec lequel il réalise des fresques dans les années 40, Idoux donne son premier carton en 1946, et adhere à l’A.P.C.T. en 1951. Ses tapisseries, aux résonances géométriques et optiques harmonieusement rythmées (nous ne sommes qu’au début des années 50 !) sont un écho de ses realisations dans le domaine du vitrail (à Notre-Dame de Royan par exemple). Si le parcours d’Idoux en tapisserie est météorique (une vingtaine de cartons en une dizaine d’années), il atteindra néanmoins un point d’orgue officiel avec “Jardin Magique” et “Fée Mirabelle” tissées pour le salon des premières classes du paquebot “France” (“Jardin magique”est maintenant conservé à l’écomusée de Saint-Nazaire).Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Rivière des Borderies. Circa 1950. -
Galathée
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/4. 1970.Loewer réalise son premier carton en 1953; ses réalisations sont d’abord figuratives avant qu’il n’oblique (comme Matégot) vers l’abstraction, exclusivement géométrique chez Loewer. Il composera plus de 180 cartons, la plupart tissés par son ami Raymond Picaud. Tissée en un seul exemplaire d’après le catalogue raisonné, « Galathée » est représentative du style de l’artiste vers 1970, dont le signe plastique récurrent devient le carré, utilisé en superpositions. Bibliographie : Claude Loewer, l’évasion calculée : travaux de 1939 à 1993, catalogue raisonné des tapisseries de 1953 à 1974, Sylvio Acatos, Charlotte Hug, Walter Tschopp et Marc-Olivier Wahler, Artcatos, 1994, n°120 -
Argos
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/4. 1971.Loewer réalise son premier carton en 1953; ses réalisations sont d’abord figuratives avant qu’il n’oblique (comme Matégot) vers l’abstraction, exclusivement géométrique chez Loewer. Il composera plus de 180 cartons, la plupart tissés par son ami Raymond Picaud. Vers 1971-1972, le style de Loewer devient plus épuré, avec des carrés moins nombreux, et des couleurs plus vives et bariolées. Comme souvent chez Loewer, notre tissage est unique. Bibliographie : Claude Loewer, l’évasion calculée : travaux de 1939 à 1993, catalogue raisonné des tapisseries de 1953 à 1974, Sylvio Acatos, Charlotte Hug, Walter Tschopp et Marc-Olivier Wahler, Artcatos, 1994, n°128 -
Oliviers avec ciel jaune et soleil
La manufacture Four reproduit en tapisserie, tissée à la main, certaines des grandes oeuvres de la peinture : ainsi Klee, Modigliani, Macke ou, ici, van Gogh ont été transcrits en laine, en reproduisant les nuances de matières et de touches des artistes.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc, n°6/6. D'après une oeuvre de l'artiste de 1889, conservée au Minneapolis Institute of Arts. -
Melinjana
Installé à Venasque après avoir pratiqué son art aux Gobelins, Daniel Drouin a conçu de nombreuses tapisseries tissées sur métiers de haute lisse. La variété des matériaux, le goût pour l’abstraction, ainsi que le tissage par le concepteur du motif, répondent à certaines préoccupations de « la Nouvelle Tapisserie » d’alors, sans aller au-delà des 2 dimensions néanmoins.Tapisserie tissée par l’atelier de la Tuilière. Avec son bolduc. Circa 1970. -
Soleil pour Maria Pia
Tapisserie d'Aubusson tissée par les ateliers Pinton frères. Avec son bolduc, n°1/3. Circa 1970. Holger a été élève à l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. -
Sonnen-Vision (Soleils-Vision)
Tapisserie tissée par la Münchener Gobelin Manufaktur. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1975.Holger a été élève à l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. Certains de ses cartons ont été tissés dans les 2 manufactures en activité en Allemagne, à Nuremberg et Münich, au point d’Aubusson. -
Technique de groupe
Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Novion. Avec son bolduc. 1973.Moine bénédictin et enlumineur, Dom Robert rencontre Jean Lurçat en 1941 à l’abbaye d’En Calcat : sans qu’il cesse de dessiner (ses aquarelles, prises sur le motif, serviront de répertoire formel à ses tapisseries), son œuvre de cartonnier (il est membre de l’A.P.C.T. dès sa création) prend une ampleur considérable (une centaine de cartons, chiffrés), et connaît un succès jamais démenti. Son style est aisément reconnaissable : refus de la perspective, sujets inspirés de la Nature (d’une nature paradisiaque) où flore et faune traités de façon imagée s’entremêlent joyeusement dans une foisonnante exubérance, et où l’on décèle l’influence des tapisseries mille-fleurs médiévales ; poétiques et colorés, les cartons de Dom Robert incarnent l’ascèse spirituelle de leur auteur. Inauguré au printemps 2015, le musée Dom Robert est établi à Sorèze, dans le Tarn, au sein de l’ancienne Abbaye-école. Si le thème des chevaux est un classique chez Dom Robert ( cf. »Dartmoor », « Compagnons de la marjolaine », « Farfadet »,….), la spécificité de « Technique de groupe » réside dans sa conception, et dans des aspects techniques, justement : exceptionnellement, le carton n’est pas numéroté ; à la demande de Novion, alors professeur à l’école Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, dom Robert conçut un lavis aquarellé (conservé au musée de Sorèze), permettant une interprétation plus libre de la part du lissier, et un rendu radicalement différent des tissages Goubely ou Tabard. Bibliographie : Cat. Expo. Dom Robert, tapisseries récentes, Paris, Galerie la Demeure, 1974, ill. p.9 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Julliard, 1980, ill. p. 68-69 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Siloë-Sodec, 1990, ill. p.116-117 Cat. Expo. Dom Robert, œuvre tissé, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1990, ill. Collectif, la clef des champs, Dom Robert, Editions Privat, 2003, ill. p.109 -
Chèvrefeuilles
Tapisserie d’Aubusson tissée dans l’atelier Goubely. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1. 1973. Moine bénédictin et enlumineur, Dom Robert rencontre Jean Lurçat en 1941 à l’abbaye d’En Calcat : sans qu’il cesse de dessiner (ses aquarelles, prises sur le motif, serviront de répertoire formel à ses tapisseries), son œuvre de cartonnier (il est membre de l’A.P.C.T. dès sa création) prend une ampleur considérable (une centaine de cartons, chiffrés), et connaît un succès jamais démenti. Son style est aisément reconnaissable : refus de la perspective, sujets inspirés de la Nature (d’une nature paradisiaque) où flore et faune traités de façon imagée s’entremêlent joyeusement dans une foisonnante exubérance, et où l’on décèle l’influence des tapisseries mille-fleurs médiévales ; poétiques et colorés, les cartons de Dom Robert incarnent l’ascèse spirituelle de leur auteur. Inauguré au printemps 2015, le musée Dom Robert est établi à Sorèze, dans le Tarn, au sein de l'ancienne Abbaye-école. Chèvres et feuilles dans toute leur variété, plutôt que « Chèvrefeuilles », dom Robert n’ayant jamais hésité sur les jeux de mots (cf. « Plein champ »). Le motif de la chèvre apparaît justement dans ce dernier carton, de 1970. Ici, à une échelle unique sur ce thème, les chèvres se déploient dans une nature automnale, rappel justement de « l’Automne », qui clôt en 1943 sa série sur les Saisons. Une tapisserie similaire est conservée à la Cité Internationale de la Tapisserie, à Aubusson. Bibliographie : Cat. Expo. Dom Robert, tapisseries récentes, galerie la Demeure, 1974, ill.p.15, carton, p.23 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Julliard, 1980, ill. p.70-71, détail en couverture, carton p.85 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Siloë-Sodec, 1990, ill. p.62-67 Cat. Expo. Dom Robert, œuvre tissé, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1990 Cat. Expo. Hommage à Dom Robert, Musée départemental de la tapisserie, Aubusson, 1998 Collectif, la clef des champs, Dom Robert, Editions Privat, 2003, ill. p.124 Collectif, les saisons de Dom Robert, Tapisseries, Editions Hazan, 2014, ill p.164-167 B. Ythier, Guide du visiteur, Cité Internationale de la tapisserie d’Aubusson, ill. p.65 R. Guinot, hors-série la Montagne, une Cité pour la tapisserie d’Aubusson, 2018, ill. p.82 Collectif, la tapisserie française, Editions du Patrimoine, 2017, ill. 312-313 -
Ls chouettes
Tapisserie tissée par la manufacture de Wit. Circa 1960.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). A partir de 1955 ,et tout au long des années 60, la manufacture de Wit tissa un nombre considérable de tapisseries d’après Dubrunfaut, la figure humaine laissant bientôt place à des sujets floraux, et, surtout, d’oiseaux.Bibliographie : Cat. Expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -
Flore des tropiques
Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Four. Avec son bolduc, n°EA. Circa 1975.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Sur la fin de sa carrière, Dubrunfaut s’exprime dans un style féérique (aux formes acérées proches de Marc Petit), et dont la thématique (colibris et plantes exotiques) renvoie au Lurçat des années 50.Bibliographie : Cat. expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983 -
Le royal
Tapisserie d’Aubusson tissée dans l’atelier Simone André. Avec son bolduc signé. Circa 1965.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès 1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Le sujet, le fond bleu vif sont un écho à Perrot. Caractéristiques de Dubrunfaut sont ses feuilles-plumes : l’animal s’accapare le végétal. -
Double amitié
Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Four. Avec son bolduc signé, n°EA1. 1972.Bibliographie : Cat. expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983, n°239.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Sujet classique ; le titre néanmoins renvoie à une anthropomorphisation des relations entre animaux ; ainsi s’expriment alors les préoccupations sociales (utopiques ?) de l’artiste. -
Belle entente
Tapisserie tissée dans l’atelier DMD, à Tournai. Avec son bolduc. 1989.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Le titre renvoie aux préoccupations d’harmonie sociale de l’artiste : la figure humaine, omniprésente à ses débuts, revient illustrer une thématique irénique. Bibliographie : Exhibition catalogue Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -
Fleurs
Tapisserie tissée au CRECIT. Avec son bolduc. 1999.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès 1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Tapisserie tardive de Dubrunfaut, à la veine décorative toujours renouvelée, tissée au CRECIT à Tournai, où l’artiste a donné de nombreux cartons à tisser. Bibliography : Exhibition catalogue Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -
Le petit oiseleur
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1970.Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons. « Le petit oiseleur » relève d’une veine caractéristique de Grekoff où des enfants s’observent, mélancoliques, dans un paysage onirique se déployant sur un fond d’aplats colorés, comme l’illustration d’un conte. -
Poissons et grenouilles
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé, n°1/4. Circa 1970.Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons : fond noir, sous-marin, avec poissons et feuillages, se distinguent de Lurçat par la curieuse et amusante présence de grenouilles. -
Paysage bleu aux papillons
Elie Grekoff, proche de l'esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons : le nôtre témoigne de l'évolution de l'artiste à partir des années 60, avec la disparition de la figure humaine ou animale. Le thème de l'astre (soleil, lune) caché derrière des feuillages devient alors récurrent.Tapisserie tissée par l’ATA (Atelier de Tapisserie d'Angers) Avec son bolduc signé, n°1/4. Circa 1970. -
Chardons aux papillons blancs
Elie Grekoff, proche de l'esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons jusqu’au début des années 80. On retrouve ici les formes acérées typiques de la tapisserie de l’immédiat après-guerre. A noter, l’amusant débordement du cadre-bordure.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Caron. Avec son bolduc signé, n°EA. Circa 1970. -
Marchande d'illusions
Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons. « Marchande d’illusions » relève d’une veine caractéristique de Grekoff où des enfants s’observent, mélancoliques, dans un décor de théâtre, comme une illustration de conte.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1955. -
Le Hibou
Elie Maingonnat a dirigé l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs d'Aubusson de 1930 à 1958, où il a succédé à Marius Martin (qui déjà préconisait la limitation des couleurs et l'emploi des hachures), dont il fut l'élève. En plus de ses responsabilités, Maingonnat s'adonne lui-même à la création de cartons : de denses motifs végétaux animés de quelques animaux, témoignage de la flore et de la faune limousine, revivifient le thème traditionnel des verdures des XVIIe-XVIIIe siècles. Notre carton est typique de l'oeuvre de Maingonnat : la faune et la flore locales, comme en symbiose, sont illustrées dans une gamme réduite de couleurs automnales. Bibliographie : Cat. Expo. Elie Maingonnat, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1986-1987Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Avignon. Avec son bolduc signé de l'ayant-droit de l'artiste. 1959. -
Paris moderne
On ne sait que peu de choses sur l'artiste, mais elle a réalisé plusieurs cartons, qui seront tissés par les ateliers ART d'Antoine Behna. La vue topographique panoramique fût une des spécialités de l’atelier, « Paris Moderne » faisant écho au « Vieux Paris 1650 » de Bobot. Un exemplaire de chacune de ces tapisseries fut d’ailleurs offert au président Truman. Bibliographie : G. Janneau, A. Behna, Tapisseries de notre temps, 1950, ill. n°3 Catalogue Vente Millon-Robert, 3.10.1990, n°1, 31Tapisserie tissée par l’atelier de Colombes pour ART (Atelier de Rénovation de la Tapisserie). 1945. -
Composition
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Circa 1960.Né en 1912, Farvèze fait partie de la seconde génération de peintres-cartonniers, qui s’épanouit à partir de la fin des années 50, avec Grékoff, Ferréol, Petit, Potin,… Marqué par sa rencontre avec Gleizes puis par un séjour au Sénégal qui lui vaut de prestigieuses commandes publiques, il sera sélectionné pour participer à la 2e Biennale de Lausanne en 1965. Une stylisation haute en couleurs caractérise cette œuvre ; l’absence de bolduc, néanmoins, en empêche toute la compréhension : on distingue quelques formes animales…. ? -
La terre de France ne ment pas
Le parcours de François Faureau est tout à fait singulier. Natif d’Aubusson, il suit les cours de l’ENAD, alors sous la direction de Marius Martin qui, déjà, promeut le gros tissage et les tons comptés que Lurçat reprendra à son compte. C’est ainsi qu’il participe au stand de l’ENAD à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 en tant que peintre-cartonnier avec la tapisserie « Solitude, verdure » ou l’écran « Canards », qui oscillent entre un style classicisant, et l’influence du cubisme. Il aura par la suite son propre atelier, mais son oeuvre restera confidentielle, et éloignée des protagonistes de la « Renaissance de la Tapisserie ». Si les ateliers d’Aubusson (comme d’ailleurs les Manufactures Nationales) ont poursuivi leur activité sous l’occupation, les réalisations tissées soumises aux injonctions de l’Art-Maréchal restent rares, bien que ce savoir-faire traditionnel ait pu répondre aux valeurs de la Révolution Nationale. La célèbre formule prononcée dès le 25 juin 1940 par Pétain (Emmanuel Berl en étant la plume), et devenue un leitmotiv vichyste, exaltant la ruralité, l’enracinement, et, plus prosaïquement, l’agriculture, est illustrée ici de façon littérale, et synthétique : variété des travaux, de la végétation, des architectures, des animaux, … épanouis sous l’égide du régime de Vichy. Provenance : Collection Régine Deforges Bibliographie : Cat. Expo. Tapisseries 1925, Aubusson, Cité de la tapisserie, 2012Tapisserie d’Aubusson. 1943. -
Jardin sauvage
Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°6/8. 1970.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -
Flore des Baronnies
Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°1/6. 1974.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -
Féérie automnale
Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°EA2. 1977.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -
Kalinka
Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. Le titre de notre tapisserie, qui parlera surtout aux mélomanes, est une évocation littérale (mais en russe !) du sujet, « kalinka » signifiant obier.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°4/6. 1980. -
Les 3 Grâces
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. N°3/6. Circa 2000. -
Idylle pastorale
Georges Rougier, qui enseignait le dessin au collège d'Aubusson, a donné de nombreux cartons pour les ateliers d'Aubusson ou le Mobilier National, et côtoyé Marius Martin quand celui-ci dirigeait l'ENAD. Martin en fera, avec Maingonnat et Faureau, l'un des principaux protagonistes d'une esthétique picturale résolument tournée vers la tapisserie, qui s'exprimera notamment à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en 1925 (Rougier y aura d'ailleurs aussi son stand personnel !). Bibliographie : Cat. Expo. "Tapisseries 1925. Aubusson, Beauvais, les Gobelins à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris", Aubusson, Cité de la Tapisserie, 2012Tapisserie d'Aubusson. Circa 1930. -
Sirocco
Si elle se revendique surtout comme sculptrice, Hedva Ser a aussi conçu quelques cartons tissés chez Four à Aubusson, qui évoquent des paysages atmosphériques (il y a aussi « Esterel », « Pampa », « Océan »…), où nuages, reflets, ondes, dunes… sont restitués par des effets de matières et de grosseur de points.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N°2/6. Circa 1990. -
Pampa
Si elle se revendique surtout comme sculptrice, Hedva Ser a aussi conçu quelques cartons tissés chez Four à Aubusson, qui évoquent des paysages atmosphériques (il y a aussi « Esterel », « Sinaï », « Océan »…), où nuages, reflets, ondes, dunes… sont restitués par des effets de matières et de grosseur de points.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc,n°5/6. Circa 1990. -
Composition
Comme d'autres sculpteurs (Gilioli, Adam, Ubac...), Hairabédian s'est adonné à la tapisserie (son atelier a été situé en Creuse de 1975 à 1985). A défaut de volume, sa spectaculaire composition joue sur les tissages, le creusement de l'espace avec la chaîne vierge..., procédés de la "Nouvelle Tapisserie", à l'exception de la tridimensionnalité.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Henry. Avec son bolduc signé, n°1/1. 1984. -
L'oiseau de rêve
Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé. 1966.Enfant du pays, Henri de Jordan fait, à Perpignan, la connaissance de Firmin Bauby, à l’origine de l’atelier de céramique de San Vicens. Il y découvre la peinture sur céramique mais aussi la tapisserie, à travers Lurçat et Picart le Doux. Notre carton témoigne de cette influence : c’est l’œuvre d’un artiste encore tout jeune encore marqué par l’ombre tutélaire de ses aînés (Lurçat meurt d’ailleurs en cette même année 1966). -
Le merle blanc
Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. En représentant un oiseau aussi rare qu’un mouton à cinq pattes, Ilhe n’a pas de prétention ornithologique, il se veut simplement l’illustrateur d’une Nature faite de singularités.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1965. -
Petit bois
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc, signé de l’ artiste. Circa 1970.Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Petit bois » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe. -
Chantelune
Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Chantelune » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA II. Circa 1970. -
Les fruits d'or
Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1965.Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Les fruits d'or » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe. -
Roc neige
Tapisserie tissée par l'atelier L.M. à Calais. Avec son bolduc signé, n°EA1. Circa 1970.Verrier (il conçut de nombreux vitraux pour des édifices publics, notamment dans le Boulonnais), graveur, peintre, photographe, Lhotellier avait de nombreuses cordes à son arc. Typique de ses réalisations vers 1970, notre tapisserie témoigne de l’existence d’ateliers de tissage méconnus et capables de réalisations abouties, loin de ce qui se faisait alors à Aubusson. -
Sabulum
Important protagoniste de « la Nouvelle Tapisserie », tissé par Pierre Daquin, exposé à la galerie La Demeure dans les années 70, Jacques Brachet a, dès les années 50, une démarche innovante et expérimentale sur le médium, consacrée par la création de l’atelier d’art mural au Centre International d’études pédagogiques, à Sèvres, par la mise en scène de « la tapisserie en France, 1945-1985, la tradition vivante » à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, par la conception de ses tapisseries-actions jusqu’à nos jours. Les intuitions spécifiquement textiles (en dissociation d’avec la peinture) : invention de formes, recours à de nouvelles matières, thématiques naturelles,… prennent corps pour Brachet dans les années 70; il est alors proche de Pierre Daquin, qui tisse un certain nombre de ses tapisseries. S’il est connu pour ses sujets marins, l’inspiration de Brachet se tourne aussi vers le monde mineral (Sabulum = sable en latin), ce qui donne une saveur plus figurative à notre carton, avec une gageure : comment traduire le sable en laine ? Bibliographie : Cat. Expo. Jacques Brachet, mémoires océanes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1996Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA. 1973. -
Les épées d'or
Important protagoniste de « la Nouvelle Tapisserie », tissé par Pierre Daquin, exposé à la galerie La Demeure dans les années 70, Jacques Brachet a, dès les années 50, une démarche innovante et expérimentale sur le médium, consacrée par la création de l’atelier d’art mural au Centre International d’études pédagogiques, à Sèvres, par la mise en scène de « la tapisserie en France, 1945-1985, la tradition vivante » à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, par la conception de ses tapisseries-actions jusqu’à nos jours. Avant ses explorations des années 70, Brachet a conçu 6 cartons dans les années 50, qui connurent un succès très relatif (ce sont toutes des pièces uniques). Si le thème martial, et lié à la pratique de l’escrime, est inédit, l’esthétique est proche d’autres peintres-cartonniers de l’époque, Jullien par exemple. Bibliographie : Cat. Expo. Jacques Brachet, mémoires océanes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1996Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc. 1955. -
Le clown
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Hecquet. Avec son bolduc signé, n°1/1. 1974. -
La légende de Saint hubert
Adnet, à la tête de la Compagnie des Arts Français depuis 1928, souhaite redonner à la tapisserie une place éminente dans le décor intérieur, en n’imitant pas la Peinture, et en se contraignant aux tons comptés (dans une démarche parallèle à celle de Lurçat). Il sollicite pour cela, en même temps que Despierre, Coutaud, Planson, ou Brianchon. Féru d’art monumental (il concevra aussi des vitraux, des mosaïques, sera professeur puis chef de l’atelier d’art mural de l’Ecole nationale des Arts décoratifs), Despierre, après ces premières commandes pendant la guerre, sera régulièrement mis à contribution par les Manufactures nationales qui tisseront « la pêche », « la chasse », « le droit maritime », « le droit industriel et commercial »… au long des années 50 et 60. Les couleurs franches (les vêtements du personnage de gauche, dignes du maniérisme !), les figures denses et monumentales (typiques de l’époque comme de l’artiste), ne doivent pas éluder la signification de la tapisserie : un sujet religieux, vecteur de foi et d’espérance dans une période troublée (Saint-Saëns, Lurçat aussi sauront dissimuler le symbole derrière l’apparence). Un paradoxe, si l’on considère les préoccupations, essentiellement décoratives, d’Adnet. La Cité de la tapisserie d’Aubusson possède un exemplaire de cette tapisserie, inversée, et avec une bordure différente de la nôtre ; c’est celle qui est illustrée dans la bibliographie. Bibliographie : Cat. Exp. La tapisserie française du moyen âge à nos jours, Musée d’Art Moderne, Paris, 1946, n°247 Heng Michèle, Aubusson et la renaissance de la tapisserie, Histoire de l'art N° 11, 1990, Varia, Fig. 5 page 69 Cat. Exp. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Felletin, Eglise du château, 1992, reproduit p.20-21 Cat. Exp. Tapisserie et expressions du sacré, Aubusson, musée départemental de la tapisserie, 1999, reproduit p.36 Cat. Exp. Fantastiques chevauchées, le cheval en tapisserie, Aubusson, musée départemental de la tapisserie, 2008, reproduit p.63Tapisserie d’Aubusson tissée dans l' atelier Pinton pour la Compagnie des Arts Français. 1943. -
Banlieue Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Goubely. Avec son bolduc signé. 1945. Féru d'art mural dès 1937 (il participe à l'Exposition Internationale), Lagrange dessine ses premiers cartons en 1945, et devient l'un des membres fondateurs de l'A.P.C.T. D'abord expressionnistes (comme Matégot ou Tourlière), ses cartons (à partir de sa collaboration avec Pierre Baudouin) évoluent vers une stylisation qui aboutira dans les années 70 à des cartons faits de signes épurés dans des tons purs. Par ailleurs, au-delà de son rôle dans la renaissance de la tapisserie (et des commandes publiques afférentes), Lagrange sera Professeur à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, mais aussi un collaborateur régulier de Jacques Tati, un concepteur de décors monumentaux, enfin un artiste-peintre reconnu, proche d'Estève ou de Lapicque. “Banlieue”, ma première tapisserie tissée à Aubusson, raconte le spectacle des cardeurs de matelas faisant voler la laine dans les rues avec une curieuse machine”explique l’artiste. A ses débuts, Lagrange aborde, dans une veine réaliste, expressionniste même, les thèmes de la banlieue, des métiers (amusante mise en abyme sur le travail de la laine), de la vie quotidienne (cf. Guignebert “le marché aux puces”, contemporain) dans une veine aux antipodes de la cosmogonie de Lurçat. La tapisserie figure à l’exposition de 1946, et 2 exemplaires sont conserves dans des collections publiques, au Musée de la-Chaux-de -Fonds, et à celui du Pays d’Ussel. Bibliographie : Collectif, Muraille et laine, Editions Pierre Tisné, 1946, ill. n°58 Madeleine Jarry, La tapisserie, art du XXe siècle, Office du livre, 1974, ill. n°69 Cat. Exp. Lagrange, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1987, reproduit p.16-17 Cat. Exp. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Felletin, Eglise du château, 1992, reproduit p.29 Robert Guinot, Jacques Lagrange, les couleurs de la vie, Lucien Souny editeur, 2005, n°28, reproduit Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, reproduit p.73 J.J. et B. Wattel, Jacques Lagrange ets es toiles : peintures, tapisseries, cinéma, Editions Louvre Victoire, 2020, reproduit p.33, 70-71
-
Le verveux (variante) Tapisserie probablement d'Aubusson. Circa 1947. Féru d’art mural dès 1937 (il participe à l’Exposition Internationale), Lagrange dessine ses premiers cartons en 1945, et devient l’un des membres fondateurs de l’A.P.C.T. D’abord expressionnistes (comme Matégot ou Tourlière), ses cartons (à partir de sa collaboration avec Pierre Baudouin) évoluent vers une stylisation qui aboutira dans les années 70 à des cartons faits de signes épurés dans des tons purs. Par ailleurs, au-delà de son rôle dans la renaissance de la tapisserie (et des commandes publiques afférentes), Lagrange sera Professeur à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, mais aussi un collaborateur régulier de Jacques Tati, un concepteur de décors monumentaux, enfin un artiste-peintre reconnu, proche d’Estève ou de Lapicque. « Le verveux », grande tapisserie de 203 x 285 cm tissée chez Tabard (et dont le carton est conservé à la cité de la Tapisserie d’Aubusson) est caractéristique de la première veine de Lagrange : par son thème (l’anachronisme réaliste de vieux métiers exercés par de petites gens), par son traitement, expressionniste. Notre carton reprend ce thème, à plus petite échelle, avec un seul personnage, et une gamme chromatique différente, certains détails subsistant : la lampe à pétrole, les poissons bariolés au sol… Bibliographie : Cat. Exp. Lagrange, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1987 Robert Guinot, Jacques Lagrange, les couleurs de la vie, Lucien Souny editeur, 2005 J.J. et B. Wattel, Jacques Lagrange et ses toiles : peintures, tapisseries, cinéma, Editions Louvre Victoire, 2020
-
La branche
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. Avec son bolduc signé, n°1. 1961. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Carton (Bruzeau n°111) typique de l’artiste, à mélanger règne animal et végétal. Le traitement réaliste de l’écorce du bois contraste fortement avec l’aspect graphique et onirique de la composition. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Ô soleil
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°2/8. 1968.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « L’intégration d’un texte est d’abord un moyen de communiquer plus complètement avec le poète » a dit Picart le Doux (par un procédé dont usera aussi Lurçat), qui s’inspirera d’Apollinaire donc (« la jolie rousse ») mais aussi de Whitman, Eluard, Saint-John Perse,…Au poème d’amour, illustré par un cœur ardent et, de façon littérale, par un soleil, il associe un zodiaque, l’un de ses motifs récurrents. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°161 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Synthèse
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. 1961. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Synthèse » reprend les motifs de « Cosmogonie » (1948) : la connaissance scientifique est justement synthétisée par la présence d’un astrolabe, d’un compas, d’une pyramide, d’un livre d’histoire naturelle…. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, n°15 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, n°107 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Etoiles de neige
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. N°7/8. 1962.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le traitement de l’hiver est fait chez Picart le Doux de poncifs, chromatiques (teintes assourdies, marron, noir, blanc), et de motifs (branches décharnées, flocons-cercles) ; les étoiles de neige éponymes seront reprises dans « Solstice d’hiver » ou « Hommage à Vivaldi ». Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°122 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
La terre et la mer II
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hecquet. Avec son bolduc signé de la veuve de l'artiste, n°1/6. 1960. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Ce carton reprend, plus petit, le carton original (170 x 272 cm) de 1960. A cette époque, Picart le Doux commence ses cartons de type binaire, avec allégories conjuguées d’éléments. Une typologie se met en place (poissons + coquillage = mer ou eau, papillons+ racines = terre), que Picart le Doux utilisera jusqu’à la fin. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, n°103 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Sphère et colombes
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé de l’artiste. circa 1954.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,… Association typique de Picart le Doux, où la Nature (ordonnancée en un jardin à la française) peuplée de colombes côtoie une triple allégorie des lettres (le livre), des arts (la mandoline), des sciences (la sphère) : l’incarnation d’un art de vivre classique. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Le chalut
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé. 1952.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. “L’une des tapisseries les plus célèbres de Picart le Doux : l’organisation en est très serrée et les amples courbes du filet soulignent le parti d’une écriture large et simple.” : ainsi s’exprime Maurice Bruzeau dans la notice qu’il consacre à cette tapisserie (n°37 de son ouvrage). “Le Chalut” rejoint les thèmes marins omniprésents chez l’artiste, notamment dans ces années là : “Dieu Marin”, “La Sirène” “le Dauphin”, “Fruits de mer”, “Etoiles de mer”, dans une gamme de couleurs assourdies à base de kaki et de gris argenté. Ici, le traitement est plus documentaire (hormis la présence du trident) : c’est la pêche, telle qu’elle est vue par Picart le Doux. Bibliographie : Léon Moussinac, Jean Picart le Doux, Editions Cercle d’art,1964 (reproduit Pl.10) Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°4 Cat. Exp., Hommage à Jean Picart le Doux, Centre artistique et littéraire de Rochechouart, 1968 (reproduite) Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs du soleil, Editions Cercle d’art 1972 Cat.Exp. Jean Picart le Doux, Paris, Musée de la Poste, 1980 (reproduit) Cat. Exp. Picart le Doux, château d'Olonne, 1992, reproduit -
Automne-Hiver
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc, n°6/6. Circa 1975.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème des saisons est un poncif de l’histoire de la tapisserie que se sont entendus à réactiver les cartonniers du XXe siècle, Lurçat au premier rang d’entre eux (cf. sa tenture des Saisons commandée par l’Etat dès 1939). Chez Picart le Doux, l’inspiration est double : la Nature bien sûr, mais aussi la Musique; “l’Hiver”, traité de façon allégorique, l’un des cartons les plus connus de l’artiste date de 1950, mais c’est l'”Hommage à Vivaldi” de 1963, avec ses 4 saisons représentées de façon symbolique par des soleils colorés, émaillés de signes zodiacaux, et sources de végétation, que reprend notre carton en en transposant les motifs à l’horizontale. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 -
Le luth et les colombes
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°6/8. Circa 1955.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « Le luth et les colombes » reprend un carton plus dense et vaste de 1949, « les oiseaux s’envolent », censé symboliser la Libération, thème que l’on retrouve dans « la cage ouverte » de 1953. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°3 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
L’Homme et la Terre
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. 1962.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Au tournant des années 60, Picart le Doux conçoit une série de grands cartons (“le Temps”, “Galaxie”, “l’Homme et la Mer”,…), spectaculaires allégories centrées autour de l’Homme, au cœur de la Création. Dans notre synthétique « L’Homme et la Terre », Le vocabulaire, de ceps de vignes, épis de blé, corps humain irrigué de veines,… reprend d’autres cartons antérieurs de l’artiste. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°132 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Concert des oiseaux
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°4/6. Circa 1975.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème de la musique est fréquemment associé aux oiseaux chez Picart le Doux ; ce carton est une déclinaison tardive de « la harpe des forêts » de 1953. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Coquillage étoilé II
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°2/6. Circa 1975. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Coquillage étoilé » date de 1959, et le motif réapparaît alors régulièrement, dans « l’Eau et le Feu » (1959), « la Mer et la Terre » (1960) ou « l’Homme et la Mer » (1964)… comme une évocation marine. Notre carton recentre le motif, tandis qu’un autre, homonyme, se déploie à la verticale. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Amazonie
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1962. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Depuis « Orénoque », de 1956 (Bruzeau n°72), l’Amérique du Sud revient régulièrement chez Picart le Doux. Ici, « la huppe », carton vertical (Bruzeau n°97) est prolongé horizontalement par le fleuve habité de tortues, poissons,…, dans un bel effet décoratif. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°7 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, ill. n°129 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980, n°14 ill. -
Soleil d'août
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Braquenié. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1958. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème des moissons apparaît dès 1944 chez l’artiste (« La moisson », dont un exemplaire est conservé à la Cité de la Tapisserie à Aubusson), ainsi que les allégories des saisons. Le personnage à la faux reprend d’ailleurs celui de « l’Hiver », de 1950, une de ses tapisseries les plus célébrées. Ici, la composition est devenue monumentale. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, n°85 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Germination
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Henry. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°2/6. Circa 1980. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... La construction binaire est très répandue dans les cartons de Picart le Doux : elle permet l’évocation des complémentaires jour/nuit, ciel/mer, terre/mer…. Avec notre combinatoire se met en place une nouvelle association : la Nature est une, le soleil féconde les plantes, et permet la « Germination ». Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Trésor d'Amphitrite
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. Avec son bolduc déchiré. 1949. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Une synthèse (dès 1949 !) entre Mer et Musique, thèmes omniprésents chez l’artiste, dans une gamme chromatique inhabituelle. Le thème du trésor sous-marin sera repris de façon plus littérale chez Perrot, dans « Trésors enfouis » par exemple. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, n°18 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Les 3 papillons
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de la veuve de l'artiste, n°1/6. Circa 1980. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. S’il est un thème de prédilection chez Lurçat, le papillon est plus rare chez Picart le Doux. Même ici, et malgré le titre, leur présence est marginale : le carton reprend en fait, en mode mineur, « Lumière », de 1960. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Soleil orange
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. N°3/8. Circa 1963. -
Composition
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc, n°1/1. 1974.Jean Bazaine, comme nombre de ses contemporains, a toujours poursuivi une intense activité liée à l’art mural, dans des travaux à destination monumentale. S’il est surtout connu comme concepteur de vitraux ou de mosaïques, il a également réalisé des cartons de tapisserie, et ce, dès la fin des années 30. Ces réalisations rentrent dans le cadre d’un renouveau de l’art sacré dont Bazaine, surtout après la guerre, sera l’un des principaux protagonistes. Néanmoins, les créations de Bazaine ne sont pas destinées qu’à des édifices religieux. Sa maîtrise de l’art mural s’est exprimée dans des commandes de mosaïques, pour le bâtiment de l’UNESCO ou la Maison de la Radio, mais aussi de tapisseries, tissées dans les Manufactures Nationales, ou à Aubusson, pour le Palais de Justice de Lille, ou l’Hôtel de Ville de Strasbourg. C’est dans ce contexte que s’inscrit la commande de la Fédération Française du Bâtiment, pour son siège, au début des années 70 à un artiste reconnu, presque officiel (Grand Prix National des Arts en 64, exposition au Musée National d’Art Moderne en 1965), qui y répondra par notre vaste composition rythmique et lyrique, chromatiquement homogène : malheureusement, le bolduc, effacé, nous prive du titre de l’œuvre, chez un artiste qui ne se voulait pas abstrait. Provenance : Siège de la Fédération Française du Bâtiment -
Voyages, le 3e millénaire
S’il s’est fait connaître, à ses débuts, comme peintre de grands décors (pour la scène notamment), les incursions de Carzou dans la tapisserie sont relativement rares. On retrouve dans ce carton le style si caractéristique de l’artiste, fait d’entremêlement de lignes illustrant des sujets oniriques : le thème est une reprise du (seul) carton de Carzou tissé par les Manufactures Nationales, « l’invitation au voyage ». A l’orée du 3e millénaire (et à quelques mois de sa mort), l’artiste, régulier pourfendeur de la société moderne, a une singulière vision des voyages à venir, tournés vers l’aérostation et la marine à voile.Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier de Jacques Fadat. Certificat signé de l’artiste, n°1/1. 2000. -
Crescendo
Essentiellement graveur, Davo reproduit en tapisserie ses recherches sur le médium, à base d’oxydations liées aux métaux déposés sur la plaque de cuivre. Les effets obtenus sont transposés ici grâce aux reliefs que permet le tissage. La tapisserie est reproduite dans le classeur "Tapisserie d'Aubusson" édité par la Chambre de commerce et d'Industrie de Guéret au début des années 80 pour illustrer le savoir-faire des ateliers d'Aubusson.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Legoueix. Avec son bolduc, n°2/6. Circa 1980. -
Opaline
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1980. -
Equinoxe
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Dans une harmonie des couleurs sobre et nuancée, le thème de la table dressée prend une nouvelle résonance, comme écrasée par le soleil d’équinoxe, qui prend l’ascendant sur les habituelles natures mortes de gibier, langoustes, et mandoline. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1945. -
La chouette et l'étang
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Simone André. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1955.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. La chouette, cachée dans les feuillages, répond aux poissons de l’étang. Mondes animal, végétal, l’eau, le ciel…se répondent, dans un syncrétisme, ici harmonieux et apaisé. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -
Oiseaux et grappes
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Synthèse des motifs toujours : vignes, grappes, verres apparaissent d’habitude dans les tables dressées de l’artiste, tandis que les oiseaux répondent habituellement aux poissons. Moins de symboles ici, comme en témoigne le titre, purement descriptif, comme une évocation des nuisances subies par les vignerons. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -
Le basset
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1950.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Amateur de chiens, Lurçat avait des lévriers afghans. Si on les retrouve épisodiquement dans ses cartons, Lurçat n’arrive pas à s’abstraire de leur aspect : son « basset » (proche d’un autre carton intitulé « le chien vert », sans la chouette) n’en a que le nom. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -
L'étang
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1950.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Poissons dans leur habitat sont cernés de feuillages, dans une profusion habituelle à l’artiste. Un hibou, comme parfois, veille. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -
Deux lumières
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. A ses traditionnels motifs épars (étoiles, poissons, papillons….) grouillants, Lurçat joint 2 rais de lumière (d’où le titre) entrecroisés qui altèrent les couleurs sur leur trajet : on ne saurait mieux montrer que le soleil peut être un danger pour la tapisserie (un autre carton, « Coup de soleil »(autrefois en notre possession) témoigne, de façon encore plus explicite, du thème). Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Goubely-Gatien. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1955. -
Nappe blanche
Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Goubely. Circa 1955.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde »( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers), inachevé à sa mort. Le thème de la table dressée est un leitmotiv chez Lurçat, dès les années 40 (cf. Les quatre coins, 1943, Atelier Goubely-Gatien , Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine). Ces tables, parfois très "cornes d'abondance", et accompagnée souvent d'instruments de musique (mandoline en général) rappellent les tableaux de nature morte du XVIIe siècle, thème étranger d'ailleurs à la tapisserie d'alors. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -
Musique et coquillage
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1950.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Ce modèle (dont un exemplaire est conservé à la Cité de la Tapisserie, à Aubusson) est exemplaire du thème de la table dressée, un poncif chez Lurçat. L’association instrument de musique- coquillage renvoie par ailleurs à l’œuvre de Picart le doux. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 R. Guinot, la tapisserie d’Aubusson et de Felletin, Lucien Souny, 2009, ill. p.96 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -
Le grand-duc
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Les représentations naturalistes des animaux sont inhabituelles chez Lurçat (on pense plutôt à Maingonnat). Mais les fonds colorés en aplats segmentent et distinguent les différentes espèces, dans un cloisonnement contrastant caractéristique de l’artiste. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1950. -
Le grand été
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Si le titre renvoie à une saison, c’est plus à une évocation d’exotisme que nous convie Lurçat : le voyage en Amérique du Sud au mitan des années 50 a inspiré de nombreux cartons peuplés de colibris, de papillons, et d’une végétation exubérante. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc signé. 1957. -
Bel oiseau querelleur
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Notre tapisserie reprend un vers du « Coq » d’Aragon, évoqué de façon plus extensive dans « Oiseau de toutes les couleurs » (carton de 1948 dont un exemplaire est conservé à la Cité de la Tapisserie, à Aubusson). Le mot comme motif plastique est récurrent chez Lurçat ; ici, il permet une concordance thématique et symbolique (le coq), politique et historique (la Résistance, le PCF). Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc. 1948. -
Soleil couchant
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Le motif de la chouette (plutôt un hibou d’ailleurs) aux ailes déployées, figure tutélaire et protectrice, se déploie à partir des années 50. Une des photos les plus célèbres de l’artiste le montre d’ailleurs les bras écartés, les mains sur son crane chauve, avec derrière-dessus, une telle chouette. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1950. -
Le pêcheur
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Il s’agit d’un fragment inversé d’un carton de plus grande taille (250 x 180 cm). Les thèmes de la pêche et de la chasse, souvent en écho (le filet lui-même parfois servant à la capture d’oiseaux) est récurrent (cf. le carton « Chasse et pêche », vente Fraysse 19.10.2011 n°10, par exemple) : il illustre une confrontation de l’Homme à la Nature. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957, illustration n°17 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Braquenié. Avec un certificat signé de la veuve de l'artiste. Circa 1955. -
Le chien vert
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Amateur de chiens, Lurçat avait des lévriers afghans. Si on les retrouve littéralement dans ses cartons, le thème du chien, toujours environné de feuillages acérés, est omniprésent à la fin des années 40 : « Chien vert » est notamment proche du « Basset », contemporain. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat.Expo. Jean Lurçat, Nice, Musée des Ponchettes, 1968 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016, reproduit p.76 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat, la terre, le feu, l’eau, l’air, Perpignan, Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 2024Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. 1949. -
Les 2 compagnons
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Notre carton reprend, inversé, celui de « l’Homme » (dont un exemplaire est conservé au Musée d’Art Moderne de Paris), avec quelques modifications. Le propos est le même : intégré avec la Nature, dans les feuillages, enserré d’animaux (une chouette blottie contre son sein, le chien bleu-compagnon…), l’Homme est le pivot autour duquel gravite toute la Création. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1945. -
Rives
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Motifs foisonnants, végétaux et poissons, se répondent, mais dans une inversion typique de Lurçat, avec l’élément aquatique au-dessus des rives. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Goubely. Avec son bolduc. Circa 1955. -
Le sultan
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. « Le Sultan » est une reprise inversée de « Fanfares », avec des modifications de détail dans les plumages du coq. S’il est un leitmotiv chez Lurçat, le coq peut revêtir différentes significations : ici, en gloire, à grande échelle (3,5 m²), il témoigne de la Victoire de 1945 (notez les allusions tricolores), c’est un coq festif, déployé dans un foisonnement de plages colorées. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc signé. Circa 1945. -
Brochette
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. La brochette est discrète (dans certains cartons, Lurçat n’hésite pas à ficher des poissons sur des tridents), et les poissons apparaissent comme sur un étal, une disposition qui reprend le cloisonnement de ses fameuses armoires. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc signé. Circa 1955. -
Eve
L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers), inachevé à sa mort. La reprise, voire la fragmentation de cartons antérieurs est une caractériqtique de l'oeuvre de cartonnier de Lurçat : ainsi "Eve" est une citation inversée de "La Poésie", antépénultième panneau du"Chant du Monde". Ici, la figure humaine, longtemps disparue chez l'artiste, réapparaît : voulait-il à l'origine en faire une figure biblique, une incarnation de la femme, une évocation poétique, un signe du Zodiaque (la Vierge ?) ? Elle est devenue "Eve", probablement par la volonté de la veuve de l'artiste. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie tissée par l'atelier Fino à Portalegre. Avec son bolduc signé de la veuve de l'artiste. 1962. -
Hommage à Mozart
Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°5 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, ill. n°59 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. N° EA. 1955.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Les cartons consacrés à la musique sont très nombreux chez Picart le Doux : les genres, les œuvres (« la petite musique de nuit », autre titre de l'oeuvre, « les 4 saisons », par exemple), les compositeurs (« Hommage à Vivaldi », « Hommage à Bach » qui fera l’objet d’un timbre en 1980), les instruments (« Soleil-Lyre », « Harpe des mers »), les figures mythologiques (« Orphée »). Le plus souvent, ces motifs s’intègrent dans une nature bucolique émaillée d’oiseaux et de papillons dans une veine décorative propre à l’artiste. -
Le Méridien étoilé
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. circa 1948.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Notre carton reprend « Cosmogonie » (Bruzeau n°11), de 1948, à la verticale, sans la citation de Goethe. Le thème de l’astrolabe reviendra épisodiquement, notamment dans une tapisserie éponyme de 1955. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Les oiseaux s'envolent
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. Avec son bolduc. 1949. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Les oiseaux s’envolent » est censé symboliser la Libération, thème que l’on retrouve dans « la cage ouverte » de 1953. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Le compotier
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1956.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Le fond de treillage est un poncif chez Picart le Doux dans les années 50, incarné notamment dans « Nature morte à la fontaine », tissée aux Gobelins en 1952, expression d’un certain goût décoratif inspiré des tapisseries d’époques antérieures. « Le compotier » reprend « les fruits et la guitare », plus ample, tissé chez Berthaut en 1955. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, reproduit n°64 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -
Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Les algues (et plus largement le monde sous-marin) ont été un leitmotiv pour Picart le Doux tout au long de son parcours, depuis « les algues » de 1946 ; on peut citer « Spiralgues », « Buisson d’algues », « les algues vertes »,… « Les petites algues » reprend, à plus petite échelle, « les algues », carton de 260 x 250 cm, Leleu en étant l’éditeur. Les algues éponymes, telle une dentelle végétale, cernent un carreau dressé de coquillages et d’étoiles de mer, nature morte qui est le véritable sujet du carton. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980
Les petites algues
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -
L'oeil ébloui
Tapisserie tissée par l’atelier Clochard. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. Circa 1980.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. -
Soleils éteints
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1967.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste -
Destins
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1974.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste -
Composition
Tapisserie tissée par l'artiste. Avec son bolduc signé, et sa maquette. Circa 1980. -
Un matin
Artiste complet, qui pourtant disait n’être « ni peintre, ni dessinateur, ni affichiste, ni écrivain, ni graveur. Je ne suis ni abstrait, ni figuratif. … Je ne comprends pas mes images, et chacun est libre de les comprendre comme il veut. J’ai seulement essayé de fixer mes propres rêves, avec l’espoir que les autres y accrochent les leurs », Folon a rencontré un incroyable succès, depuis les illustrations pour les grands magazines américains dans les années 60, les nombreuses affiches, les œuvres présentées aux biennales de Venise et de Sao Paulo, les génériques pour Antenne2,….Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’il se soit intéressé aussi à la tapisserie (sa plus grande composition, 80 m² figure au Centre des Congrès de Monaco, tissée, comme les autres, par l’atelier Four), dans son style clair et mesuré, et dont l’inspiration n’est pas sans rappeler son compatriote Magritte. L’esthétique de notre tapisserie est très inspirée de l’aquarelle (teintes pâles, effets de dégradés,…), médium de prédilection de Folon, ce qui lui donne une spécificité aux antipodes des créations d’autres peintres-cartonniers contemporains. L’œil-soleil, leitmotiv chez Folon, surplombant un paysage désertique ou maritime, témoigne de son onirisme singulier. Bibliographie : Léon-Louis Sosset, Tapisserie contemporaine en Belgique, Perron, 1989, reproduite p.138Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N°EA2/2. 1984. -
Composition
Artiste complet, qui pourtant disait n’être « ni peintre, ni dessinateur, ni affichiste, ni écrivain, ni graveur. Je ne suis ni abstrait, ni figuratif. … Je ne comprends pas mes images, et chacun est libre de les comprendre comme il veut. J’ai seulement essayé de fixer mes propres rêves, avec l’espoir que les autres y accrochent les leurs », Folon a rencontré un incroyable succès, depuis les illustrations pour les grands magazines américains dans les années 60, les nombreuses affiches, les œuvres présentées aux biennales de Venise et de Sao Paulo, les génériques pour Antenne2,….Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’il se soit intéressé aussi à la tapisserie (sa plus grande composition, 80 m² figure au Centre des Congrès de Monaco, tissée, comme les autres, par l’atelier Four), dans son style clair et mesuré, et dont l’inspiration n’est pas sans rappeler son compatriote Magritte. L’esthétique de notre tapisserie est très inspirée de l’aquarelle (teintes pâles, effets de dégradés,…), médium de prédilection de Folon, ce qui lui donne une spécificité aux antipodes des créations d’autres peintres-cartonniers contemporains. L’œil-soleil, leitmotiv chez Folon, surplombant un paysage, témoigne de son onirisme singulier. Bibliographie : Léon-Louis Sosset, Tapisserie contemporaine en Belgique, Perron, 1989, reproduite p.138Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N°EA2. Circa 1980. -
Composition
Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Four. N°EA2/2. Circa 1980.Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style abstrait parfois émaillé d’astres. -
Ville
Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style abstrait parfois émaillé d’astres.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l' atelier Four. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA. Circa 1970. -
Composition
Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Four. N°6/6. Circa 1980.Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style le plus souvent abstrait, sauf exception, comme en témoigne ici la présence des 2 oiseaux. -
Jeux interplanétaires
Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style abstrait parfois émaillé d’astres.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Four. Avec son bolduc, n°EA. Circa 1970. -
Matin d'été
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Laurent. Avec son bolduc signé, n°2/6. 1983.Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four. Si ses cartons sont le plus souvent abstraits, il y aussi un versant bucolique, que n’aurait pas renié Fumeron, à sa production. -
La voix du reliquaire
Elève de Wogensky à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués, Sautour-Gaillard voit son premier carton tissé en 1971 par l’atelier Legoueix (une collaboration qui ne s’est pas démentie par la suite), et il multiplie ensuite les projets monumentaux, dont le plus spectaculaire est « Pour un certain idéal », tenture de 17 tapisseries sur le thème de l’olympisme (conservée au Musée de l’Olympisme de Lausanne). D’ abord proche de l’abstraction lyrique, l’artiste réalise dans les années 90 des cartons à base d’assemblages de motifs décoratifs, de textures et de figures, apparemment superposés et comme unifiés dans le tissage. « La voix du reliquaire » témoigne de la proximité de l’artiste à ses débuts avec l’abstraction lyrique d’un Soulages ou d’un Schneider. On retrouve, transposés dans la laine, les effets de gestes, de coulures même, propres aux artistes de »l’envolée lyrique », dans une gamme de couleurs extrêmement réduite. Bibliographie : D. Cavelier, Jean-René Sautour-Gaillard, la déchirure, Lelivredart, 2013, reproduite p.163Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Bolduc signé de l’artiste, n°1/3. 1975. -
Le secret
Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°I/VI. 1971.Bibliographie : Cat. Expo. Jorj Morin, tapisseries, gravures à l'eau-forte, et quelques stèles de mosaïques, Paris, galerie La Demeure, 1974, ill. Cat. Expo. Jorj Morin, tapisseries, peintures, gravures, mosaïques, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1991-1992Exerçant le dessin publicitaire après son établissement à Nantes au début des années 30, Morin pratique, concurremment, la peinture et la gravure, figuratives d’abord, puis dans un style abstrait à partir de 1954. Son intérêt pour la décoration monumentale s’exprime dans la mosaïque (notamment dans le cadre de la loi du 1% artistique, pour des établissements scolaires du pays nantais surtout), mais aussi dans la tapisserie. Dès 1952 en effet, il se voit commander des tapisseries à sujet religieux qui seront tissés par l’atelier Plasse le Caisne (qui oeuvre aussi pour Manessier, Le Moal….), avant de travailler, à partir de 1969, avec l’atelier de Saint-Cyr de Pierre Daquin, l’un des protagonistes majeurs en France de la Nouvelle Tapisserie, et d’être exposé à la galerie la Demeure. Par la suite, et jusqu’en 1982, d’autres cartons seront tissés par les ateliers de l’Ecole Régionale des Beaux-Arts d’Angers, puis par la propre fille de l’artiste, elle-même lissière. Avec Daquin comme lissier (et comme celui- ci dans ses propres œuvres), la matière devient mode d’expression, la maîtrise technique un absolu maîtrisé : les surfaces sont animées, vibrantes des différences de textures, de points…et les poétiques cartons de Morin, aux signes délicatement symétrisés, idéalement interprétés. -
Normands sur la Seine
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1. 1961.Lars Gynning fait partie de ces nombreux artistes de toutes nationalités qui seront tissés à Aubusson dans les années 50-70, lorsque la tapisserie était un medium artistique incontournable. D’un point de vue thématique, notre carton permet l’entrecroisement, à travers les siècles, des relations franco-scandinaves à travers le prisme des incursions vikings remontant la Seine : évidemment, la tapisserie de Bayeux vient à l’esprit. Mais plutôt qu’un témoignage historico-diplomatique de Gynning, le carton illustre en fait une chanson d’Evart Taube, le poète-barde national suédois du XXe siècle (dont le texte figure en bas de la composition) ; hormis le sujet stricto sensu, la traduction tissée d’une chanson de geste épique renvoie à la grande tradition médiévale de la tapisserie, modèle indépassable pour de nombreux peintres-cartonniers de l’époque. L’esthétique, résolument moderne et influencée par le cubisme , revivifie quant à elle l’antique sujet. -
Les enfants
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc illisible, n°EA1. Circa 1980. Toffoli s’est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des enfants jouant observés dans une rue de l'autre côté de la planète. -
Coucher de soleil sur l'Orient
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc, n°3/6. Circa 1990. Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des jonques observées lors de séjours en Extrême-Orient. -
Les jonques
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1980. Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des jonques observées lors de séjours en Extrême-Orient. -
Voiles d'Orient
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc, n°EA. Circa 1980. Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des jonques observées lors de séjours en Extrême-Orient. -
Byzance
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc, n°3/6. Circa 1980. Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : Sainte-Sophie et le Bosphore garantissent le voyage. -
Envie et Gourmandise (les pêchés capitaux)
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l’artiste. 1956.Après l’habituel passage par la décoration murales dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratives, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. “Il traite…. une courte série bien savoureuse des vices qui dénote un humour malicieux et renouvelle de façon très personnelle ces thèmes si fréquemment utilisés au Moyen Age.” (Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983, p.4). Ici, le sujet est prétexte à des représentations d’animaux tels qu’on les trouve chez ses contemporains, notamment Picart le Doux dont l’artiste était proche. D’après le catalogue de l’exposition de 1983 (qui fait office de Catalogue Raisonné, et où notre oeuvre porte le numéro 53), une seule tapisserie a été tissée d’après ce carton : il s’agit d’une pièce unique. Bibliographie : Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983 -
Faiseur d'étoiles
Après l’habituel passage par la décoration murales dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratives, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. L’intérêt de Jullien pour les sciences et les techniques s’est très tôt manifesté, dès la fin des années 50, et il reste un cas assez rare, et éphémère, en tapisserie (malgré les incursions de Matégot, Maurice André, et de Millecamps surtout), qui s’inscrit dans le contexte des 30 glorieuses. Jullien conçoit, en 1961, sous le titre « Espace Poétique de l’Industrie » une exposition de ses créations sur le sujet où, à côté de « Diamant noir » (la mine), « Métropolis » (les raffineries), …., figure notre «faiseur d’étoiles », allégorie de la soudure autogène. Bibliographie : Cat. Expo. Espace poétique de l'industrie, galerie La Demeure, 1961 (reproduite) Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier André. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°3/3. 1957. -
Sarabande
Après l’habituel passage par la décoration murale dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratifs, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. Avant « Passacaille » de 1955, Jullien témoigne ici de son intérêt pour la danse et la musique, thèmes récurrents mais rarement illustrés de façon aussi explicite, avec guitare et hautbois joués comme par enchantement. Peut-être les oiseaux évoquent-ils les notes de musique qui courent le long du phylactère-partition ? Bibliographie : Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. 1954. -
Le violon printanier
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé, n°2/6. 1956. -
Le réviseur
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/8. Circa 1980.Marc Petit rencontre Jean Lurçat en 1954, séjourne à Aubusson en 1955, expose pour la première fois à La Demeure en 1956, devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1958. A partir de ces débuts fulgurants, il produit des centaines de cartons, dans un style très personnel, où des échassiers croisent des funambules dans des paysages oniriques. Amusant carton, sorte d’antithèse figurée de l’auteur et son réviseur : elle s’exprime par cette curieuse association du poisson et de l’oiseau, dans une gamme chromatique extrêmement vive. -
Escorte
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud pour la galerie Verrière. Avec son bolduc signé, n°EA. Circa 1970.Marc Petit rencontre Jean Lurçat en 1954, séjourne à Aubusson en 1955, expose pour la première fois à La Demeure en 1956, devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1958. A partir de ces débuts fulgurants, il produit des centaines de cartons, dans un style très personnel, où des échassiers croisent des funambules dans des paysages oniriques. Economie de moyens toujours, avec de larges aplats et une gamme chromatique resserrée, pour un thème singulier : un astre au fond des mers, « escorté » de poissons inquiétants, une singulière aube (leitmotiv chez l’artiste) de la vie. -
Bel canto
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. N°4. 1964.Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Si la Musique est une permanence dans l’œuvre de Saint-Saëns, son évolution stylistique dans les années 60 vers un art plus informel, biomorphique, affecte le traitement du sujet ; mais un tel lyrisme ne convient-il pas idéalement à l’expression du « Bel Canto » ? Bibliographie : Cat. Expo. La tapisserie française du Moyen-âge à nos jours, Paris, Musée d’art moderne, 1946 Cat. Expo. Saint-Saëns, Pars, galerie La Demeure, 1970, ill. Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998 -
Le paon
Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autour de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Le bestiaire de Saint-Saëns reste moins fourni que celui de ses pairs, Lurçat, Perrot, ou dom Robert, principal illustrateur du paon. Ici, le traitement, comme hors sol, d’un motif similaire (bien que ressemblant plus à un coq qu’à un paon), témoigne de la variété de solutions des peintres-cartonniers de l’époque. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie tissée par l’atelier Baudonnet. Avec son bolduc. 1959. -
Coq rouge
Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : « les Vierges folles », « Thésée et le Minotaure ». A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Le thème du coq, déjà présent dans le « réveille-matin »de 1959 reste une rareté chez Saint- Säens (comparé à Lurçat notamment). L’évolution stylistique est flagrante : formes souples et sinueuses, couleurs ardentes, motif épuré, comme un dessin à la craie (rouge) sur un tableau. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. N°1/6. 1974. -
Electricité
Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : « les Vierges folles », « Thésée et le Minotaure ». A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. « L’éclair » [autre nom de notre carton]… témoigne de l’orientation nouvelle de Saint-Saëns, sensible dès les années 60 ; il évoque les forces cosmiques [ou, avec notre titre, les phénomènes physiques] moins par la précision du dessin que par la puissance, la stridence même de la couleur ….Cette tapisserie orna l’affiche de l’Aérospatiale lors de l’inauguration de son Centre Culturel à Toulouse en 1971», nous dit Michèle Heng, dans le catalogue de l’exposition d’Aubusson. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987, reproduit p.47 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1970. -
Soleil
Lurçat sollicite Saint-Saëns, d'abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d'oeuvre allégoriques, tapisseries d'indignation, de combat, de résistance : "les Vierges folles", "Thésée et le Minotaure". A l'issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l'écriture spécifique que requiert la tapisserie,...) au sein de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu'elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell'arte, les mythes grecs,..., sublimés par l'éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Dans les années 60, Saint-Saëns évolue vers un style plus abstrait aux couleurs acides fortement contrastées, et accentue son intérêts pour les grands phénomènes de la Nature (« les saisons », l’éclair »…) Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie tissée par l’atelier Baudonnet. N°1/6. Circa 1970. -
Les buveurs
Lurçat sollicite Saint-Saëns, d'abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d'oeuvre allégoriques, tapisseries d'indignation, de combat, de résistance : "les Vierges folles", "Thésée et le Minotaure". A l'issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l'écriture spécifique que requiert la tapisserie,...) au sein de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu'elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell'arte, les mythes grecs,..., sublimés par l'éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. « Le premier exemplaire des Buveurs fut une commande d ‘un ami de Saint-Saëns…. Le carton des Buveurs , tissé à 8 exemplaires revint comme une pomme de discorde dans la correspondance Tabard/ Saint-Saëns, à cause de son coût de tissage. les Buveurs témoignent d’une solide joie de vivre et se rattachent au thème fécond de la vigne et des Saisons… » ( Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, p.26). Le contraste thématique est saisissant d’avec les précédents cartons de l’artiste : Orion, Thésée, les vierges folles,…Il retrouvera cette légèreté dans le braconnier ou le bouquet . Un exemplaire de la tapisserie a figuré à l’exposition de 1946 du Musée National d’Art Moderne « la tapisserie française du Moyen-âge à nos jours » (n°297). Bibliographie : Jean Lurçat, Tapisserie Française, Bordas, 1947, reproduite pl.42 Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998, reproduit p.26 Cat. Expo. Tissages d'ateliers, tissages d'artistes, dix ans d'enrichissement des collections, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2004, reproduit p.85Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. 1944. -
Oiseaux et feuillages
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1961. Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. "[Ce carton] fut un succès (7 exemplaires) et il y a 2 versions : l'une à fond bordeaux, l'autre à fond noir. Une fois encore Saint-Saëns fait référence à la grande tradition des verdures peuplées d'animaux et de fleurs, art de délassement sans prétention...." (Michèle Heng dans Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987, p.34) Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, Paris, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998 -
Le jardin d'amour
Tapisserie, probablement d'Aubusson. 1947. Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. "Le jardin d'amour", allégorie évocatrice du Paradis terrestre parfois illustrée au Moyen-âge et à la Renaissance témoigne des références classiques de Saint-Saëns qui, la même année, concevra "Orphée" ou "la Comédie italienne" : théâtre, mythes antiques ou références bibliques (on pense aussi aux "Vierges folles") sont alors des sources d'inspiration omniprésentes. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998 -
Aubusson
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Goubely. 1940.L’Œuvre tissée de Gromaire est modeste : 11 cartons, conçus entre 1938 et 1944, la plupart à Aubusson même. « Ses constructions rigoureuses, ses simplifications, son goût de la grande composition et des grandes idées fondamentales, sa science de coloriste et pour tout résumer sa suprême qualité de maître et d’ouvrier, tout cela devait faire de lui un des plus parfaits tapissiers de son temps », pourra dire Jean Cassou (Cat. Expo. Marcel Gromaire, Paris, Musée National d’art moderne, 1963). C’est Guillaume Janneau, à la tête du Mobilier National , qui fait appel à lui en 1938, persuadé que son style (simplification des formes, dessin géométrique cerné de noirs, influence du cubisme, palette limitée …) répondra avantageusement aux problèmes esthétiques nouveaux que doit résoudre la tapisserie pour renaître (gammes de couleurs simplifiées, cartons synthétiques,…) : d’abord avec une commande sur le thème des quatre éléments, suivie d’une autre (« les Saisons »), destinée à être exécutée à Aubusson. Gromaire, en 1940 y rejoint Lurçat et Dubreuil. Travaillant seul, méticuleusement (de nombreux dessins sont préparatoires au carton, peint, et non numéroté comme chez Lurçat), en étroite collaboration avec Suzanne Goubely, qui tissera tous ses cartons, il passe 4 ans à Aubusson, vouant toutes ses forces créatives à la tapisserie. A l’issue de la guerre, il quitte la Creuse, et ne réalisera plus de cartons, laissant à Lurçat la place de grand initiateur du renouveau de la tapisserie. « Aubusson» est l’un des 5 cartons conçus par Gromaire pour l’atelier Goubely pendant la Guerre , et il est emblématique de son style « en vitrail », foisonnant et géométrisé. Et si l’on reconnaît quelques-uns des monuments emblématiques d’Aubusson (la tour de l’horloge, l’église Ste-Croix…), que découvre alors Gromaire, la ville apparaît comme à l’étroit, dans une nature rude et farouche (à laquelle l’artiste s’est montré particulièrement sensible, comme en témoignent ses nombreux dessins) faite de falaises et de cours d’eau tumultueux. De façon intéressante, un exemplaire, retissé en 1960, a figuré sur le paquebot « France », seule tapisserie dont la conception est antérieure à la commande du décor ; quel meilleur symbole de ce qu’un medium (la tapisserie), et un sujet (la terre de France, ses paysages, ses terroirs), vecteurs de traditions, pouvaient simultanément incarner la modernité que portaient le « style France » (Bruno Foucart), et le paquebot « France » lui-même. Bibliographie : Le Point, Aubusson et la renaissance de la tapisserie, mars 1946, ill. Formes et couleurs, n°5-6, 1942, ill. L’amour de l’art, la tapisserie Française, 1946, ill. p.185 Jean Lurçat, Tapisserie française, Bordas, 1947 J. Cassou, M. Damain, R. Moutard-Uldry, la tapisserie française et les peintres cartonniers, Tel, 1957 Colloque, Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Eglise de Felletin, 1992, ill. p. 25 (et détail en couverture) Cat. Expo., Gromaire, œuvre tissée, Aubusson, Musée de la tapisserie, 1995, ill. p. 53 (et en couverture) Cat. Expo. La manufacture des Gobelins dans la première moitié du XXe siècle, Beauvais, Galerie nationale de la tapisserie, 1999 Armelle Bouchet Mazas, le paquebot France, Paris, 2006, ill. p.67 Aubusson, Cité internationale de la tapisserie, guide du visiteur, 2016, ill.p.57 -
Le verger
De la prolifique école belge de tapisserie moderne, Mary Dambiermont, qui en est l’une des protagonistes les plus sensibles, est résolument orientée vers la figuration. Ses débuts en tapisserie, à 24 ans, en 1956, préludent à une collaboration étroite avec la maison Braquenié, dès 1957, puis aux participations à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, et aux 2 premières Biennales de tapisserie de Lausanne en 1962 et 1965. Son univers est singulier, fait de personnages hiératiques, souvent féminins, déployés dans des paysages oniriques, étranges et parfois inquiétants. Notre carton, exposé à la biennale de Lausanne, est une évocation d’ampleur du thème, contemporain, de l’enclos (20 tapisseries exposées en 1966), lui-même écho de l’ »hortus conclusus « médiéval. Bibliographie : Cat. Expo. 2e biennale internationale de la tapisserie, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, 1965, ill. p.19 Paul Caso, Mary Dambiermont, Editions Arts et voyages, 1975, ill p.42-43Tapisserie tissée par l'atelier Braquenié. Avec son bolduc. 1965. -
La sylve
De la prolifique école belge de tapisserie moderne, Mary Dambiermont, qui en est l’une des protagonistes les plus sensibles, est résolument orientée vers la figuration. Ses débuts en tapisserie, à 24 ans, en 1956, préludent à une collaboration étroite avec la maison Braquenié, dès 1957, puis aux participations à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, et aux 2 premières Biennales de tapisserie de Lausanne en 1962 et 1965. Son univers est singulier, fait de personnages hiératiques, souvent féminins, déployés dans des paysages oniriques, étranges et parfois inquiétants. Parfois même, mais rarement avec l’ampleur de notre carton (12 m² !), la Nature se suffit à elle-même, écartant toute narration, en écho à des âges passés de l’Histoire de la Tapisserie : « Verdure du XXe siècle, elle établit les arcs-boutants d’une forêt immuable. » (Paul Caso, Mary Dambiermont, p.56) Bibliographie : Paul Caso, Mary Dambiermont, Editions Arts et voyages, 1975, ill p.54-55Tapisserie tissée par l'atelier Braquenié. Avec son bolduc. 1968. -
Enclos végétal
De la prolifique école belge de tapisserie moderne, Mary Dambiermont, qui en est l’une des protagonistes les plus sensibles, est résolument orientée vers la figuration. Ses débuts en tapisserie, à 24 ans, en 1956, préludent à une collaboration étroite avec la maison Braquenié, dès 1957, puis aux participations à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, et aux 2 premières Biennales de tapisserie de Lausanne en 1962 et 1965. Son univers est singulier, fait de personnages hiératiques, souvent féminins, déployés dans des paysages oniriques, étranges et parfois inquiétants. Elle expose en 1966 20 tapisseries sur le thème de l’enclos : si les clôtures y sont absentes, peut-être faut-il y voir néanmoins une allusion à l’ »hortus conclusus » médiéval. Bibliographie : Paul Caso, Mary Dambiermont, Editions Arts et voyages, 1975, ill p.110Tapisserie tissée par l'atelier Braquenié. Circa 1965. -
Remous
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Circa 1960.Matégot, d’abord décorateur, puis créateur d’objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d’abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de nombreuses expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales (“Rouen”, 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI…) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d’autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l’abstraction, lyrique d’abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés… Remous est un témoignage de l’oeuvre de Matégot vers 1960 : lyrisme, jeu sur les transparences, appel à la virtuosité technique des lissiers (passages de tons, dégradés, …). Son titre évocateur rappelle également l’intérêt de l’artiste pour des sujets aquatiques (cf. ses “Régates”) traités de façon abstraite-métaphorique. Bibliographie : Cat. Exp. Les tapisseries de Mathieu Matégot, galerie La Demeure, 1962 (notre tapisserie y est reproduite) Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991 -
Matégot, d’abord décorateur, puis créateur d’objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d’abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de multiples expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales (« Rouen », 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI…) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d’autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l’abstraction, lyrique d’abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés… « Structure et lumière » a valeur programmatique : à l’époque, les tapisseries de Matégot sont fortement contrastées, et visent à des effets de transparence, comme de vitraux (cf. »Piège de lumière », « Ombres et lumières »….). Quant à la « structure », elle renvoie indifféremment au travail d’architecte-décorateur de Matégot, dont la fonction est d’agencer l’espace, de l’occuper, mais, surtout, à organiser l’espace même de la tapisserie, nonobstant son apparent lyrisme désordonné. Bibliographie : Madeleine Jarry, la Tapisserie art du XXe siècle, Office du Livre, 1974, reproduite n°115 Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991, reproduite p.44 Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Editions Norma, 2014, reproduite p.335 (avec l’artiste devant lors de l’exposition de 1990)
Structure et lumière
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/6. 1964. -
Matégot, d'abord décorateur, puis créateur d'objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d'abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de multiples expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales ("Rouen", 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI...) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d'autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l'abstraction, lyrique d'abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés... Notre carton reprend un titre déjà employé en 1954 : le traitement témoigne de l’évolution esthétique de Matégot vers des formes moins cloisonnées, plus souples. Il rentre dans un corpus important de tapisseries aux intonations exotiques : « Acapulco », « Mindanao », « Linarès »… Bibliographie : Waldemar Georges, Mathieu Matégot, numéro spécial Prisme des Arts, 1957 Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991, reproduit p.33 Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Editions Norma, 2014
Santa Barbara II
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°2/6. 1960. -
Icare
Matégot, d'abord décorateur, puis créateur d'objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d'abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de multiples expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales ("Rouen", 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI...) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d'autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l'abstraction, lyrique d'abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés... Si, à cette époque, l’intérêt pour l’aéronautique est très fort chez Matégot (sa tapisserie pour Orly notamment, date de 1959, « Cap Canaveral » de 1958…), il rejoint ici son goût pour le traitement des grands mythes : Icare (il y eût aussi « Vulcain », « Dédale »…), sert de transition, dans un traitement identique (à comparer justement avec « Orly »), pour évoquer la même conquête de l’Air. Bibliographie : Waldemar Georges, Mathieu Matégot, numéro spécial Prisme des Arts, 1957 Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991, reproduite p.31 Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Editions Norma, 2014Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Tabard. N°1/6. 1960. -
Matégot, d'abord décorateur, puis créateur d'objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d'abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de multiples expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales ("Rouen", 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI...) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d'autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l'abstraction, lyrique d'abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés... La gamme chromatique « camouflage » annonce les cartons ultérieurs de l’artiste mais le traitement lyrique entre ombres et lumières reste caractéristique du milieu des années 60 : si le sujet (les fonds marins) est rare, on retrouve les habituels effets de transparence rendus par de subtils dégradés dans une gamme chromatique limitée. Bibliographie : Waldemar Georges, Mathieu Matégot, numéro spécial Prisme des Arts, 1957 Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991 Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Editions Norma, 2014
Algues en profondeurs
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/6. Circa 1960. -
Matégot, d'abord décorateur, puis créateur d'objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d'abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de multiples expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales ("Rouen", 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI...) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d'autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l'abstraction, lyrique d'abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés... Notre carton rentre dans un corpus important de tapisseries aux intonations exotiques : « Acapulco », « Mindanao », « Santa Cruz »… mais dont le traitement est abstrait. A cette époque, ses tapisseries sont résolument cloisonnées (mais pas géométriques) avant la phase plus lyrique des années 60. Bibliographie : J. Cassou, M. Damain, R. Moutard-Uldry, la tapisserie française et les peintres cartonniers, Tel, 1957, ill. p.141 Waldemar Georges, Mathieu Matégot, numéro spécial Prisme des Arts, 1957, reproduite Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991, reproduit p.33 Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Editions Norma, 2014, reproduite p.96 au Salon des Artistes décorateurs de 1954
Linarès
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. 1954. -
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton.
Composition
N°1/6. Circa 1970.Maurice André a séjourné Aubusson pendant toute la guerre. Fondateur du groupe coopératif « Tapisserie de France », et membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), il développe une esthétique personnelle, loin de Lurçat, fait de rigoureux aplats cubisants, dans une gamme chromatique souvent épurée, et reçoit d’ambitieuses commandes publiques, pour le Conseil de l’Europe à Strasbourg ( « L’Europe unie dans le Travail et la Paix »), ou le Pavillon Français pour l’Exposition de 1958 à Bruxelles (« La Technique moderne au service de l’Homme »). Tout naturellement (et comme Wogensky, Prassinos,…), il évolue ensuite vers l’abstraction, d’abord plutôt lyrique puis dans un style de plus en plus géométrique, dans une trajectoire très proche de celle de Matégot. Dans l’ultime style d’André, la géométrie et ses aplats sont tempérés d’hachures, rayures et autres dégradés. -
Linéaire
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1974.Maurice André a séjourné Aubusson pendant toute la guerre. Fondateur du groupe coopératif « Tapisserie de France », et membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), il développe une esthétique personnelle, loin de Lurçat, fait de rigoureux aplats cubisants, dans une gamme chromatique souvent épurée, et reçoit d’ambitieuses commandes publiques, pour le Conseil de l’Europe à Strasbourg ( « L’Europe unie dans le Travail et la Paix »), ou le Pavillon Français pour l’Exposition de 1958 à Bruxelles (« La Technique moderne au service de l’Homme »). Tout naturellement (et comme Wogensky, Prassinos,…), il évolue ensuite vers l’abstraction, d’abord plutôt lyrique puis dans un style de plus en plus géométrique, dans une trajectoire très proche de celle de Matégot. Dans l’ultime style d’André, la géométrie et ses aplats sont tempérés d’hachures, rayures et autres dégradés. -
Aubusson
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Andraud-Dethève. 1943.Maurice André a séjourné à Aubusson pendant toute la guerre. Fondateur du groupe coopératif « Tapisserie de France », et membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), il développe une esthétique personnelle, loin de Lurçat, fait de rigoureux aplats cubisants, dans une gamme chromatique souvent épurée, et reçoit d’ambitieuses commandes publiques, pour le Conseil de l’Europe à Strasbourg ( « L’Europe unie dans le Travail et la Paix »), ou le Pavillon Français pour l’Exposition de 1958 à Bruxelles (« La Technique moderne au service de l’Homme »). Tout naturellement (et comme Wogensky, Prassinos,…), il évolue ensuite vers l’abstraction, d’abord plutôt lyrique puis dans un style de plus en plus géométrique, dans une trajectoire très proche de celle de Matégot. Premier carton de Maurice André, “Aubusson” témoigne à la fois de son adhésion aux principes techniques de Lurçat (tons comptés, aplats…) et de ce qui l’en distingue en termes esthétiques. (de même que de Gromaire, qui a traité le même sujet quelques années auparavant). C’est en fait de Dubreuil, dont il est le gendre, qu’il se montre alors proche; son émancipation stylistique viendra peu après. L’importance historique de ce carton est indéniable: il est l’un des rares à illustrer la ville (encore plus synthétisée que chez Gromaire) à une époque où la Renaissance de la Tapisserie n’est encore qu’embryonnaire. -
Les Champs-Elysées
La place, conséquente et particulière, qu’occupe Maurice Brianchon dans la rénovation de la tapisserie tient à ses relations avec Jacques Adnet. Enseignant à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, Brianchon réalise des décors muraux ainsi que plusieurs décors de théâtre, et, pendant la guerre, 6 cartons pour la Compagnie des Arts Français (qui seront, avec les 2 consentis aux Manufactures Nationales, les seuls de l’artiste). Si son style le rapproche des Nabis (et singulièrement de Vuillard), ses thèmes, en tapisserie, renvoient à la grande tradition française, dont la Compagnie des Arts Français se veut alors l’incarnation : faunes, divinités, spectacles anachroniques,…. sont évoqués de façon poétique et onirique, très précieuse et raffinée. "Le Ballet", carton tissé aux Gobelins est contemporain; s'il conserve ici la composition générale (acteurs sur "les planches" dans des costumes proches de ceux alors conçus par l'artiste pour les "Fausses confidences" de Marivaux, décors latéraux, perspective...), Brianchon fait ici le choix de la monochromie et, une fois n'est pas coutume, le carton tissé dans les ateliers privés est de plus grandes dimensions que celui exécuté dans les Manufactures Nationales. Bibliographie : J. Cassou, M. Damain, R. Moutard-Uldry, la tapisserie française et les peintres-cartonniers, Editions Tel, 1957 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la Tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1992, ill. n°9 Cat. Expo. Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais sous la IVe République, Beauvais, galerie nationale de la tapisserie, 1997Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton pour la Compagnie des Arts Français. 1945. -
Danseuses cambodgiennes
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc de la galerie Verrière, n°1/4. Circa 1965.Méconnue aujourd’hui, la contribution de Maurice Ferréol, dans les années 60, à la tapisserie figurative, est tout à fait remarquable. Il s’est imposé comme une sorte d’imagier populaire, où l’emploi des couleurs pures permet d’exacerber le dessin, comme enfantin, des figures. Qu’ont-elles à voir avec le Cambodge, ces figures bariolées, masquées, aux costumes extravagants ? Elles ne sont que prétexte à profusion de couleurs et de motifs, dans le style si particulier de Ferréol. -
Soleil d'hiver
Michel Degand, artiste protéiforme (peintre, sculpteur, illustrateur,…), a, en plus de 50 ans de création, conçu une centaine de cartons de tapisserie, dans une inspiration sans cesse renouvelée, parfois onirique ou « cosmique » (à la Wogensky), d’autres fois « technologique »(à la Millecamps), souvent lyrique, avec un intérêt marqué pour le matériau, et la plupart tissés chez Pinton, à Felletin. Le soleil est un leitmotiv chez l’artiste ; mais, dans cette composition fragmentée, il a recours, comme le fera Sautour-Gaillard dans les années 90, à des retissages (avec un point plus fin), comme collés dans le motif, de fragments de tapisseries anciennes, suscitant d’insolites confrontations.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. N°1/1. Circa 1980. -
Eveil du jour
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, n°1/1. Circa 1980. -
Papillons de cocagne
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1970.Michèle van Hout le Beau a réalisé de nombreux cartons dans les années 60-70, travaillant avec de nombreux ateliers à Aubusson, et obtenant des commandes publiques (elle participa, avec d’autres, Soulages, Lagrange, Alechinsky,…, à la décoration des Boeing 707 transatlantiques d’Air France). Son écriture s’articule souvent autours de couleurs stridentes (très années 70), sur lesquelles se développent feuillages, personnages ou animaux stylisés. Notre carton, aux teintes acides, est d’ailleurs très caractéristique du style de l’artiste; on peut aussi y observer, sur un thème abondamment développé par Lurçat, la différence de traitement des papillons : le sujet est un prétexte à des évocations géométriques colorées proches de l’abstraction. -
Rêve gris
Artiste non référencée, Monique Brix a donné quelques cartons à Aubusson, tissés chez Glaudin-Brivet ou chez Pinton.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°6/6. Circa 1980. -
Composition
Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé, n°EA1. Circa 1980.C’est peut-être sa proximité avec Pierre Vago, architecte dont elle était la femme, qui a amené Nicole Cormier à s’intéresser à l’art mural (cf. « Soleil levant » à l’Université de Villeneuve d’Ascq) ; elle réalise dans les années 70 quelques tentures à base de feutrine, et pièces de coton cousues, et fait tisser quelques cartons chez Pierre Daquin notamment. -
Solaire
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec un bolduc signé de l’artiste, n°2/6. Circa 1970.Spécialiste des bouquets, Odette Caly a réalisé de nombreux cartons pour Aubusson, tissés chez Pinton, Henry ou Hamot. Son inspiration, plutôt champêtre d’habitude, s’est orientée ici vers des fleurs plus exotiques, soulignées par le fond vert. Bibliographie : Collectif, Caly, Publications filmées d’art et d’histoire, 1972, reproduit n°24 -
Chant d'oiseaux
Spécialiste des bouquets, Odette Caly a réalisé de nombreux cartons pour Aubusson, tissés chez Pinton, Henry ou Hamot. Le décor végétal est ici animé d’oiseaux, dans une inspiration que n’aurait pas reniée Henri Ilhe. Bibliographie : Caly, Publications filmées d’art et d’histoire, 1972Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec un bolduc signé de l’artiste, n°1/6. Circa 1970. -
Horizon bleu
Tapisserie tissée par l'atelier 3 pour la galerie Attali. Avec son bolduc, n°1/6. 1976.Protagoniste de l’abstraction géométrique et, à ce titre, défendu par la galerie Denise René , grande promotrice de la tapisserie abstraite (« Distances », fut tissé en 1973, l’un des derniers cartons à être tissé chez Tabard pour la galerie) , Morisson se singularise par ses compositions en bandes chromatiquement harmonisées en dégradés. C’est cette esthétique qui prévaut dans notre tapisserie ; si l’atelier A3 s’est plutôt illustré dans le tissage d’abstraits lyriques (Alechinsky, Arthus-Bertrand, Miotte…), plus propices à des pas de côté techniques, le spectre de ses réalisations est en réalité très large : Cathelin, Malel, Lindström, Druillet….voire, géométrique aussi, Mortensen. -
La vérité cruelle d'un ancien jeu
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec son bolduc. 1970.Surtout connu comme graveur (et d’ailleurs considéré comme l’un des plus importants du XXe siècle), Pierre Courtin a conçu quelques cartons de tapisserie (dont l’une de 110 m² (!) est conservée au Bureau International du Travail à Genève), dont certains, comme le nôtre, sont justement repris de ses gravures. On retrouve, dans notre pièce, l’esthétique très personnelle de l’artiste, faite d’étranges assemblages de formes géométriques, qui ne sont pas sans rappeler les motifs de certaines civilisations disparues (sud-américaines notamment). Etrange aussi est la gamme chromatique choisie ici par l’artiste, loin des forts contrastes de tons propres à ses confrères cartonniers. -
Composition
De retour en France dans les années 50, après un long séjour en Argentine, Berroeta donne alors de nombreux cartons dans un style d’abord figuratif (animaux, personnages,…) puis qui se tourne vers l’abstraction, comme dans sa peinture. S’il reprend le motif des poissons, très répandu dans la tapisserie de l’époque (cf. Lurçat, Picart le Doux), Berroeta peut prétendre à une réelle légitimité dans un sujet qu’il a traité à plusieurs reprises, dans « Mer du Sud » par exemple.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -
Tropiques
De retour en France dans les années 50, après un long séjour en Argentine, Berroeta donne alors de nombreux cartons dans un style d’abord figuratif (animaux, personnages,…) puis qui se tourne vers l’abstraction, comme dans sa peinture. Influence du cubisme et lyrisme des couleurs cohabitent ici dans un carton qui est peut-être une réminiscence de l’Amérique du Sud.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Circa 1955. -
Vendémiaire
L’histoire est connue : à la suite de la commande des « 4 parties du Monde » destinées à être tissées aux Gobelins, Dubreuil est l’un des 3 artistes, avec Gromaire et Lurçat, à avoir été envoyés par Guiillaume Janneau, administrateur des Manufactures Nationales, à Aubusson fin 1939, pour rénover la production de tapisserie locale (avec la commande d’une tenture sur le thème des Jardins). S’il partage les conceptions de Lurçat sur l’influence que doit produire la tapisserie médiévale pour revitaliser le médium, ses cartons, foisonnants et résolument naturalistes (sans l’onirisme d’un Coutaud par exemple), l’éloignent de son confrère, au profit d’une proximité avec l'oeuvre de Maingonnat. Notre tapisserie témoigne de la collaboration de Dubreuil avec l’A.R.T. (atelier de rénovation de la tapisserie) d’Antoine Behna (dont Janneau, en discrédit pour son rôle joué pendant la Guerre, était le conseiller technique). Le registre, allégorique, témoigne du classicisme de Dubreuil , entre nus académiques et natures mortes reflets de l’Histoire de la Peinture. Cet atelier a tissé à la fois en haute et en basse lisse : le catalogue de vente de 1990 incluait un exemplaire tissé dans chacune des techniques. Bibliographie : G. Janneau, A. Behna, Tapisseries de notre temps, 1950, ill. n°64 Catalogue Vente Millon-Robert, 3.10.1990, n°29-29, 64Tapisserie tissée par Coffinet pour Ami de la Paix. Circa 1945. -
Fleurs éclatées
Essentiellement sculpteur, Segeron a donné quelques cartons, tissés chez Legoueix à Aubusson. Dans la variété des titres et des coloris, on retrouve toujours les mêmes formes-motifs éparpillés, comme déchiquetés, tels d’étranges rhizomes ou réseaux capillaires.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Legoueix. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1980. -
Gestation
Essentiellement sculpteur, Segeron a donné quelques cartons, tissés chez Legoueix à Aubusson. Dans la variété des titres et des coloris, on retrouve toujours les mêmes formes-motifs éparpillés, comme déchiquetés, tels d’étranges rhizomes ou réseaux capillaires.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Legoueix. Avec son bolduc, n°2/6. Circa 1980. -
Couple génétique
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1970.On retrouve ici, dans cet apparemment unique carton, la sûreté de trait et la pureté de dessin de Trémois (surtout connu comme graveur et illustrateur, bien que Grand Prix de Rome de Peinture), et son goût pour le traitement du corps humain : étreintes amoureuses et méditations sur la science moderne y sont associées en un insolite raccourci propre à l’artiste. -
Courrier Sud
Tapisserie d’Aubusson, éditée par Jean Laurent. Avec son bolduc, n°1/6. 1976.Connu pour sa peinture géométrique faites parfois d’éléments machinistes, Gachon, d’origine aubussonnaise, a dessiné quelques cartons. Le nôtre reste éloigné de la veine habituelle de l’artiste. -
Les gaîtés du soir
Connu pour sa peinture géométrique faites parfois d’éléments machinistes, Gachon, a dessiné quelques cartons de tapisserie, et ce, dès son plus jeune âge, puisque dès la fin des années 60, il était en relation avec l’atelier Tabard. Notre carton témoigne de l’influence de l’abstraction lyrique sur le jeune artiste, une orientation finalement assez peu représentée en tapisserie.Tapisserie d'Aubusson, tissée par l'atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1. Circa 1968. -
Marché aux chameaux
A l’instar de Toffoli, Raymond Poulet a parcouru le Monde, et ses voyages lui ont servi de thèmes d’inspiration ; l’inspiration orientaliste n’a guère précédents en tapisserie que chez Bezombes.Tapisserie d'Aubusson éditée par Jean Laurent. 1980. -
Le village d'Eze
Dans un style post-cubiste décoratif proche de celui de Toffoli, Raymond Poulet a su traduire l’un des sites les plus spectaculaires de la côte d’Azur.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Jean Laurent. N°3/6. Circa 1980. -
Paysage au flamboyant
A l’instar de Toffoli, Raymond Poulet a parcouru le Monde, et ses voyages lui ont servi de thèmes d’inspiration.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Jean Laurent. N°6/6. Circa 1990. -
Soleil de corail
Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Trame verticale des branchages dans lesquels évoluent des poissons chinés, cachant un soleil rougeoyant : toute la fantaisie de Fumeron est réunie dans ce typique carton.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1960. -
La souche
Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l'Etat, avant de participer à la décoration du paquebot "France". D'abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l'abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Etrangement, si le titre est naturaliste, le carton opine lui vers l’abstraction, dans une sorte d’épure des cartons figuratifs de Fumeron où l’on reconnaît encore le cercle jaune-soleil caractéristique de l’artiste.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1960. -
Poissons de la lune
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1970.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Sous la lune, rousse, s’ébattent poissons, papillons, homard, dans une composition onirique typique de l’artiste : on retrouve par exemple nombre de ces motifs dans « Avant l’homme », tissé par les Gobelins (cf. Cat. Expo.« le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais sous la Ive République », Beauvais, 1997) -
Composition
Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l'Etat, avant de participer à la décoration du paquebot "France". D'abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l'abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Carton abstrait typique de l'artiste, dans une veine qui le rapproche de Borderie ou de Wogensky, et qui témoigne de son invention sans cesse renouvelée.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. N°1/6 Circa 1960. -
Mirage
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton Avec son bolduc. Circa 1965.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Intéressant carton de Fumeron dans sa meilleure veine abstraite, qui le fait ici l’égal de Matégot -
Sumatra
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc signé, n°EA. Circa 1960.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l'Etat, avant de participer à la décoration du paquebot "France". D'abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l'abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. La touche d’exotisme revient épisodiquement chez Fumeron dans les années 60 : on pense à ses cartons « Osaka », « Samouraï » ou «la mousson ». Nulle évocation littérale pourtant : le cercle (Soleil ?) en partie obstrué reste un leitmotiv, quel que soit le titre. -
Composition
Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Carton abstrait typique de l'artiste, dans une veine (et une gamme chromatique !) qui le rapproche de Borderie ou de Wogensky, et dont les réalisations de l’époque, bien qu’oubliées, n’ont rien à envier à celles de ses pairs.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N° EA. Circa 1960. -
Soleil couchant
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N° 2/6. Circa 1970.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l'Etat, avant de participer à la décoration du paquebot "France". D'abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l'abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Motif récurrent chez Fumeron, le soleil couchant (orange ou rouge) apparaît ici voilé derrière un rideau d’arbre, dans un carton proche de l’abstraction. -
Composition orange
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Le mur du nomade. N°1/6. Circa 1970. -
Lente approche
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc. Circa 1960. -
La mort du lièvre
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Rivière des Borderies. 1946.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux, le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). L’une des plus anciennes tapisseries de Perrot, contemporaine de « la chasse au renard » qui figurait à l’exposition séminale de 1946, notre carton témoigne de la première inspiration de Perrot : goût pour la Nature, les animaux, intérêt pour la botanique, la géologie, pour les paysages habités (l’homme est absent ici, mais il habite le village, il est chasseur )… L’artiste-ethnographe recycle en tapisserie les observations menées pour le Musée des Arts et traditions populaires pendant la guerre. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982, ill. p.83 Cat. Expo. René Perrot, mon pauvre cœur est un hibou, Aubusson, Cité de la Tapisserie, 2023 -
La loi
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Rivière des Borderies. Avec son bolduc. 1951.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux, le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Les représentations ornithologiques, qui se déclinent chez Perrot à l’infini, sont capables d’une extraordinaire variété d’allégories : par exemple avec « la discorde » et « la méditation » pour le Palais de Justice de Paris qu’illustrent respectivement tétras et chouettes. Rien de tel ici qu’un aigle majestueux à l’œil sévère, inspirant le respect, pour incarner « la Loi ». Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982 -
La roue
Tapisserie d’Aubusson tissée par Pinton. Avec son bolduc. Circa 1970.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux , le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Fond kaki, inspiration des millefleurs médiévales, oiseaux fourmillants, tous les éléments propres aux cartons de Perrot sont ici réunis.Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982 -
Hommage à l’abbé Breuil
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1955.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux , le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Etonnant carton inspiré des peintures de la grotte de Lascaux, où la tapisserie n’a jamais autant mérité son nom d’art pariétal ; la part de Perrot y est finalement assez modeste : saturation des couleurs (notamment du fond, entre parme et rose), densification des motifs (plus éparpillés dans la grotte), tavelures étalées,…Si Perrot a multiplié les cartons –hommages ( à Pergaud, à Redouté, à Audubon,….), celui-ci vaut surtout pour la proximité avérée de l’artiste et du dédicataire, « le pape de la Préhistoire » : l’hommage ne tient pas ici qu’à l’artificialité d’une commande publique. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982. -
Tauromachie
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Rivière des Borderies. 1946.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux, le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Tapisserie atypique dans l’œuvre de Perrot : gamme chromatique audacieuse de stridence, traitement inhabituellement épuré, thème singulier, comme chorégraphié, et impliquant la figure humaine ; on est près de Saint-Saëns. Mais peut-être s’agit-t-il là d’un carton de commande ? Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982 -
Hibou
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. 1955.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l'issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l'Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d'oiseaux , le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s'inspirera aussi Dom Robert). Notre tapisserie est exemplaire des portraits d’oiseaux de l’artiste ; le hibou y apparaît, comme souvent, associés à d’autres oiseaux, sur un fond inspiré des « mille-fleurs » médiévales. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982. -
Oiseaux
Tapisserie d’Aubusson tissée par la coopérative Tapisseries de France. 1952.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux, le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Si, en tapisserie, les oiseaux sont récurrents chez Perrot (comme une marque de fabrique !), le fond à motif de paysage est rare. Pourtant, l’artiste a produit de nombreuses gouaches au gré de ses déplacements (le Doubs, l’Auvergne, Collioure, les Canaries….), œuvre sensible et, restée, pour l’essentiel, confidentielle. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982 -
Le dindon
Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1960. -
Faisan
Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux, le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Sujet ornithologique, foisonnement des motifs inspiré des mille-fleurs médiévales, fond uni en aplat (en l’occurrence le fameux « bleu Perrot » comme le nommait les ateliers Pinton, utilisé de façon récurrente) font de notre carton un modèle exemplaire de l’art de Perrot à partir des années 60. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982 Cat. Expo. René Perrot, mon pauvre cœur est un hibou, Aubusson, Cité de la Tapisserie, 2023Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc signé. Circa 1960. -
Le rouge et le noir
Protagoniste du renouveau de la tapisserie en Belgique à la suite du collectif “Forces murales”, Lucas donna quelques cartons à la manufacture Braquenié de Malines vers 1956-1957, dans un style qui n’est pas sans rappeler l’oeuvre de Picart le Doux.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc. Circa 1960. -
Garrigue de printemps
Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Jean Laurent. Avec son bolduc, n°3/8. 1976.Si Debiève a conçu de nombreux cartons, dans une esthétique typique des années 40 (« le remailleur de filets », « le potier »,….), ils ont pour l’essentiel été imprimé sur tissus De façon plus confidentielle, il a été tissé à Aubusson, et ses cartons sont proches de sa peinture inspirée de la Provence. -
Le veilleur
Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. Symptomatique de l’époque héroïque de la fin des années 40 qui a vu aussi s’épanouir les talents balbutiants de Tourlière, Lagrange, Matégot,…, tous encore jeunes, inspirés par Lurçat, et tâchant de s’en singulariser, mais restant encore figuratifs, « le veilleur » affirme, dans un style lyrique et coloré, sa proximité d’avec la vie quotidienne (notons le détail du chandail rayé), en même temps qu’une forte connotation symbolique : un lanceur d’alertes en des temps incertains. Bibliographie : J. Cassou, M. Damain, R. Moutard-Uldry, la tapisserie française et les peintres cartonniers, Tel, 1957, ill. p.131 Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989, ill. p .15 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 Cat. Expo. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Felletin, Eglise, 1992, ill. p.46Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc. 1948. -
Vega
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Bolduc signé de l’artiste, n°2/4. 1967.Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Vega » appartient à la veine « cosmique » de Wogensky (son titre même en fait foi), qui court tout au long des années 60, et dont « Cosmos » (1968, Université de Strasbourg), et « Galaxie » (1970, Sénat, palais du Luxembourg) seront les points d’orgue. Chinés (omniprésents) et aplats y cohabitent en accords de couleurs tout en nuances, dans un monde curieux, inconnu, aussi proche de très petites cellules vues au microscope, que de l’infiniment grand. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 -
Serpent d'étoiles
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1961.Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Serpent d’étoiles » renvoie à la constellation éponyme (mais aussi à l’œuvre de Giono), à une époque (toutes les années 60) où son goût pour un absolu lyrique pousse Wogensky à traiter les astres, l’Espace, les galaxies, depuis « Cassiopée » en 1961, « Chant des étoiles » de 1962 (présentée à la Biennale de Lausanne), jusqu’à « Galaxie » (1970), conservée au Sénat. Une tapisserie similaire est conservée par le Conseil Régional du Limousin. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, tapisseries, Galerie la Demeure, 1962, reproduite Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989-1990, reproduite p.20 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992, reproduite p.73 Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, reproduite p.67 -
Oiseau pilote
Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Oiseau Pilote », au singulier, comme la trajectoire « chronotissée » dans un azur rouge (cf. « Oiseaux de Midi », ou « Envol », de la même année) d’une forme (une force même !) qui guide et oriente : à suivre donc… Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 Cat. Expo. Tissages d’ateliers-tissages d’artistes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2004Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. 1969. -
Les hyades
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°5/6. 1968.Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Les Hyades » appartient à la veine « cosmique » de Wogensky (son titre même en fait foi), qui court tout au long des années 60, et dont « Cosmos » (1968, Université de Strasbourg), et « Galaxie » (1970, Sénat, palais du Luxembourg) seront les points d’orgue. Chinés (omniprésents) et aplats y cohabitent en accords de couleurs tout en nuances, dans un monde curieux, inconnu, aussi proche de très petites cellules vues au microscope, que de l’infiniment grand. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989-1990 -
Grand vol roux
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé, n°3/6. 1973.Membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l'immédiat après-guerre. D'abord influencé par celui-ci, l'oeuvre de Wogensky (159 cartons d'après le catalogue d'exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d'oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S'il s'est toujours proclamé peintre, la réflexion de l'artiste sur la tapisserie est très aboutie : "Réaliser un carton mural.... c'est penser en fonction d'un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c'est aussi l'exigence d'un geste large qui transforme et accentue notre présence". Le thème des oiseaux survient chez Wogensky à la fin des années 60. A dire vrai, souvent les représentations restent très allusives, plus proches de trajectoires chronophotographiées que de traités d’ornithologie : c’est le mouvement dans l’espace qui importe, d’où les titres « vol … ». A cette époque, Wogensky poursuit des effets de matière obtenus par les lissiers grâce à l’emploi de différentes grosseurs de point ; c’est ce qui distingue « grand vol roux» d’ "oiseaux de septembre ", un carton proche, de 1970, tissé de façon uniforme et lisse. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, 20 tapisseries récentes, galerie La Demeure, 1973, ill. n°10 Cat. Expo. Robert Wogensky, l'oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 -
Procyon
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé, n°3/4. 1968.Membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l'immédiat après-guerre. D'abord influencé par celui-ci, l'oeuvre de Wogensky (159 cartons d'après le catalogue d'exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d'oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S'il s'est toujours proclamé peintre, la réflexion de l'artiste sur la tapisserie est très aboutie : "Réaliser un carton mural.... c'est penser en fonction d'un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c'est aussi l'exigence d'un geste large qui transforme et accentue notre présence". « Procyon » appartient à la veine « cosmique » de Wogensky (son titre même en fait foi), qui court tout au long des années 60, et dont « Cosmos » (1968, Université de Strasbourg), et « Galaxie » (1970, Sénat, palais du Luxembourg) seront les points d’orgue. Chinés (omniprésents) et aplats y cohabitent en accords de couleurs tout en nuances, dans un monde curieux, inconnu, aussi proche de très petites cellules vues au microscope, que de l’infiniment grand. Une tapisserie identique est conservée au Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, à Angers.Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l'oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 Cat. Expo. Tissages d’ateliers, tissages d’artistes, 10 ans d’enrichissement des Collections, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2004, reproduit p.101 Cat. Expo. Collections ! Collections !, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2019-2020, reproduit p.11 -
Grand vol bleu
Membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l'immédiat après-guerre. D'abord influencé par celui-ci, l'oeuvre de Wogensky (159 cartons d'après le catalogue d'exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d'oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S'il s'est toujours proclamé peintre, la réflexion de l'artiste sur la tapisserie est très aboutie : "Réaliser un carton mural.... c'est penser en fonction d'un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c'est aussi l'exigence d'un geste large qui transforme et accentue notre présence". Le thème des oiseaux survient chez Wogensky à la fin des années 60. A dire vrai, souvent les représentations restent très allusives, plus proches de trajectoires chronophotographiées que de traités d’ornithologie : c’est le mouvement dans l’espace qui importe, d’où les titres « vol … ». A cette époque, Wogensky poursuit des effets de matière obtenus par les lissiers grâce à l’emploi de différentes grosseurs de point ; « grand vol bleu », point d’orgue de cette thématique et de cette orientation formelle, est présenté en majesté sur le catalogue de l’exposition à la galerie La Demeure de 1973. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, 20 tapisseries récentes, galerie La Demeure, 1973, ill. n°1 (et détail en couverture et au dos) Cat. Expo. Robert Wogensky, l'oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989, ill. en couverture Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989, ill. p.1 Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989, ill. p.70Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. N°EA1. 1973. -
Poisson cardinal
Tapisserie tissée par l'atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé, n°EA/2. 1978.Roger Bezombes s'est intéressé à l'art monumental dès ses débuts artistiques. Il reçoit de nombreuses commandes de tapisseries de l'Etat, tissées d'abord aux Gobelins puis à Aubusson, notamment avec la manufacture Hamot dont les teinturiers lui obtiendront des laines dans le ton exact de ses cartons (qu'il peint d'ailleurs lui-même à grandeur). En 1952-1953, il réalise un ensemble monumental (300 m2) pour le Pavillon de la France d'Outremer à la Cité Universitaire de Paris. Il abandonne la technique de la lisse à la fin des années 50, pour réaliser des tentures murales faites d'assemblages de tissus. Précisément, ses « murales « (l’une des premières, « la Musique », longue de 25 m, fut commandée pour la Maison de la Radio) sont des patchworks de tissus assemblés, parfois adjoints d’objets de matériaux divers cousus, collés ou agrafés. Néanmoins, comme ici, certaines murales seront reproduites en tapisseries de lisse par l’atelier de Saint-Cyr de Pierre Daquin. Le thème du poisson est alors omniprésent ; Bezombes n’est pas un ichtyologiste, mais un poète : c’est la pourpre cardinalice qui l’intéresse, pas les espèces homonymes. -
Composition au chou
Sam Szafran, s’il est connu comme le peintre (ou plutôt le pastelliste, l’aquarelliste) des philodendrons et des escaliers, fut aussi, avant, au début des années 60, celui des choux ; il en raconte ainsi la germination : "Je me souviens quand mon grand-père m'emmenait à la synagogue, rue Pavée. On passait à travers le Marais. C'était l'été. Dans les rues, il y avait une affreuse odeur de choux, car c'est le légume le meilleur marché, le plus consistant". C’est de cette époque que datent ses débuts comme pastelliste, et la rencontre avec celle qui deviendra sa femme, Lilette Keller, lissière et assistante de Jean Lurçat. C’est donc à la confluence de ces éléments, et qui les incarne, que gît notre tapisserie, l’une des rares de l’artiste et de sa femme, dans une exemplaire collaboration (rappelons-nous néanmoins de Marthe Hennebert tissant Lurçat) : un chou, très réalistement rendu, grâce à de subtils chinages, est pris dans un maelstrom de verdure (thème-couleur de la tapisserie s’il en est), qui n’est pas sans annoncer les trames de philodendrons ultérieurs, opaques et denses. Bibliographie : Cat.Expo. Sam Szafran, obsessions d'un peintre, Paris, Musée de l'Orangerie, 2022-2023, p.175Tapisserie tissée par Lilette Keller. Circa 1963. -
Soleil rouge
C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton qui conjugue deux leitmotivs de Simon Chaye, le bouquet, et la nuée d’oiseaux, ici détachés sur un fond de soleil rouge donc.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l' atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1980. -
Source claire
C'est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l'encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,...), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l'artiste, spécialiste des enclos, haies et autres bords de rivière, animés d’animaux.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Bonjour. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°3/4. Circa 1960. -
La rivière d'argent
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Hamot d’après un carton de l’artiste. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1960. C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l’artiste, spécialiste des enclos, haies et autres bords de rivière, animés d’animaux. -
L'étang
C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Reprise exacte du carton « Nénuphars », seul le fond vert a été modifié.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°6/6. Circa 1970. -
L’enclos
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Brivet. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°4/4. 1966.C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l’artiste, spécialiste des enclos, haies et autres sous-bois. -
Jardin sauvage
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°4/4. Circa 1970.C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l’artiste, spécialiste des enclos, haies et autres sous-bois. -
Le grand tétras
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°2/6. Circa 1970.C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l'artiste, spécialiste des enclos, haies et autres sous-bois, animés d'animaux. -
Survol
C'est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l'encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,...), dont il est originaire. Ces compositions « à vol d’oiseau » sont caractéristiques de l’artiste.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé, n°5/6. Circa 1980. -
Paysage
C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Ces compositions « à vol d’oiseau » sont caractéristiques de l’artiste ; ici, les champs survolés, très estival paysage géométrisé, sont, par effet de loupe (ou de métaphore), associés aux plantes (blé, maïs,…) qui les composent.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. N°4/6. Circa 1970. -
Moulin
C'est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l'encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,...), dont il est originaire. "Source", "Fraîcheur", "Nénuphars" sont des cartons qui témoignent de l'intérêt de l'artiste pour l'élément aquatique. Cette proximité à la Nature est tempérée ici par l'usage mécanique qui en est fait par l'Homme.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc, n°3/6. Circa 1970. -
Allégorie des métiers
Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. 1958.Curieux carton où, sur une étoile (vaguement hexagonale) se déploient famille, métiers traditionnels (pêcheur, agriculteur,…) devant gazomètres et autres grues, emblèmes de modernité : un hymne à la reconstruction, une allégorie politique, une œuvre de propagande ,… ? -
Composition
Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1960. -
Chevaux en Camargue
S’il s’est parfois consacré à la grande décoration murale (en concevant des décors à l’Opéra de Paris notamment), Brayer en revanche s’est assez peu intéressé à la tapisserie : ses réalisations dans le domaine reprennent des tableaux antérieurs aux typiques sujets provençaux.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Pinton. N°1/6. Circa 1980.